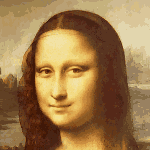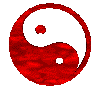-
Histoire des Carrières de Lutèce

LE LUTÉTIEN DU BASSIN DE PARIS (1)
Le Lutétien est un étage géologique de l'ère tertiaire qui a été défini dans les terrains du Bassin de Paris.
LES DEBUTS
Le stratotype du Lutétien (de Lutetia, ancien nom romain de Paris), a été reconnu pour la première fois en 1883 par A. de Lapparent dans la première édition de son "Traité de Géologie". Ce n'était alors qu'un sous-étage du Parisien défini par A. d'Orbigny en 1852. Ce n'est qu'en 1893 que le Lutétien prend le rang d'étage à part entière.

cliché Bibliothèque centrale MNHNPARISIEN Ligurien Calcaire lacustre de la Brie
Glaises vertes et marnes à Cyrènes
Marnes supragypseuses
GypseBartonien Calcaire lacustre de Saint-Ouen
Sables de BeauchampLutétien Calcaire grossier A. de Lapparent a défini une succession stratigraphique sans désigner une coupe-type, pour des raisons de qualité d'affleurement, la région étant notamment déjà très urbanisée et surtout parce que la succession montre une très grande variabilité d'un point à un autre, même à très faible distance ainsi que l'atteste le tableau ci-dessous (d'après de Lapparent, 1893).
La puissance totale de la succession définie par A. de Lapparent avoisine les 40 m.De haut en bas :
Divisions principales Divisions secondaires Epaisseurs Caillasses Caillasses sans coquilles, Tripoli de Nanterre
Caillasses coquillières ou Rochette0,60 m à 6 m
0,50 m à 2 mCalcaire grossier supérieur ou à Cérithes Roche (de Paris)
Bancs francs, id
Cliquart
Banc vert
Banc Saint-Nom0,25 m à 1 m
1 m à 4 m
0,60 m à 4 m
1 m à 6 m
0,50 m à 1 mCalcaire grossier moyen ou à Miliolites Banc royal
Vergelés et Lambourdes0,30 m à 1 m
1 m à 10 mCalcaire grossier inférieur Banc à verrains
Banc Saint-leu
Banc à Nummulites0,60 m à 6 m
2 m à 10 m
1 m à 12 mEn 1925, René Abrard entreprit une synthèse stratigraphique et paléogéographique du Lutétien. Il a subdivisé cette succession en 5 zones à partir des échinides et surtout des foraminifères, les seuls bons fossiles stratigraphiques présents dans ces dépôts.
Zone IVb à Cérithes et Potamides Zone IVa à Orbitolites complanatus Zone III à Echinolampas calvimontanum et Echinanthus issayavensis Zone II à Nummulites laevigatus seul Zone I à Nummulites (N. laevigatus et N. lamarcki) Ce travail a été poursuivi dans les années 60 par Alphonse Blondeau, spécialiste des Nummulites. Il a réalisé la première étude sédimentologique et micropaléontologique des formations lutétiennes (Blondeau, 1965).
LA STRATIGRAPHIE DU LUTETIEN
L'absence de coupe-type a conduit A. Blondeau à choisir, respectivement en 1962 et 1964, deux néostratotypes : sur la rive droite de l’Oise à Saint-Leu d’Esserent, pour la base du stratotype, et dans la carrière de Saint-Vaast-les-Mello, pour son sommet.

Aujourd'hui, grâce à l'examen de nombreuses coupes dans Paris et les environs, grâce aux apports de la géophysique et des très nombreux sondages profonds, un log synthétique peut être établi pour décrire les formations du Lutétien du bassin de Paris (Gély, 1996).
Accueil Introduction Historique Le Lutétien Les collections Album Bibliographie SOURCES : http://www.mnhn.fr/mnhn/geo/collectionlutetien/lutetien3.html#log
pour lire la suite cliquer sur les étiquettes...et les flèches....
et surtout cliquer sur les liens !
http://www.mnhn.fr/mnhn/geo/collectionlutetien/index.html
Département Histoire de la Terre /Géologie
Muséum National d'Histoire Naturelle
-
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Vous devez être connecté pour commenter
Dona Rodrigue