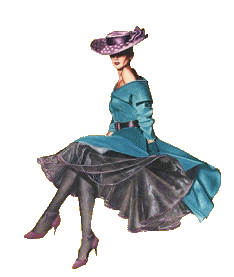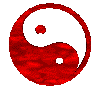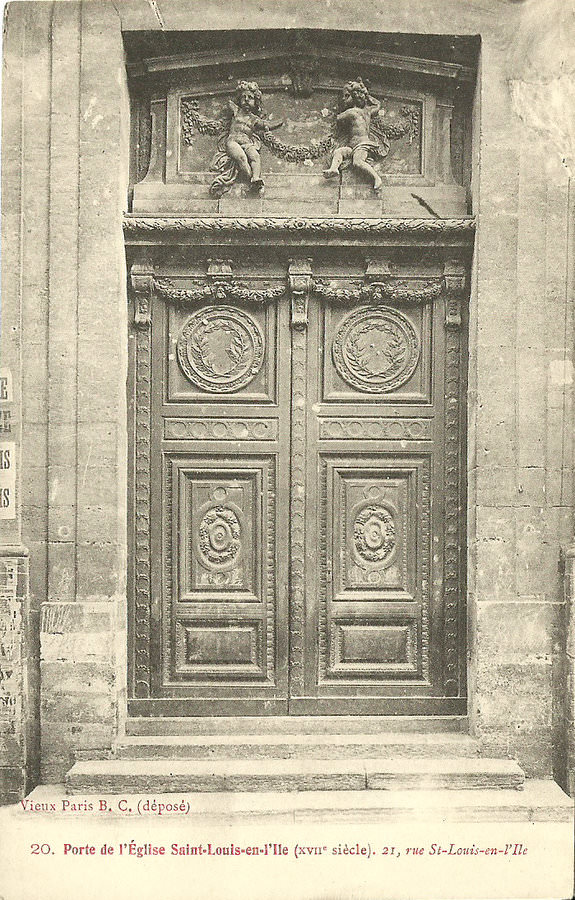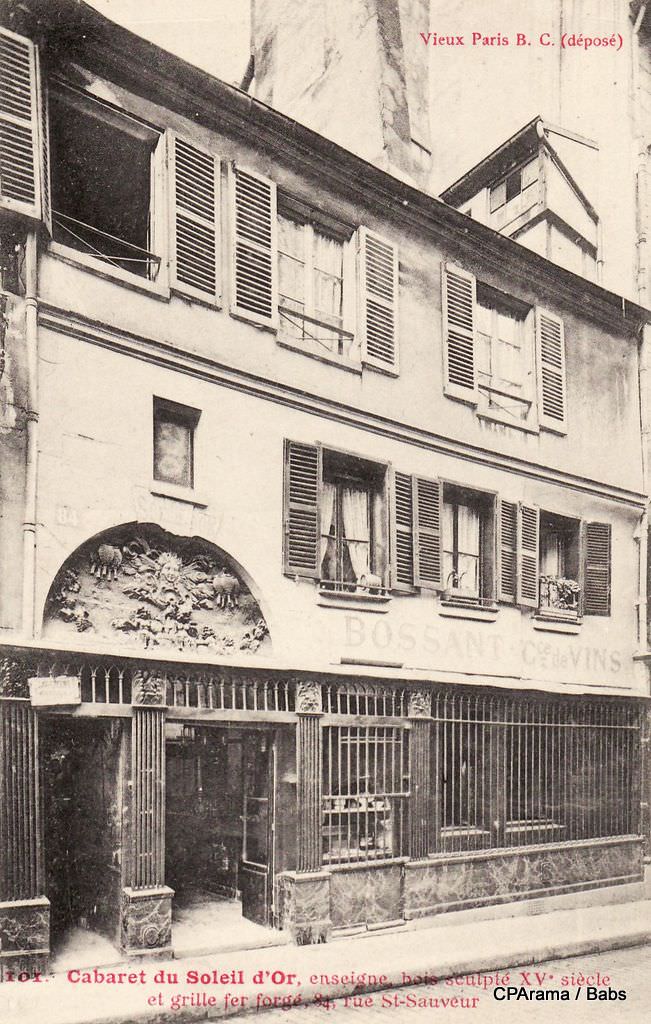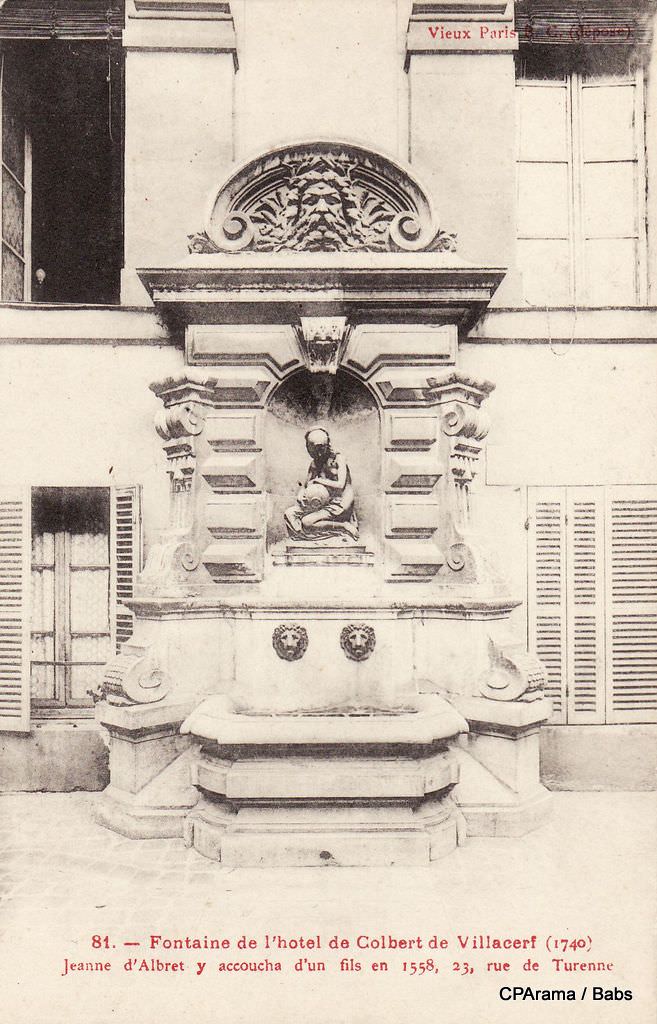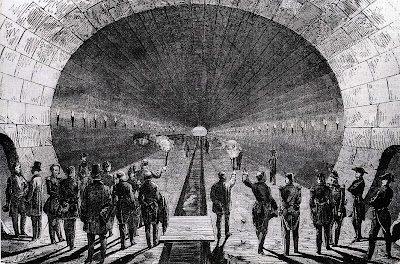-

"Souvenir des Halles Centrales 1906", pour une fois la photo est datée. Très beaux cliché de ces travailleurs du ventre de Paris, l'ancien, le vrai, et apparemment fiers de l'être! (vieille carte postale).

C'était encore l'époque où, à l'aube, aux Halles, les extrêmes se touchaient. Les noceurs du beau monde buvaient du champagne en compagnie des travailleurs de la nuit qui mangeaient du pied de cochon à la bonne franquette... (photo par Patrice Molinard, vers 1957)

Le Paris Perdu : voici la rue de la Tonnellerie, vue prise de la rue de la Poterie avant la construction du pavillon occidental des Halles. On distingue Saint-Eustache dans le fond. Une photo de Charles Marville de 1865.

A Paris, aux Halles Centrales en 1907, voici un groupe de vendeurs de pommes de terre. Dont un qui en est particulièrement fier....

Joignons nous à la foule du petit matin à côté des Halles, vers 1900. Imaginez le bruit, les cris, les odeurs... (Une photo d'Henri Lemoine, © RMN-Grand Palais - H. Lewandowski)

Nous voici au Carreau des Halles, au marché des aromates à côté de l'église Saint-Eustache, vers 1955. Une photo de Jacques Verroust.
Regardez d'autres photos des Halles d'antan : http://bit.ly/172qBiA

Les Halles, le Ventre de Paris, et sa foule indescriptible... (ancienne carte postale, vers 1900).

Le Carreau des Halles, Légumes et Salades... (ancienne carte postale, vers 1900).

Un matin aux Halles... (ancienne carte postale, vers 1900).

Les Halles Centrales le matin... (ancienne carte postale, vers 1900).

Les Halles le matin, les caisses sont vides... (ancienne carte postale, vers 1900).

Les Halles le matin, l'enlèvement des détritus... (ancienne carte postale, vers 1900).

Les Halles, à côté de Saint-Eustache... (ancienne carte postale, vers 1900).

Les Halles le matin, rues Etienne-Marcel et Turbigo... (ancienne carte postale, vers 1900).Sources
http://www.parisrues.com/rues01/paris-avant-01-halles.html
 votre commentaire
votre commentaire
-

Le Paris Perdu :
voici la place des Trois-Maries, vue du quai de l'Ecole en direction de la rue de la Monnaie, en 1862. C'est autour de cette place que seront construits les magasins de la Samaritaine entre 1905 et 1927. Le nom de Samaritaine venait de la pompe installée sur le Pont-Neuf de 1609 à 1813. Une photo de Charles Marville.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Le nom du passage rappelle une marchande des Halles voisines, Julie Bécheur, qui habitait ce passage en 1789; elle ressemblait à ce point à l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche, reine de Hongrie (et de Bohême) que Marie-Antoinette, sa propre fille, l'apercevant un jour, en fut elle-même frappée; on surnomma la marchande "Reine de Hongrie" et le nom resta au passage qu'elle avait habité.
Le passage de la Reine-de-Hongrie est situé dans le 1er arrondissement de Paris. Il débute au 17 rue Montorgueil et se termine au 16 rue Montmartre.
Ce passage, accessible aux piétons seulement et fermé la nuit à ses deux extrémités, a été créé vers 1770. Devenu propriété nationale, il a été vendu par le Domaine le 12 brumaire an V, à condition qu'il reste ouvert au public et qu'il soit entretenu par l'acquéreur. Il a été appelé, de 1792 à 1806, passage de l'Egalité.
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Ces quelques images témoignent d’endroits les plus anciens de la Capitale. Construits pour la plupart avant le XVIIIe siècle, certains sont encore là, d’autres ont disparu…
superbe blog
Paris-unplugged
http://www.paris-unplugged.fr/le-tres-vieux-paris/
http://saintsulpice.unblog.fr/category/photographie-sulpicienne/paris-dantan/
 2 commentaires
2 commentaires
-
Les ballons du siège de Paris
Dès les premiers jours du siège, dans la lignée revendiquée des aérostiers de 1793 et alors que des ballons captifs sont installés en divers points de la capitale pour effectuer des observations militaires, le fameux photographe Nadar, passionné d’aérostation, s’associe à deux aérostiers confirmés. Avec Camille Dartois et Jules Duruof, il constitue la «Compagnie d’Aérostiers», qui s’engage à construire plusieurs ballons dirigeables et à les mettre à la disposition du gouvernement de la Défense nationale. Ils établissent un campement sur la place Saint-Pierre, au pied de la butte Montmartre, où naît la poste aérienne du siège.En hommage aux grandes figures républicaines de 1848, Nadar baptise ses ballons : le George-Sand, l’Armand-Barbès et le Louis-Blanc.
Le coup d’envoi de cette entreprise de mobilisation est donné le 7 octobre 1870 : Léon Gambetta, ministre de l’Intérieur, quitte Paris à bord de l’Armand-Barbès pour regagner Tours et y organiser la résistance à l’ennemi.
Le ciel de Paris
Décliné sur tous les supports, ce départ de Gambetta en aérostat donne un grand espoir à la population parisienne, qui croit, un temps, qu’elle ne sera plus coupée du reste du pays. Dans cet engouement, à la fin novembre 1870, Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898) peint Le Ballon : sur les hauteurs de Paris, l’allégorie féminine de Paris, armée de son fusil et tournant le dos au spectateur, salue d’un geste délicat l’aérostat gonflé d’espoir qui s’élève dans le coin supérieur gauche du tableau.
Paris vu du Ballon, première photographie aérienne
NADAR
Mais quelques semaines plus tard, au début de l’année 1871, Puvis de Chavannes conçoit un pendant à cette première œuvre avec Le Pigeon qui, dans des tons assourdis, témoigne de la situation de la capitale devenue intenable. Frappée par le froid, l’isolement et la faim, la ville assiégée, incarnée par une allégorie endeuillée, est montrée de face, tentant de protéger de son bras tendu le fragile oiseau que le rapace prussien surgi du coin supérieur droit essaie de lui ravir.
De l’espoir à la peur
Entre les deux tableaux, quelques semaines voire quelques mois se sont écoulés, qui ont affaibli le moral des Parisiens. Les deux œuvres enregistrent aussi l’abattement de Puvis de Chavannes qui se sent pris au piège d’une ville dont le paysage agreste, ouvert et comme en creux, se déroulant sous le regard dans Le Ballon, est devenu dans Le Pigeon un espace urbain aux fortifications saillantes agressives – c’est la "ville géante à plusieurs enceintes" dont parle Alphonse Daudet dans ses Lettres à un absent (1871). D’un tableau à l’autre, comme par un phénomène d’éclipse, l’inquiétude et la peur ont succédé à l’optimisme et à l’espoir incarnés par l’aérostat.
Dans l’œuvre peint de Pierre Puvis de Chavannes, l’espoir ne renaîtra des ruines et ne s’épanouira dans la nature qu’en 1872, avec ses deux versions successives de L’Espérance (Baltimore, Walters Art Gallery et Paris, musée d’Orsay), sous les traits d’une allégorie féminine juvénile.

Photo de Nadar - Avenue de l'Etoile
http://etudesphotographiques.revues.org/916#tocto1n2
Auteur : Bertrand TILLIER
(source : www.histoire-image.org)
Clichés de NADAR
1868
 votre commentaire
votre commentaire
-
Qui ne connaît pas Edith Piaf? La Môme? La chanteuse française mondialement connue a disparu il y a maintenant cinquante ans des suites d'une insuffisance hépatique à l'âge de 47 ans. Ce petit bout de femme est la voix française qui s'est le mieux exportée. Dans le monde entier, on chante «La vie en rose», l'un des premiers titres qu'elle a écrits. Mais Edith Piaf a aussi eu une vie tumultueuse, parsemée de grandes histoires d'amour. Photo: Edith Piaf dans une chambre d'hôtel à New York, le 2 novembre 1948.Réalisation: Charlotte Gonthier
Jean Cocteau, très grand ami d'Edith Piaf, meurt le 11 octobre 1963, le jour où la mort d'Edith Piaf est annoncée. Photo: Edith Piaf et Jean Cocteau dans Le bel Indifférent en 1940.
A l'époque où elle s'appelle encore Edith Gassion, Louis Dupont devient son premier amour. Elle n'a que 17 ans quand elle devient maman de Marcelle, qui meurt deux ans plus tard d'une méningite.
Ensuite vient Paul Meurisse avec lequel elle partage l'affiche du Bel Indifférent de Jean Cocteau. Elle restera avec lui jusqu'en 1942.
De 1944 à 1946, elle vivra une romance avec le tout jeune Yves Montand. Elle lui donnera quelques ficelles pour réussir dans le métier. C'est aussi à cette époque qu'elle écrit «La vie en rose».
Autre homme qui a marqué sa vie, Charles Aznavour (d) qui pendant un moment sera son homme à tout faire et confident. Il fera partie des hommes dont la carrière a décollé grâce à Piaf.
Edith Piaf entourée des Compagnons de la chanson, qu'elle a rencontrés en 1946 et avec qui elle a fait une tournée en Europe du Nord. Un des Compagnons de la chanson se nomme Jean-Louis Jaubert. Il devient l'amant de Piaf pendant deux ans.
En 1948, elle le quitte pour l'amour de sa vie le futur champion du monde de boxe, Marcel Cerdan. Son grand amour se tuera dans un accident d'avion en 1949 sur un vol Paris-New York. Edith Piaf, déjà très affaiblie par sa polyarthrite aiguë, est anéantie par la perte de son homme.
Photo: Edith Piaf et Marcel Cerdan trinquent le 17 mars 1948.
En 1951, Edith Piaf rencontre le cycliste Louis Gérardin avec qui elle entame une relation alors que ce dernier est marié. Après cinq mois, cette histoire s'arrête mais Piaf n'arrive pas à l'oublier. Elle lui écrira nombre de lettres d'amour (photo) pendant près d'un an.
Quelques jours après l'arrêt de sa correspondance, elle épouse Jacques Pills, de son vrai nom René Ducos.
Photo: Edith Piaf avec Jacques Pills, Maurice Chevalier et Jean-Jacques Vital en 1952.
L'événement se passe à New York et fera la couverture de nombreux magazines. La témoin de Piaf n'est autre que Marlène Dietrich (photo). Leur union durera quatre ans, pendant lesquels Piaf fera une première cure de désintoxication.
Elle et George Moustaki, de 19 ans son cadet, vivront une histoire d'amour jusqu'en 1959. L'année précédente, ils ont eu un grave accident de voiture qui diminue encore plus la môme Piaf et la rend encore plus accro à la morphine.
Son dernier mari s'appelle Théo Sarapo. Il a 26 ans, elle 46. Ils se marient le 9 octobre 1962. Edith meurt quasiment un an après jour pour jour, puisqu'elle s'éteint à Grasse le 10 octobre 1963.
Bruno Coquatrix, le directeur de l'Olympia, lui doit beaucoup. C'est Edith Piaf qui sauve le lieu mythique en y faisant une série de concerts pour récolter assez de fonds pour renflouer les caisses. C'est à cette occasion qu'elle chantera la première fois «Non, je ne regrette rien».
http://www.20minutes.fr/culture/diaporama-3873-
photo-749375-edith-piaf-hommes-vie
 1 commentaire
1 commentaire
-

Paris pour les pervers
une «archéologie érotique de la Belle Époque»
Tony Perrottet débute son reportage parisien par une visite
rue Saint-Denis et rue Blondel.
Pour vraiment s’imprégner de l’essence de Paris, rien ne vaut un grand tour des bordels.
Au début, il fut difficile de trouver trace de ces emporiums légendaires consacrés aux plaisirs de la chair et qui firent la réputation de la ville au XIXe siècle. Ils furent tous fermés par le gouvernement français il y a plus de six décennies et furent convertis à divers usages commerciaux au fil des années.
Tout ce que je pouvais trouver, c’était des bribes —quelques vitraux par-ci, une portière étrangement ornée par-là. Mais quand je suis allé au 32, rue Blondel, le site d’un luxueux lieu de débauche appelé autrefois Aux Belles Poules, l’ambiance historique a été soudainement ressuscitée.
- Une maquette imaginaire d'un bordel parisien haut de gamme. Musée de l'Érotisme, Paris. -
Rue Saint-Denis et rue Blondel
Une petite promenade le long des boulevards étincelants de la rive droite m’a mené rue Saint-Denis, synonyme de prostitution à Paris depuis le Moyen Âge et qui a toujours sa quantité de filles qui font le trottoir entre les vendeurs africains.
La rue Blondel a une réputation pire encore, c’est une allée étroite où des prostituées plus mûres et des travestis musclés rôdent dans les portes cochères, portant toutes et tous des collants serrés en léopard et des bustiers plongeants.
Aujourd’hui, l’atmosphère est peut-être digne d’un film de Fellini, mais le numéro 32 fut autrefois le «spot» du glamour parisien, où des gentlemen victoriens allaient en masse pour jouir de merveilles érotiques sophistiquées.
Aux Belles Poules fut apprécié en particulier pour ses tableaux vivants.
Des couples parisiens aisés et des touristes à la recherche d’aventure apprécièrent ses pièces créatives telles que La nonne affolée, L’épouse se réveille ou Les officiers de marine en goguette, avec des actrices portant des phallus magenta.
Aujourd’hui, Aux Belles Poules est facilement identifiable grâce au carrelage d’origine en faïence rouge de sa façade.
Comme tous les bordels parisiens, il fut fermé en 1946 à l’occasion du grand coup de balai conservateur sur le marché français du sexe qui suivit la Seconde Guerre mondiale.
Le bâtiment fut reconverti en logement pour étudiants, pendant que le rez-de-chaussée fut occupé par un grossiste en bonbons pendant des décennies, puis un importateur de vêtements chinois, avant qu’il ne soit fermé il y a deux ans.
Quand je suis entré dans le hall, j’ai trouvé intactes les mosaïques abstraites sur le sol et la rampe d’escalier élégante en fer forgé. Le grand salon du bordel comporte toujours une galerie de peintures érotiques en carreaux de céramique.
Des nymphes voluptueuses se prélassent sur des nuages floconneux.
D’autres femmes dansent de façon onirique, dans un style qui évoque les fresques de Pompéi. Des miroirs antiques peuvent être aperçus derrière les tuyaux rouillés. Ce n’est que la difficulté physique pour enlever ces reliques qui les a sauvés des collectionneurs français, et en 1996, le Ministère de la Culture a émis un arrêté pour la préservation du bâtiment en ruines en raison de son «importance artistique et historique».
Mais la rue Blondel reste un coin féroce de Paris. En essayant de photographier l’extérieur du numéro 32, des cris de furie se sont élevés le long de l’allée.
«Ne photographiez pas les filles ! »
Une femme impressionnante portant une casquette militaire allemande est descendue de nulle part et a demandé mon appareil. Quand je lui ai expliqué mon intérêt très sérieux pour l’histoire des Belles Poules, elle s’est adoucie. J’étais clairement un connaisseur.
«C’est tellement beau à l’intérieur» dit-elle.«Il devrait être rouvert pour nous, les filles!»
le Guide des prostituées de 1883
Pour avoir un aperçu un peu plus frais sur cette ville baignant dans les clichés romantiques, j’emploie souvent des guides périmés—de préférence depuis un siècle ou plus. Ces éditions jaunies arrivent à exhumer le passé comme un monde tangible plein de vie et d’activité. Vous pouvez presque entendre la circulation de chevaux, sentir l’odeur d’un marché aux fleurs, goûter des châtaignes rôties.
Dans le cas de Paris, la ville de l’amour éternel, j’ai choisi une référence historique bien spécifique —un guide des prostitués de 1883.
THE PRETTY WOMEN OF PARIS (LES JOLIES FILLES DE PARIS)
Their Names and Addresses, (Leurs noms et leurs adresses)
Qualities and Faults, (Qualités et défauts)
being a Complete Directory or (Un répertoire complet ou)
Guide to Pleasure (Guide du plaisir)
for Visitors to the Gay City. (pour les Visiteurs de la Ville Gaie)Évidemment, je ne cherchais pas à jouir avec les fantômes des marchandes de sexe de Montmartre. Mais ce petit ouvrage mérite bien sa réputation parmi les chercheurs sur la vie clandestine pour sa foultitude de détails, fournissant un rappel bienvenu du bon vieux temps mythique de la ville, ainsi que les noms et les adresses des clubs les plus renommés, des établissements de nuit et des boudoirs privés de Paris en 1883.
Bien que le livre ait été publié à titre anonyme, il est évident qu’il fut écrit par un expatrié britannique aisé de Paris qui voulait aider ses compatriotes.
Seulement 169 copies du guide furent imprimées pour une«distribution privée» —dont quatre sur «papier vert-syphilitique» pour le Chef de la Police parisienne comme l’écrit l’auteur avec insolence dans sa préface.
Aujourd’hui, Pretty Women est extrêmement rare; il ne reste que trois exemplaires originaux du texte. L’un d’eux se trouve à la New York Public Library, gardé sous clé dans la Collection des Livres Rares.
(Bizarrement, il fait partie de la Collection George Arents sur le Tabac.) Alors, avant de quitter New York, j’ai pris rendez-vous pour le feuilleter dans la salle de lecture de haute sécurité de la bibliothèque. En me passant le texte délicat, qui était enveloppé dans un papier gris discret, le bibliothécaire m’a fait un clin d’oeil: «Cela a l’air intéressant…»
Et il avait raison: un aperçu par le trou de la serrure des boudoirs de luxe de 1883. Dans ses pages, au moins 200 femmes sont listées par ordre alphabétique par leur nom et leur adresse, avec des descriptions dans le style fleuri de l’époque.
Ce n’est pas de la grande littérature, et les portraits des femmes sont d’aussi mauvais goût que l’on pouvait le prévoir, l’auteur tombant dans le registre équestre pour faire l’éloge d’«un corps bien nourri», «de dents blanches et fortes» et de«gencives rouges qui sont un signe sûr de santé».
La belle Berthe Legrand, sise au 70, rue des Martyrs, par exemple, a les«dents d’un terrier» mais le seul balancement de ses hanches stimule le désir des hommes, s’enthousiasme l’auteur,«comme l’odeur de la viande cuite sur les cellules olfactives d’un homme affamé». Néanmoins, le guide présente une mine d’anecdotes et de commérages qui dépeint les personnalités des femmes et témoigne de l’ambiance de Paris à son apogée érotique.
Lire la suite de la première partie: une «archéologie érotique» de la Belle Époque

le «clitoris de Paris»
Muni du guide des bordels «Pretty Women of Paris», Tony Perrottet continue son épopée parisienne à l'hôtel Édouard VII, puis à a Maison Dorée.

- Le lit de la courtisane La Valtesse de la Bigne, maintenant au musée des Arts Décoratifs. Photo Tony Perrottet. -
Comme camp de base pour mes recherches, j’ai cherché un hôtel qui avait été autrefois un bordel. Une possibilité tentante était l’Hôtel Amour sur la rue de Navarin, qui offrait jadis un accès à une chambre de style médiéval, avec des chaînes, un chevalet, une croix pour attacher les clients et même un échafaud. Puis j’ai découvert quelque chose d’un peu plus à mon goût: l’hôtel de luxe Édouard VII, à côté de l’Opéra, sur la rive droite, qui fut pendant des années le pied-à-terre du débauché le plus célèbre de la Belle Époque.
L'Âge d'or européen
La Belle Époque, de 1880 à 1914, quand Paris était la capitale du monde des plaisirs illicites, pourrait être qualifiée d’âge d’or européen suscitant la plus vive nostalgie de nos jours. Des films tels que Moulin Rouge!, avec des personnages de beaux voyous, d’artistes maudits, et de prostitués au grand cœur, témoignent que cette réputation perdure.
À l’époque, Paris brûlait encore plus brillamment comme le phare de la permissivité et du grand style. Le sexe, et surtout le marché de sexe, était tout simplement plus classe à Paris.
Il est peu probable que ces détails soient célébrés dans la Maison de l’Histoire de France, prévue par Nicolas Sarkozy, le premier musée consacré à l’histoire nationale du pays. Pour les Victoriens, la ville fut révérée comme l’évasion ultime, une enclave de fantaisie charnelle loin des yeux critiques, et ses libertés n’étaient pas réservées uniquement aux hommes. Des femmes de la haute société, de Moscou à Minneapolis, étaient attirées comme des papillons de nuit par la flamme par ses boudoirs, où l’adultère était un sport pratiqué avec avidité.
À l’aube, elles pouvaient être aperçues quittant en douce les maisons des Champs-Élysées et montant dans des carrosses en attente, leurs sous-vêtements sophistiqués enroulés dans une petite balle. Les visiteurs gays avaient besoin d’être un peu plus discrets, allant aux bains publics couverts de marbre près du Jardin du Luxembourg.
Le bon vivant du coin, Marcel Proust, préférait l’Hôtel de Saïd près du marché des Halles, où des soldats en permission se retrouvaient pour un peu de repos. Le club lesbien le plus recherché s’appelait Les Rieuses, il était animé une fois par semaine par un trio d’actrices dans une villa allumée par des bougies sur les Champs-Élysées.
Les prostituées valurent à Paris sa célébrité
Mais ce sont les prostituées elles-mêmes, surnommées «les cocottes» ou «les horizontales», qui valurent à Paris sa célébrité. Le reste du monde s’émerveillait devant l’impudeur de leur marché, qui fut contrôlé par le gouvernement à partir de Napoléon pour empêcher la propagation des maladies sexuellement transmissibles.
À la Belle Époque, il y avait 224 bordels autorisés à Paris, où les filles passaient des contrôles médicaux deux fois par semaine, une précaution complètement inconnue à Londres ou à New York à l’époque.
Les plus luxueuses des maisons closes (ainsi appelées car leurs volets restaient fermés toute la journée) restèrent dans la légende internationale jusqu’aux années 1930, quand des vedettes de cinéma telles que Cary Grant les rendirent encore plus célèbres, leurs intérieurs furent décorés par des artistes célèbres, avec des «chambres fantaisie» pour satisfaire tous les goûts.
Pour les moins aisés, il y avait 30 000 filles «licenciées»qui faisaient le trottoir et qui servaient leurs clients dans deshôtels de passe autorisés par l’État. Mais bien que la vision romantique de la cocotte parisienne se soit propagée jusqu’à nos jours —gaie, insouciante, aimant son travail— la réalité fut, sans surprise, bien différente.
Le prix de la passe dans les bordels d’abattage n’était que d’un franc (5 euros aujourd’hui en prenant en compte le taux d’inflation). Surnommées les maisons d'abattage, il s’agissait d’endroits où les hommes prenaient un ticket numéroté et faisaient la queue à l’extérieur de la maison, et où une prostituée endurait jusqu’à 60 passes par jour.
(pauvres femmes)
La redoutable Police des Mœurs
Toute fille qui n’entrait pas dans le système était à la merci de la redoutable Police des Mœurs qui chassait les filles non licenciées à travers Paris. Les abus furent endémiques. Après minuit, les agents spécialisés bloquaient des rues entières dans les quartiers ouvriers et se lançaient dans la foule en poussant des cris terrifiants.
Selon l’historienne Jill Harsin dans Policing Prostitution in Nineteenth-Century Paris, les scènes étaient similaires aux rafles nazies dans les ghettos.
Bien sûr, la classe la plus fascinante des filles de joieparisienne —les courtisanes de haut vol, connues comme les grandes cocottes— opérait bien loin de la Police de Mœurs. Mi-prostituées haut de gamme, mi-maîtresses, elles étaient les véritables princesses du demi-monde parisien. Beaucoup se sont extraites de la pauvreté pour devenir les amantes de financiers et d’hommes politiques, de princes et de millionnaires.
Quelques-unes, vraiment chanceuses, amassèrent des fortunes personnelles immenses. Le peintre Auguste Renoir, dans la biographie écrite par son fils Jean, Renoir, Mon Père, fait l’éloge de leur force de caractère et de leur fine intelligence —comme les qualités raffinées de la geisha ou des haetera de la Grèce antique— qui faisaient d’elles des compagnes idéales dans n’importe quel cercle social.
C’est pour aider des étrangers à naviguer entre les différentes strates de ce monde exotique, avec ses propres codes et ses propres mœurs, que The Pretty Women of Paris fut écrit.
Un soir, j’ai décidé d’aller visiter une adresse où l’on trouvait une de ces femmes de moindre renommée évoquées dansPretty Women of Paris, mon guide de 1883 consacré à la prostitution à Paris. À la lettre A, la première sur la liste était Jeanne Abadie qui exerçait devant le 80, boulevard de Clichy.
Jeanne Abadie était «une femme fringante, bien habillée, d’environ 27 ans»,ai-je appris, «avec une bonne allure sous la lumière du gaz, malgré ses fausses dents».
Elle fut élevée dans l’arrière-scène d’un théâtre, où elle attira l’œil de riches boulevardiers. Sa personnalité était «peu raffinée et fougueuse»,prévient l’auteur, mais «son tarif était modéré».
Pigalle, épicentre sordide d'une foire formidable
Je suis sorti du métro au coeur de Pigalle, un nom évoquant autrefois la romance. En 1883, des bohémiens passaient leur temps au Café de la Nouvelle Athènes, où Degas peignit Les buveurs d’absinthe, et les Parisiens s’extasiaient devant la vie nocturne de l’arrondissement représentée dans Un Bar aux Folies Bergère, qui fut exposé au dernier Salon.
(La mort de Manet fut quant à elle moins romantique, lorsqu’elle survint au printemps 1883, des suites d’une amputation d’urgence consécutive à une syphilis attrapée lors de sa jeunesse désoeuvrée.)
Aujourd’hui, Pigalle est l’épicentre sordide d’une foire commerciale, ces rues pullulant de sex shops éclairés par des enseignes au néon et fréquentés par des groupes d’Allemands lors d’enterrements de vie de garçon.
Néanmoins, j’ai suivi les numéros, cherchant le 80, où l’on trouvait jadis Mademoiselle Abadie. J’ai rapidement découvert que le numéro 82 est le trop fameux Moulin Rouge. Ouvert en 1889, il était à l’époque d’Abadie un simple café musical. La nuit où je suis passé, des gardiens avec des haut-parleurs rassemblaient des foules de touristes rangés en file derrière des cordes en velours.
Le numéro 78 est un supermarché érotique.
Mais où est le numéro 80?
Le musée de l'érotisme
Quelques portes plus loin, au numéro 72, se trouve le musée de l'Érotisme, j’ai donc pris la décision d’y passer la tête. Le monde moderne a vu réussir énormément d’institutions de ce genre, mais normalement, ce sont des lieux cliniques et déprimants. Sans doute celui-là, sur sept étages, allait-il toucher le fond en matière de sensualité parisienne.
À minuit (il est ouvert tous les soirs jusqu’à 2h00) le musée était désert à l’exception de quelques couples riants, j’ai donc sorti mon carnet et j’ai gribouillé rapidement quelques notes, essayant de prendre un air de chercheur.
Le début de l’exposition n’était pas très prometteur. L’essentiel de la collection semblait être constitué de reliques du Japon. Puis je suis arrivé à l’étage consacré à Paris, avec des photos de scènes de bordels datant du XIXe siècle, des filles faisant le trottoir, et des travestis. Sur le mur était projeté un de ces films du début des années 1900 qui était montré dans les salles d’attente des bordels pour «exciter les appétits»;celui-là mettait en scène deux «bonnes sœurs»s’ébattant avec un petit chien.

Devanture de la maison Au Moulin, 16, rue Blondel (2e) aux courbes et au décor floral Art nouveau.
dernière fantaisie à Paris
Visite au bordel Le Chabanais, qui fut lieu favori du Prince de Galles, et rencontre avec Nicole Canet, l'«archéologue érotique».

- Décoration du palace de La Païva, montrant le profil de la courtisane. Photo Tony Perrottet. -
J’ai refusé d’accepter le verdict pessimiste de Alain Plumey, le copropriétaire du musée de l’Érotisme, affirmant que toute trace du florissant marché du vice de la Belle Époque était éradiquée de la surface de la Terre.
En consultant mon antique guide des prostituées,The Pretty Women of Paris, j’ai trouvé un index fournissant une liste des 100 bordels les plus classieux de la ville en 1883.
La plupart était connue uniquement par leur adresse —24, Rue Sainte-Foy; 83, boulevard de Grenelle —mais jadis, derrière ces façades anonymes se cachaient de fabuleuses enclaves de luxe.
Quelque chose de ces palais dédiés au péché a sûrement survécu, ai-je pensé.

ce qu'il advint du fauteuil d'amour
Tony Perrottet retrouve chez Louis Soubrier, antiquaire,
le fauteuil d'amour d'Édouard VII.

Second throne: The special chair made for the playboy Prince Bertie, the future Edward VII, to take his weight during lovemaking in a Parisian bordello

- Une maquette imaginaire d'un bordel parisien haut de gamme. Musée de l'Érotisme, Paris. -
«Le Chabanais»
Tout près de ma propre adresse de résidence, l’Hôtel Édouard VII, on trouvait autrefois le renommé 12, rue Chabanais, qui fut tout simplement, prétend mon guide, «la bagnio [le bain, un sobriquet pour un bordel] la plus exquise du monde». Si Paris était l’île de la fantaisie en Europe, «Le Chabanais»,comme les Parisiens l’appelèrent avec affection, était son bijou rêvé.
Chacune des 30 pièces du bordel était décorée selon un thème différent, créant un catalogue raffiné des arts érotiques. Il fut ouvert en 1878 par une ancienne courtisane richissime, «Madam Kelly», qui aurait dépensé plus de 1.700.000 francs sur la décoration intérieure (actuellement environ 8,7 millions d’euros), et qui rapidement attira les financiers, les hommes politiques, les aristocrates et les vedettes de la scène les plus riches d’Europe.
Je me suis promené dans la rue Chabanais, aujourd’hui une petite rue arborée et tranquille derrière la Bibliothèque Nationale, semée de petits restaurants modestes et de petites galeries d’art. Et, oui, l’extérieur d’époque du 12 est toujours intact —un mince immeuble de sept étages avec une nouvelle couche de peinture beige. En 1883, la façade du Chabanais était aussi discrète pour ne pas attirer l’attention des indésirables. Mais quand les portes étaient ouvertes par un Africain habillé d’une tenue mauresque étincelante, un monde magique se dévoilait.

100 francs pour choisir sa fantaisie
Le vestibule du bordel ressemblait à une grotte souterraine, avec des murs en pierre artificielle et des cascades. Les clients étaient emmenés au premier étage —la salle Pompéi tout en miroirs— où des femmes peu vêtues s’inclinaient sur des sofas romains surmontés de fresques de 16 vignettes en huile peintes par —qui d’autre?— Henri de Toulouse-Lautrec, bien sûr, et représentant des centaures masculins et féminins se livrant à des actes sensuels.
C’est à cet étage que s’opéraient les transactions financières. Aucun argent ne pouvait être échangé au-dessus, donc les clients achetaient là à la dame des jetons qu’ils pouvaient échanger plus tard contre des boissons et des services. Le minimum était 100 francs —environ 500 euros d’aujourd’hui. À ce stade, les clients n’avaient plus qu'à choisir leur fantaisie. Il y avait la chambre hindoue, ornée avec des oeuvres d’art indien; la chambre turque, remplie d’artéfacts orientaux; ou le Salon Louis XV, pour les francophiles purs et durs.
La pièce vénitienne, évoquant la Renaissance italienne, avait un lit énorme en forme de coquille. Dans le salon japonais, il y avait six divans arrangés en cercle autour d’un brûleur d’encens. Il y avait même une chambre pirate, avec des hublots contre lesquels l’eau de mer pouvait être jetée par les employés.
Le lieu favori du Prince de Galles
Cela ne me surprenait point que Le Chabanais ait été le lieu favori du Prince de Galles. Déjà, il pouvait s’y rendre facilement depuis son appartement. Son lieu préféré était la chambre hindoue, et c’est là qu’il avait fait installer ses deux accessoires célèbres, réalisés sur mesure. Le premier était une baignoire énorme faite en cuivre rouge brillant. Elle avait la forme d’un vaisseau, avec une sirène à grosse poitrine sur la proue. On suppose que le prince la remplissait avec du champagne Mumm durant les nuits chaudes d’été.
L’autre création fut son fauteuil d'amour —appelé encore le trône d’amour ou la chaise du sexe.
En 1890, la taille de Bertie mesurait 121 centimètres, donc il s’était fait construire un appareil pour faciliter ses rencontres sexuelles, avec de longues poignées lui permettant de descendre sur ses partenaires. L’astucieux appareil resta au Chabanais bien après la mort du roi en 1910, et les propriétaires l’exposèrent fièrement quand ils commencèrent à faire des visites guidées dans les années 1920 —pendant la journée, quand les filles dormaient.
Un journaliste américain, Walter Annenberg, participa à une visite en 1926. «Ils vous font visiter les chambres comme si c’était une visite au musée Tussaud» raconta-t-il plus tard. La chaise du sexe royal, qu’Annenberg a décrite comme une sorte de «palan» en était le point fort. «[Le prince] y montait comme s’il allait dans une étable».

Dans les années 1930, les maisons closes étaient autorisées à Paris, mais étroitement surveillées par la police mondaine. Leurs devantures étaient très discrètes, pour ne pas choquer les passa A. GELEBART / 20 MINUTES, PREFECTURE DE POLICE, MUSEE DE L'EROTISME, DR
Le message de Soubrier
De retour à mon hôtel, j’ai cherché l’adresse de la société Soubrier. Le grand magasin de meubles est resté au même endroit depuis les années 1850, sur la rue de Reuilly dans le 12e arrondissement. Je ne gardais plus beaucoup d’espoir, mais j’ai envoyé un mail cordial à l’actuel patriarche de la dynastie, Louis Soubrier, en expliquant que j’étais chercheur sur l’histoire des maisons closes de Paris. Saurait-il, par hasard, qui possédait actuellement le fauteuil d'amourdu Roi Édouard VII?
Deux jours plus tard, j’avais un message époustouflant sur ma boîte mail de la part de Louis Soubrier lui-même, avec pour objet: «EDWARD VII CHAIR». «Quand vous serez à Paris» écrivait-il, «Je vous montrerai le fauteuil d’amour avec plaisir».Je me précipitai tout de suite sur le téléphone, demandant des indications pour trouver l’entrepôt.
La famille Soubrier fit fortune au XIXe siècle en réalisant des répliques historiques de meubles romains et d’ancien régime —raison pour laquelle, sans doute, elle fut choisie par le Prince de Galles pour créer son appareil de fantaisie. Aujourd’hui, Louis Soubrier est antiquaire, louant souvent des pièces pour des tournages de films historiques.
«Venez avec nous, nous dînons ensemble!»
En sortant du métro, je me suis retrouvé sur une des rues les plus banales de Paris, ce qui est normal pour un quartier anciennement industriel. Je suis directement tombé sur Soubrier, qui était en train de sortir de l’immeuble. Un homme digne, dans la soixantaine, avec une grosse moustache, portant une veste en tweed et une cravate jaune, il m’a évoqué le souvenir d’un pilote de chasse à la retraite. «Oh, j’ai oublié de vous dire que nous fermons à l’heure du déjeuner» dit-il, vaguement amusé par mon indifférence à cette tradition française. «Venez avec nous, nous dînons ensemble!»
Oh non, ai-je pensé, inquiet de dire quelque chose lors du repas qui allait le faire changer d’avis. (Genre «Vous avez seulement envie de regarder le fauteuil? Je croyais que vous aviez envie de l’acheter!»)À sa brasserie préférée, de l’autre côté de la rue, nous nous sommes mis à table avec l’un de ses amis, également fabricant de meubles dont le dachshund n’arrêtait pas de sauter à ses pieds. Soubrier nous a régalés avec des histoires sur ses voyages aux États-Unis pendant sa jeunesse. Pendant les années 1950, il a été à Newport, Rhode Island, et a assisté à la fête d’anniversaire de Jacqueline Bouvier. Ses histoires étaient incroyables, mais j’étais fixé sur les meubles. Avait-il toujours envie de me montrer le fauteuil d’amour?
«Mon père était un homme très correct, très formel»,a-t-il expliqué.
«Il ne m’a jamais parlé du fauteuil d’amour. Mais quand il fut de nouveau sur le marché en 1992, un de nos anciens courtiers m’a pris à part. Il m’a appris que mon arrière grand-père avait construit le fauteuil au début des années 1890, sur des spécifications du Prince de Galles lui-même. Alors j’ai commencé à regarder dans nos archives. Et oui, le voilà. J’ai trouvé les croquis de mon ancêtre, une aquarelle. C’était la preuve vivante.»
Soubrier a acheté le fauteuil —pour combien il ne le dit pas, à part que c’était«très, très cher»—et il l’a gardé depuis. Pendant un petit moment, le fauteuil a voyagé à New York pour une exposition de «meubles de fantaisie». C’était ça, sans doute, la base de la rumeur selon laquelle il avait été vendu à un Américain. Une galerie de Manhattan a refusé de l’exposer. «Les Américains étaient choqués» ,jubila-t-il.
http://www.slate.fr/story/39865/paris-pervers-premiere-partie
 votre commentaire
votre commentaire
-

Les Tuileries et les galeries du Palais-Royal sont le centre de la prostitution parisienne au XVIIIe siècle. Au cours du XIXe siècle, les maisons closes s’éparpillent dans Paris, notamment sur les grands boulevards où foisonne la vie ainsi que dans les passages couverts à l’architecture moderne et à la forte fréquentation, où tout se vend et tout s’achète. Les galeries du Palais-Royal sont peu à peu délaissées.
16 rue Blondel, Paris, France, octobre 1920
Autochrome de Frédéric Gadmer, Inv. A 24050
© Musée Albert-Kahn - Département des Hauts-de-Seine
L'architecture de la maison borgne
Les maisons closes ou borgnes tiennent leurs noms de leur architecture spécifique : tournées vers l’intérieur, elles présentent des façades dépouillées et neutres, aux fenêtres souvent grillagées ou masquées pour empêcher les femmes de racoler.
En revanche, l’intérieur est très soigné et les décors théâtraux, la maison s’articule autour d’un escalier central desservant tout l’immeuble entièrement consacré à la prostitution.

Au-dessus de la double-porte d’entrée se trouve la mythique lanterne rouge, héritée des lupanars antiques, éclairant le numéro à la nuit tombée.
Certaines maisons portent parfois une enseigne. Les immeubles occupés par les maisons borgnes ne sont souvent large que d’une seule pièce, les rendant immédiatement reconnaissable depuis la rue.
Ne donnant aucune vision directe sur l'intérieur depuis la rue, la porte d'entrée s'orne parfois d'éléments de décor attrayants tandis que les clients quittent l'endroit par une porte dérobée.

Une pratique répandue
Au XIXe siècle, la maison close est un endroit chic que les hommes d'affaires comme les étudiants côtoient sans se cacher. 200 établissements officiels, contrôlés par la police et des médecins sont recensés dans Paris.
L'Etat profite du commerce en prélevant par l'intermédiaire du fisc, 50 à 60 pour cent sur les bénéfices.
Entre 1870 et 1900, 155 000 femmes sont déclarées comme prostituées ; à ce nombre s'ajoutent de nombreuses femmes qui pratiquent la prostitution clandestine.
En 1911, la police autorise les « maisons de rendez-vous », moins identifiables de l’extérieur, où les prostituées ne vivent pas mais viennent seulement travailler.

Ces établissements modernes font la satisfaction d’une clientèle aisée et discrète dans les années 20.
Parallèlement à ces maisons officielles, on trouve des cafés à serveuses
« montantes » ou des instituts de bains et de massage à la prostitution déguisée. Mais il existe un type de maison close destiné au bas de l’échelle sociale, les maisons d’abattage.
Soumises à la même réglementation que les maisons closes classiques ou luxueuses, le travail s’y effectue à la chaîne. La clientèle est constituée d’ouvriers ou de soldats. Les plus grandes de ces maisons peuvent faire travailler jusqu’à 50 femmes soutenant un rythme effréné (chacune peut recevoir plus de 20 clients par jour).

Rue Blondel
Et réglementée
La prostitution est soumise à une réglementation qui s'élabore au fil des ans. En 1796, Napoléon institue un registre de la prostitution, quelques années plus tard en 1802, la visite médicale devient obligatoire.
La légalisation de la « tolérance » et des maisons closes se précise en 1804 : une brigade des mœurs contrôle les filles et les maisons. Les prostituées doivent alors s'inscrire d'abord à la préfecture et ensuite dans une maison. Les filles des rues sont dites « en carte », celles des maisons closes sont dites « à numéro ».
Le règlement détaillé édité en 1823 par le préfet de police Dubois reste inchangé jusqu’en 1946.
Hygiénisme et moralité
La mise en place d’un système de tolérance implique une surveillance sanitaire dès la fin du XIXe siècle.
Au début du XXe, la propagation des maladies vénériennes, dont la syphilis, alerte les autorités : les débats portent à la fois sur les questions d’hygiène et sur la moralité, remettant en cause la réglementation existante considérée comme hypocrite.
Rue Sainte Appoline
Le Comité national d’Etudes sociales et politiques créé par Albert Kahn se penche sur ces questions et publie plusieurs rapports en 1928.
L’idée de l’abolitionnisme fait son chemin et le 13 avril 1946, le projet de loi sur la fermeture des maisons closes initié par l’ancienne prostituée Marthe Richard est finalement voté. 1500 établissements, dont 180 à Paris, ferment leurs portes.

Persiennes et gros numéros
L’image codifiée de la maison close est ancrée dans la mémoire collective, peu modifiée en un siècle et demi d’existence officielle : gros numéros, persiennes et lanternes rouges ont été fixés et diffusés par les artistes, observateurs ou amateurs de ces paradis artificiels.

L’évocation des maisons closes et des lieux de plaisir peuple le monde de l’artà l’entre deux guerre, assouvissant l’infini besoin d’étourdissement et de jouissance qui caractérise cette période.
La crise de 1929 met fin à ces années vouées aux plaisirs légers.

http://albert-kahn.hauts-de-seine.net/archives-de-la-planete/dossier/maisons-closes/
photos google

Jetons pour maisons closes.

 votre commentaire
votre commentaire
-

La veuve qui clôt

En 1946, Marthe Richard, elle-même ancienne prostituée, fait voter la loi fermant les maisons closes, et y gagne le surnom du titre de ce billet; ce qui ne l'empêche pas, quatre ans plus tard, de jouer au théâtre le personnage d'une maquerelle (photo ci-dessous à droite, en couverture de ce livre).

Le bordel le plus célèbre était alors le Chabanais, au 12 de la rue éponyme, où, dans un banal immeuble de bureaux, on peut encore voir l'escalier d'antan. Juste en face, la galerie

Au bonheur du jour expose (jusqu'au 31 janvier) une centaine de photographies et de dessins sur le thème des bordels, et aussi quelques objets : un appareil de vision stéréoscopique où on peut admirer les charmes de ces dames en relief, des jetons (bon pour ...), des cravaches et un 'pique-couilles' (je vous laisse deviner).
Ci-dessus Madame et ses filles (1900).

Au milieu de photos purement documentaires, voire carrément sordides (certains des tableaux vivants, par exemple), on découvre des curiosités (la baignoire à champagne du Prince de Galles) et quelques joyaux,

comme la photo ci-contre (attribuée à Brassaï, d'après le cartel) de lingerie coquine fétichiste, pour le catalogue Diana Slip à destination exclusive des meilleures maisons.
 Il y a dans la galerie beaucoup de photographies des luxueuses décorations intérieures des bordels;
Il y a dans la galerie beaucoup de photographies des luxueuses décorations intérieures des bordels; les seuls Atget sont ici des vues extérieures, rien de sulfureux cette fois.
Voici enfin, d'André Zucca avant l'occupation, une belle photographie nocturne (Prostitution, 1938).
Si par hasard vous vous ennuyez à la BNF, c'est tout prêt.
sources
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2009/12/17/la-veuve-qui-clot/


“Je suis pour la réouverture”
Marthe Richard (Prix “Tabou” 1951) veut acheter un magasin d’antiquités ou aller à la campagne faire de l’élevage
Les Hygiénistes auront leurs étrennes : c’est - révérence parler - la réouverture des maisons closes.Disons tout au moins que leur réouverture est en bonne voie puisqu’elle a été déclarée souhaitable hier par leur ennemie jurée :
Marthe Richard.
L’événement mérite une relation fidèle.
Hier, comme chaque année, fut attribué le “Prix du Tabou”. Hier, comme chaque année, on savait que ce prix était attribué d’avance au dernier-né des éditions du Scorpion, en l’occurence Appel des Sexes, de Mme Marthe Richard, de célèbre mémoire.Ainsi purent délibérer en toute liberté d’esprit les membres du jury (François Chevais, pape du chiffrisme et “plus mauvais comédien de Paris”, Jacques Robert, Yvan Audouard, les dessinateurs Gus et Soro, Maurice Raphaël, Jean-Paul Lacroix, Jean Bouchon et - j’ose à peine le dire - votre serviteur.
Le communiqué publié après les délibérations témoigne de leur extrême sérénité. Le voici :
“Sous le signe de Santa Close, à la huitième passe à la suite de quelques claques, le jury du Prix Tabou a couronné Mme Marthe Richard pour son essai sur l’amour à peine sorti des presses : Appel des Sexes.
Intimement associée au sénateur Durand
“Le nom du dénateur Durand, vaillant pionnier de la Réouverture, a été intimement associé, par les membres du jury à celui de la lauréate. Leurs deux manifestes indiquent en effet un retour à la raison que le jury du Prix du Tabou se devait de signaler.”Là dessus arrivèrent dans la cave où Juliette Greco et Anne-Marie Cazalis prirent leur envol Marthe Richard, la lauréate, et son éditeur, Jean d’Halluin, qui attendaient depuis une heure chez un “chand de vins” voisin de la rue Dauphine. Ils s’embrassèrent devant les photographes, entre deux chambranles d’une porte symboliquement ouverte.

Marthe Richard, qui mena la campagne pour la fermeture des bordels en 1946.
Se présentant comme une héroïne de la Résistance, elle fut démasquée plus tard comme un imposteur
— en fait une ancienne prostituée et collaboratrice qui avait fourni des femmes aux Nazis.
lien
© Musée de l'Érotisme, Paris • Paris pour les pervers
Une “vieille tige”
Après les plaisanteries d’usage des courriéristes (ne pourrait-elle pas refuser son prix ?… ou l’échanger contre le Goncourt de M. Julien Gracq ?), on se mit à table. Et Marthe Richard raconta sa vie.Chevelure blond platine et Légion d’honneur sur le canapé d’astrakan, elle évoqua le temps où, sous son nom de Marthe Bettenfeld, elle tenait, avec Védrinnes, le manche à balais des “cages à poules” (elle fut la quatrième femme à obtenir son brevet de pilote) et où, en 1913, elle menait en quinze jours, par étapes, son G3 Caudron du Crotoy à Zurich.
Elle offrit un penser fugitif au bel attaché naval allemand de l’ambassade madrilène qu’elle conduisit à sa perte en même temps qu’elle réduisait à néant l’offensive sous-marine du Kaiser.
“Ce n’est pas moi !”
Enfin, elle entra dans le vif du sujet : “Il y a malentendu, dit-elle, lorsque l’on m’attribue la fermeture des maisons de tolérance. Je n’ai été qu’un instrument entre les mains de Léo Hamon (aujourd’hui sénateur) et de Mme Lefaucheux, chefs de mon groupe de Résistance.Aujourd’hui, je sens que j’ai eu tort contre tous : qu’on les ouvre puisque tout le monde le veut.
“Cependant, je tiens à dire que je ne cède pas aux menaces. Aux lâches qui m’ont menacée de mort par téléphone, j’ai dit :
“Si vous voulez me tuer, tuez-moi, mais ne me téléphonez pas”.
“Je me retire”
“D’ailleurs, je ne veux plus entredre parler de tout ça. Je pars me reposer chez des amis à Vacalaire, et puis je veux me retire, ne plus écrire. Peut-être achèterai-je à Manchester le magasin d’antiquités que l’on me propose. Peut-être ferai-je de l’élevage…”Tandis que Marthe Richard pointait son regard vers l’avenir, Jean d’Halluin (éditeur du Scorpion) se félicitait de cette annexion qui faisait passer dans son camp cet ancien pilier du Cartel d’Action Morale.
Jean Carlier
Combat, 1er janvier 1952, p. 1 et 3.
Mariage de Loulou FELES et Marthe RICHARD Castellane 1947
Pour en savoir plus :
Elizabeth Coquart Marthe Richard, de la petite à la grande vertu. - Paris, Payot, 2006, 297 pages, 20 euros
Prostituée, devenue aviatrice puis femme politique, son nom est lié à la loi sur la fermeture des « maisons closes » en avril 1946
Marthe BETENFELD veuve RICHER Henri, veuve CROMPTON Thomas connue sous le pseudonyme de
Marthe RICHARD
née le 15 avril 1889 à 23 heures (11 heures du soir) à Blâmont Meurthe et Moselle 54 sa sœur jumelle Berthe est née le même jour, à 23 heures 30
Décédée le 9 février 1982 à Paris, inhumée au cimetière du Père-Lachaise
Préférant la prostitution à sa misérable vie d’ouvrière, elle échappe à cet esclavage grâce à l’amour d’un industriel fortuné, Henri Richer Issue d’une famille modeste, elle devient apprentie-culottière à 14 ans, mais comme ce métier ne lui plaît pas, elle fugue de chez ses parents. Interpellée par la police des mœurs pour racolage, elle est ramenée dans sa famille.
Mais elle fugue de nouveau à 16 ans et on la retrouve inscrite sur les registres de la prostitution à Nancy dès le 21 août 1905.
Dans cette ville de garnison militaire, tombée amoureuse d’un italien proxénète, elle devient prostituée dans les bordels à soldats. Comme elle doit effectuer plus de 50 passes par jour, elle tombe malade et contracte la syphilis. Dès lors, virée du bordel et fichée par la police, elle s’enfuit à Paris.
C’est là qu’un soir de septembre 1907, dans une maison close d’un bon standing, elle rencontre un riche client, l’industriel Henri Richer, mandataire aux Halles.
Il a le coup de foudre et bien vite Marthe oublie son passé et devient respectable bourgeoise dans son hôtel particulier de l’Odéon. Elle l’épousera le 13 avril 1915 dans la mairie du 16e.
Désormais riche, Marthe découvre la passion de voler Dans cette période, où l’aviation en plein essor passionne les foules lors des innombrables meetings, Marthe et Henri découvrent le plaisir de voler et s’inscrivent, tous deux, à l’école de pilotage de Villacoublay à partir de janvier 1913. Henri renonce vite, alors que Marthe obtient son brevet de pilote sous le n° 1369, le 7 juin 1913. Toujours grâce à la bienfaisante fortune de son amant, elle expérimente aussi les joies de l’aérostation mais l’aviation demeure sa véritable passion.
Elle se blesse grièvement, lors d’un atterrissage le 31 août 1913 et à l’issue d’un coma de 3 semaines, elle en gardera des séquelles, notamment la stérilité. En ce printemps 1914, la guerre s’annonce mais Henri Richer, noceur invétéré, entraîne Marthe dans ce Paris noctambule qui s’amuse et s’étourdit frénétiquement jusqu’à l’aube, pour oublier les rumeurs de la Grande Guerre qui s’annonce.
Un tout nouveau Caudron G3, permet à Marthe de reprendre son entraînement dès le 5 février 1914 et de participer au meeting de Zurich.
Ne parvenant pas à être aviatrice combattante, elle se lance dans l’espionnage grâce à son amant « Zozo » A la déclaration de guerre, Marthe veut s’engager dans l’aviation, comme les autres femmes de la Ligue de l’Union patriotique des aviatrices, mais aucune n’y parvient. Devenue veuve de guerre le 25 mai 1916, mais riche, jeune et belle, elle ne cesse de traîner autour des aérodromes, avec des airs de patriote épleurée, pour se faire enrôler comme aviatrice combattante, mais en vain.
Grâce à son amant Joseph Davrichewy dit « Zozo » (né le 28 octobre 1882 à Gori), elle devient espionne célèbre, sous le pseudonyme de Marthe Richard pour le compte du Service de Centralisation du Renseignement. Cet émigré russe géorgien a, lui aussi, connu un destin insolite puisqu’élevé en compagnie d’un autre Joseph, Staline lui-même ! Ainsi de Juin 1916 à octobre 1917, elle est agent secret en Espagne.
Elle se console d’un 2e veuvage par une vie mondaine et se bâtit un destin « d’héroïne » en publiant « Ma vie d’espionne au service de la France » Le 15 avril 1926, elle se marie avec Thomas Crompton, directeur financier de la fondation Rockfeller.
Marthe a le confort financier mais elle doit mettre entre parenthèses son goût pour la fête et sa passion pour l’aviation, car ce britannique préfère les soirées guindées et les plaisirs casaniers.
Il décède le 12 août 1928 et, du même coup, libérée des entraves conjugales, elle mène grand train à Bougival et passe ses soirées dans les boîtes à la mode. Ce qui lui vaut le surnom de « veuve joyeuse ».
Femme calculatrice et fantasque, scandaleusement libre pour son époque, Marthe reprend sa vie publique. Profitant de sa notoriété, elle n’hésite pas à s’inventer, devant les journalistes, une enfance dorée et défendant un profil de femme au foyer vertueuse. Elle devient soudain une héroïne médiatisée par son best-seller sur sa vie d’espionne, qui se révèlera être pure affabulation et les hauts faits racontés dans ses mémoires, pures romances. Mais à l’époque, c’est grâce à son amant Edouard Herriot, chef du gouvernement de l’époque, qu’elle obtient la Légion d’Honneur, le 17 janvier 1933.
Le 8 avril 1935, elle obtient le brevet d’aptitude et la licence de pilote d’avions de tourisme. En femme égoïste et pressée, il s’agit, pour elle, de tromper la monotonie et l’ennui. Délaissant l’idéal projet d’être chantre de la libération féminine, elle est retenue pour sillonner les airs et les salles de conférences pour une propagande en faveur de l’aviation et des aviateurs. Pour cela en octobre 1935, le ministère de l’Air lui prête, un temps, un avion.
A nouveau « héroïne » pendant la Seconde Guerre, elle devient, en 1945, élue de la Résistance Pendant la Seconde Guerre Mondiale, de juin 1940 à décembre 1942, elle séjourne à Vichy et se rapproche de certains membres de la Gestapo. Mais le 23 décembre 1942, elle est expulsée avec interdiction de séjour dans les départements de l’Allier et du Puy-de-Dôme.
Elle se forge un destin de grande résistante qu'elle racontera dans ses Mémoires « Mon destin de femme », en 1974.
En 1945, « héroïne des deux guerres », elle est élue au conseil municipal de Paris 4e, sur la liste de la Résistance Unifiée (proche du MRP). Ses hauts faits de résistance, même mentionnés sur des documents officiels, rencontrent beaucoup de scepticisme par trop de contradictions troublantes.
Œuvrant pour la fermeture des maisons closes, cela lui vaut le surnom de « la veuve qui clôt »
(selon l’écrivain Antoine Blondin, par référence à la célèbre maison de champagne)
Marthe dépose le 13 décembre 1945, devant le conseil municipal un projet pour la fermeture des maisons closes. Sa proposition est votée et le préfet fait fermer les maisons du département de la Seine, dans les 3 mois. Encouragée, Marthe Richard commence une campagne de presse pour le vote d'une loi généralisant ces mesures. En 1951, elle fonde un prix de littérature érotique, le prix Tabou.
En 1974, elle sort un livre « Mon destin de femme ».
Elle fait des conférences sur sa « vie d'espionne » et meurt
à 93 ans en 1982 à son domicile
sources
http://janinetissot.fdaf.org/jt_richard.htm
Frédéric Lewino et Gwendoline Dos Santos
Cinq ans après "sa" loi, Marthe Richard demande la réouverture des maisons closes et propose des putes fonctionnaires.
13 avril 1946.
À la demande de l'ex-prostituée Marthe Richard, le Parlement fait fermer les bordels.
Le 13 avril 1946, après une longue bataille entre les tenanciers de bordels et les "abolitionnistes", le Parlement vote la fermeture des maisons closes.
Les braguettes sont en deuil, DSK saisit les Nations unies.
Il est soutenu par un grand nombre de députés et de sénateurs ayant leurs habitudes au Sphinx, au One Two Two ou encore au Chabanais, célèbres lupanars parisiens. Pour autant, il leur est difficile de contrer la campagne abolitionniste menée tambour battant par Marthe Richard encensée par les Français.
Elle s'est adroitement bâti une image d'héroïne de la Première Guerre, de grande aviatrice et, surtout, de résistante magnifique durant la Seconde Guerre mondiale. Du pipeau !
Ce n'est qu'une affabulatrice ayant commencé dans la vie comme "viande à soldats", tapinant autour de la caserne de Nancy à un âge où les petites filles jouent encore à la poupée. Hormis Zahia, bien évidemment...
À 16 ans, en 1905, elle est déjà fichée par la préfecture comme étant une prostituée. Sa vie est un long fleuve de mensonges ignorés par les partisans de la fermeture des maisons de tolérance, qui pensent prendre une "héroïne" comme porte-drapeau. Après avoir consulté Cahuzac, Marthe accepte la mission. L'ancienne prostituée veut être la Jeanne d'Arc boutant la prostitution hors de France !
"Veuve qui clôt"
Première étape : fermer les maisons closes parisiennes. À l'époque, Marthe est membre du conseil municipal de la ville de Paris. Le 13 décembre 1945, elle prend la parole devant l'Assemblée : "Il est temps de lutter contre l'exploitation commerciale de la prostitution. Les femmes ne sont pas des esclaves... Supprimons les maisons de tolérance ainsi que la police des moeurs, luttons contre le marché des femmes..."
Il faut savoir qu'au lendemain de la guerre la capitale compte 190 maisons de tolérance ou de rendez-vous autorisées, qui fournissent du boulot à plus de 1 500 femmes. Au terme d'un débat houleux, le préfet de la Seine finit par promettre la fermeture desdites maisons closes d'ici à trois mois dans ce département.
Ce premier succès encourage Marthe à poursuivre une virulente campagne dans la presse pour que la mesure soit étendue à l'ensemble du territoire. Nouvelle victoire pour l'ancien "pain de fesse" puisque, le 13 avril 1946, c'est au tour de l'Assemblée nationale d'adopter la loi n° 46 685 "tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme", plus connue sous le nom de loi Marthe Richard.
Bien qu'elle ne soit pas députée, elle pavoise. Dans cette loi, il y a un article qui l'intéresse plus que tous les autres : c'est l'article 5 qui ordonne la destruction du fichier national de la prostitution où son nom figure encore ! Depuis le temps qu'elle voulait l'en voir rayé ! Cette victoire devant l'Assemblée nationale lui vaut le doux surnom de la "Veuve qui clôt". Les amateurs de contrepèteries et de champagne comprendront.
"Né polygame"
Curieusement, la presse de l'époque se fait peu l'écho de cette décision, ce qui n'empêche pas les nombreux habitués des maisons closes d'être désespérés.
Les tenanciers de lupanars ont six mois pour mettre la clef sous la porte, à moins de convaincre les députés de faire machine arrière, ce qu'ils espèrent toujours. Ils créent une Amicale des maîtres d'hôtel, chargée de concevoir un argumentaire listant les bonnes raisons pour lesquelles l'homme a besoin de fréquenter un établissement de prostituées.

En voici un extrait :
1 - La nature même de l'homme, né polygame ;
2 - les besoins sexuels de l'adolescent pendant la période partant de la puberté jusqu'au mariage ;
3 - les veufs ayant des enfants et ne désirant pas se remarier ;
4 - les célibataires, déshérités physiques, mutilés de guerre, sourds-muets, aveugles, culs-de-jatte, etc.
5 - les hommes mariés dont la femme, pour raison de santé ou par suite d'opération, ne peut avoir de rapports et qui, par conséquent, ne peuvent prendre de maîtresse sans courir le risque de désunir leur foyer ; résultat : mauvais ménage, divorce, drames conjugaux... ;
6 - les sadiques qui trouvent dans les maisons d'illusion les sensations recherchées.
Mais rien n'y fait. La loi est appliquée.
Les maisons de tolérance ferment toutes, jetant des milliers de prostituées sur le trottoir, où elles poursuivent leur sacerdoce mais en l'absence de tout contrôle sanitaire. Le beau progrès. Même Marthe Richard est obligée de convenir que l'abolition des maisons closes est une belle connerie.
En 1951, elle propose leur réouverture, sous certaines conditions : "C'est au grand jour que doit s'organiser la prostitution nouvelle. Les maisons sont nécessaires, soit, mais ce seront des établissements ouverts, dont les pensionnaires, devenues des travailleuses sociales, prendront rang de fonctionnaire et retrouveront, avec la conscience de leur dignité, leur place dans l'État !"
Bien sûr, elle ne sera jamais entendue. Le sel de cette histoire, c'est que Marthe Richard n'aurait jamais dû siéger au conseil municipal de Paris car, lors de son élection, elle était devenue anglaise par mariage !
Tous les votes auxquels elle avait pris part auraient dû être annulés ! Y compris celui sur la fermeture des maisons closes.

Frédéric Lewino et Gwendoline Dos SantosARTICLE "HISTORIQUE" et ne doit en aucune façon être la cible de commentaires doûteux...
 votre commentaire
votre commentaire
-

Le Chabanais était l'une des maisons closes les plus connues et les plus luxueuses de Paris entre 1878 et 1946, date à laquelle les maisons closes devinrent illégales en France.
Ici se trouvait Le Chabanais, une des maisons closes les plus connues et les plus luxueuses de Paris entre 1878 et 1946, date à laquelle les maisons closes devinrent illégales en France.
Aujourd'hui encore, le mot "Chabanais" est synonyme d'orgie bruyante et tumultueuse. Mais, jusqu'à la drôle de guerre, il servit à désigner la plus luxueuse des maisons de tolérance parisienne, le carrefour de l'amour international.
On y conservait pieusement le fauteuil articulé qui permettait au Roi Edouard VII de suivre malgré sa corpulence, avec sa partenaire, les conseils acrobatiques du Kama-soutra...
On y admirait aussi des salons chinois, japonais, hindous, arabes avec plaisirs appropriés, costumes de style et musiques folkloriques...
- L'Amour à Paris par Arrondissement, Jacques Morlaine et Guy de Bellet, 1

Le salon Louis XV du Chabanais. Le bordel était connu pour ses «chambres de fantaisie» satisfaisant tous les goûts. Les clients pouvaient choisir entre la salle Pompéi, la chambre japonaise, le salon Louis XV, la chambre eskimo, la chambre pirate, entre utr. «Dirty Bertie» (le Prince de Galles)
prisait la chambre hindoue.
lien photo
http://www.slate.fr/portfolio/39883/22
©Galerie Au Bonheur du Jour, Paris • Paris pour les pervers
Histoire du Chabanais
Fondé par Madame Kelly en 1878, le Chabanais était situé dans un immeuble discret au n°12 rue Chabanais, non loin du Palais-Royal. Le personnel de la maison comptait entre 20 et 35 pensionnaires de qualité soigneusement sélectionnées.
Fréquenté par les membres du Jockey Club, il accueillit de nombreuses personnalités, dont le futur roi Edouard VII qui fit construire sur mesure une baignoire en cuivre et un fauteuil à étriers métalliques.
Le Chabanais connaît son heure de gloire le soir du 6 mai 1889, jour de l'inauguration de l'Exposition universelle, accueillant des ministres et ambassadeurs du monde entier. Sur leurs agendas,
cette « virée » était renseignée « visite au président du Sénat ».

Les visiteurs illustres
De très nombreuses personnalités fréquentèrent le Chabanais.
C'était une étape obligée des hôtes de marque prestigieux qui venaient découvrir Paris à la Belle Époque, hommes d'états, diplomates, ministres, hauts fonctionnaires.
Outre les membres du très sélect Jockey Club qui le fréquentait régulièrement, notons :
- Le futur Edouard VII, surnommé « Bertie », par ses favorites
- Jagatjit Singh, Maharajah de Kapurthala, princier des Indes britanniques.
- Les écrivains Pierre Louys et Guy de Maupassant
- Le comédien américain du cinéma muet Roscoe Arbuckle connu pour L'affaire Roscoe Arbuckle
- Marlène Dietrich au bras d'Erich Maria Remarque

Les Chambres :
En 1880, l’aménagement du Chabanais coûta un million sept cent mille francs. Les décors de ses chambres étaient invraisemblables, et le monde entier se bousculait pour découvrir cette maison de passe de légende.
Le Chabanais reçut un prix pour sa « chambre japonaise » lors de l’Exposition Universelle de 1900. On y trouvait la chambre Louis XV, la Chambre Hindoue, la Directoire, la Médiévale et la Chambre Mauresque.

L'ensemble des décors de l’hôtel furent dépouillés et vendus après sa fermeture en 1946, et à l'occasion d'une vente aux enchères d'anthologie en 1951.
Préservée du bruit de la ville, profitant de l'aura bucolique du Palais Royal tout proche, la petite rue Chabanais a le charme tranquille de ses voisines du quartier Vivienne : Rameau et les Petits-Champs.
Des façades beiges à 5 étages (chambres de bonnes comprises), quelques cafés (dont le plus ancien bar lesbien de la capitale, le Champmeslé, au numéro 2), des restaurants japonais, des passants pressés ou des touristes égarés à la recherche du Musée du Louvre.
Rien qui ne laisse soupçonner que cette voie, ouverte en 1773 par le Marquis de Chabanais, fut l'un des hauts lieux du Paris mondain et nocturne de la Belle Epoque et des Années folles.
Le passage obligé de tout diplomate, artiste, chef d'Etat amateurs de prostitués
« trois étoiles » et de fantasmes exigeants.
Luxe et volupté
Au numéro 12, la petite porte anodine abrite pourtant les rares vestiges de la maison close la plus fréquentée de Paris, l'illustre et fantasque hôtel du Chabanais, fermé en 1946 par la loi Marthe Richard.Son escalier en fer forgé et ses deux ascenseurs ont résisté au temps, depuis leur création en 1878.

L’escalier à l’entrée du numéro 12 rue Chabanais, autrefois le bordel le plus luxueux d’Europe. Le hall d’entrée fut dessiné comme une grotte magique souterraine, avec une cascade et un panneau où était inscrit:
«WELCOME TO LE CHABANAIS, HOUSE OF ALL NATIONS.»
Il est révélateur que le panneau ait été rédigé en anglais.
lien photo
©Galerie Au Bonheur du Jour, Paris • Paris pour les pervers
http://www.slate.fr/portfolio/39883/21

L’intérieur du numéro 12 rue Chabanais aujourd’hui. L’escalier est d’origine, ainsi que l’ascenseur. Il y avait deux ascenseurs synchronisés, un qui montait pendant que l’autre descendait, pour éviter que les clients soient embarrassés par des rencontres inopportunes.
lien photo
© Tony Perrottet • Paris pour les pervers
À l'époque, ils étaient synchronisés :
l'un pour monter, l'autre pour descendre, afin d'éviter les rencontres gênantes.
Au numéro 12, les belles manières sont de rigueur mais les tabous restent sur le pas de la porte. Pour 100 francs (500 euros actuels), toutes les excentricités sont permises.En commençant par le décor. Mélange des genres, surenchères d'ornements, marbre, or et stuc,
les salons Louis XV ou pompéien – paré d'une fresque mythologique de Toulouse-Lautrec – rivalisent d'un éclat poli au stupre.
Les chambres portent des noms exotiques:
la « russe » avec sa baignoire en mosaïque,
la « japonaise » au parfum d'encens, primée lors de l'exposition universelle de 1900,
la « pirate », dont les hublots sont régulièrement éclaboussés d'eau pour un dépaysement garanti...
Si le Chabanais avait été aménagé en 2012, il aurait couté 8,7 millions d’euros ! Une extravagance que seule la Belle Epoque pouvait se permettre.
Hôtes de marque :
L'entrée en forme de grotte, type caverne d'Ali Baba, réservait son sésame aux grands de ce monde, comme les membres du prestigieux Jockey Club.Les secrets d'alcôve racontent que Pierre Louys y trouve son inspiration pour son roman érotique Aphrodite, que Guy de Maupassant vient y soigner ses crises d'inspiration et que le Prince de Galles Edouard VII, habitué des lieux, privilégie la chambre hindoue (et son plafond à miroirs) pour ses rencontres érotiques.
Ce dernier, surnommé Dirty Bernie par ses favorites, fait construire en 1900 une baignoire à champagne en cuivre, ornée d'une sphinge, et une chaise « à volupté », munie d'étriers métalliques pour faciliter les trio amoureux.

On raconte aussi, qu'un soir du 6 mai 1889, pour l'inauguration de l'exposition universelle, le Chabanais accueille tous les ministres et ambassadeurs présents à Paris, sous couvert d'une visite au président du Sénat...
Aujourd'hui, la galerie d'art érotique Au bonheur du jour, installée au numéro 11 de la rue Chabanais, préserve en quelque sorte la mémoire du lieu. Sa propriétaire, auteur d'un ouvrage sur les maisons de tolérance, accumule les curiosités en tout genre.
Et même si la vente aux enchères de 1951 a dispersé le mobilier du Chabanais – la baignoire d'Edouard VII est achetée en seconde main par Dali et sa chaise passe outre-atlantique –, elle pourra vous trouver, à coup sûr, un petit souvenir galant de la Belle Epoque.

L'occupation allemande
Le Chabanais fit partie des cinq maisons closes parisiennes les plus réputées pour leur luxe et le choix de leurs prestataires féminines à Paris.


Marthe Richard, qui mena la campagne pour la fermeture des bordels en 1946.
Se présentant comme une héroïne de la Résistance, elle fut démasquée plus tard comme un imposteur — en fait une ancienne prostituée et collaboratrice qui avait fourni des femmes aux Nazis.
lien
© Musée de l'Érotisme, Paris • Paris pour les pervers
Elle est donc réquisitionnée pour le plaisir et « l'après-travail » des officiers du Reich en 1940, avec le One-two-two, le Sphinx, « La Rue des moulins » et enfin
« Chez Marguerite ».

La vente aux enchères de 1951
Cette vente aux enchère extraordinaire conduite
par Maurice Rheims, le 8 mai 1951, permit au public d’admirer les pièces de mobilier et le matériel du Chabanais.
Par exemple, la fameuse « chaise de volupté » d’Édouard VII, fabriquée par Louis Soubrier, artisan ébéniste de renom de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, ou encore sa fameuse baignoire à champagne de cuivre rouge, ornée d’une sphinge.
Cette baignoire fut achetée 110 500 francs par un antiquaire de la rue Jacob, avant de devenir un objet publicitaire d’un fabriquant de meuble du boulevard Montmartre.
Finalement, elle fut acquise en 1972 par des admirateurs de Salvador Dalí, qui lui en firent don et l’installèrent dans sa chambre de l’hôtel Meurice.
Un lupanar, synonyme de maison close, est un établissement offrant le service de prostituées. Plus discret que son synonyme populaire bordel, ce terme est plutôt utilisé par les Européens francophones.
 Située au 12 rue Chabanais, la plus célèbre maison close de la capitale se dissimulait dans un immeuble discret. Fondée en 1878 par Madame Kelly, elle réunissait entre 20 et 35 pensionnaires triées sur le volet pour recevoir une clientèle huppée et exigeante.
Située au 12 rue Chabanais, la plus célèbre maison close de la capitale se dissimulait dans un immeuble discret. Fondée en 1878 par Madame Kelly, elle réunissait entre 20 et 35 pensionnaires triées sur le volet pour recevoir une clientèle huppée et exigeante.
Mademoiselle Margot, une des gloires du Chabanais» par un photographe
anonyme vers 1900. Prise dans le bordel de luxe Le Chabanais.lien photo :
http://www.slate.fr/portfolio/39883/6
Riches bourgeois, célébrités et têtes couronnées assouvissaient entre ses murs des fantasmes qui nécessitaient accessoires et mises en scènes.966.


Le Chabanais vers 1940 En 1880, l’aménagement de ce paradis artificiel coûta un million sept cent mille francs. Célèbre pour l’invraisemblable décor de ses chambres, le Chabanais reçu même un prix pour sa « chambre japonaise » lors de l’Exposition Universelle de 1900.
En 1880, l’aménagement de ce paradis artificiel coûta un million sept cent mille francs. Célèbre pour l’invraisemblable décor de ses chambres, le Chabanais reçu même un prix pour sa « chambre japonaise » lors de l’Exposition Universelle de 1900. Le célèbre fauteuil d’amour du Roi Édouard VII, photographié en
Le célèbre fauteuil d’amour du Roi Édouard VII, photographié en
1951, avant qu’il n’entre dans une collection privée. «Dirty
Bertie» fit construire l’appareil pour qu’il n’écrasât
pas les prostituées de son énorme corpulence.lien photo
http://www.slate.fr/portfolio/39883/8
On y trouvait aussi la chambre Louis XV, la Chambre Hindoue, la Directoire, la Médiévale ou la Chambre Mauresque…On imagine la perte pour les arts décoratifs de style Second Empire lorsque l’hôtel fut dépouillé de son décor après sa fermeture. Durant ses 70 ans d’existence le célèbre bordel compta de nombreux habitués dont Pierre Louÿs, Maupassant, Anatole France ou le comique Fatty Arbuckle, ainsi qu’une clientèle féminine dont Marlène Dietrich au brasd’Eric Maria Remarque…Tout ce que l’Europe comptait de "grands" hommes de passage à Paris visita l’établissement.On raconte que lorsqu’un hôte de marque désirait visiter les lieux, son programme officiel mentionnait :« Visite au président du Sénat ».
Durant ses 70 ans d’existence le célèbre bordel compta de nombreux habitués dont Pierre Louÿs, Maupassant, Anatole France ou le comique Fatty Arbuckle, ainsi qu’une clientèle féminine dont Marlène Dietrich au brasd’Eric Maria Remarque…Tout ce que l’Europe comptait de "grands" hommes de passage à Paris visita l’établissement.On raconte que lorsqu’un hôte de marque désirait visiter les lieux, son programme officiel mentionnait :« Visite au président du Sénat ». La rue Chabanais, près du Louvre et de la Bibliothèque Nationale sur
La rue Chabanais, près du Louvre et de la Bibliothèque Nationale sur
la rive droite, autrefois la rue la plus chic du demi-monde parisien.lien photo© Tony Perrottet • Paris pour les pervershttp://www.slate.fr/portfolio/39883/20Un membre du protocole ne comprit pas l’allusion et plaça un jour cette visite sur le programme de la reine mère d’Espagne. On du en catastrophe organiser une véritable visite au président du Sénat, qui n’en demandait pas tant ! Le plus fameux de ses client reste toutefois Edouard VII, alors qu’il n’était encore que prince de Galles.De nombreuses caricatures le représentaient avec « ses dames » du Chabanais, où il avait fait installer un mobilier personnel et… particulier.
Le plus fameux de ses client reste toutefois Edouard VII, alors qu’il n’était encore que prince de Galles.De nombreuses caricatures le représentaient avec « ses dames » du Chabanais, où il avait fait installer un mobilier personnel et… particulier.
Dans une grande baignoire de cuivre rouge ornée d’une sphinge aux attributs déployés, le futur roi barbotait dans du champagne Mumm cordon rouge tout en se faisant dorloter. Acquise plus de 100 000 francs par un antiquaire lors de la vente aux enchères qui dispersa le mobilier en 1951, cette baignoire fut finalement rachetée par des admirateurs de Salvador Dali qui l’offrirent au peintre en 1972.
Acquise plus de 100 000 francs par un antiquaire lors de la vente aux enchères qui dispersa le mobilier en 1951, cette baignoire fut finalement rachetée par des admirateurs de Salvador Dali qui l’offrirent au peintre en 1972. lienhttp://bernardperroud.com/2012/05/24/le-chabanais/Le peintre l’installa dans sa suite de l’hôtel Meurice, y fit installer un appareil téléphonique et la faisait remplir de fleurs.
lienhttp://bernardperroud.com/2012/05/24/le-chabanais/Le peintre l’installa dans sa suite de l’hôtel Meurice, y fit installer un appareil téléphonique et la faisait remplir de fleurs.
Autre meuble célèbre due à l’imagination d’Edouard VII, cette chaise« de volupté » fabriquée spécialement par Soubrier, un artisan du faubourg Saint-Antoine.Je vous laisse en imaginer l’usage. Comme ses semblables Le Sphynx, le One Two Two ou la Fleur Blanche, le Chabanais ferma ses portes en 1946.On peut encore visiter le hall et apercevoir l'escalier et sa belle rampe en fer forgé, ainsi que les deux ascenseurs, l'un pour monter, l'autre pour descendre, destinés à éviter les rencontres gênantes.
Comme ses semblables Le Sphynx, le One Two Two ou la Fleur Blanche, le Chabanais ferma ses portes en 1946.On peut encore visiter le hall et apercevoir l'escalier et sa belle rampe en fer forgé, ainsi que les deux ascenseurs, l'un pour monter, l'autre pour descendre, destinés à éviter les rencontres gênantes.
En savoir plus surhttp://www.paperblog.fr/3366462/le-chabanais-haut-lieu-de-la-galanterie/#2FEGiGFPURdUJEMg.99
lien photo© Tony Perrottet • Paris pour les pervershttp://www.slate.fr/portfolio/39883/20http://bernardperroud.com/2012/05/24/le-chabanais/Bonjour,
Vous pouvez me laisser un
commentaire, un message,
cher visiteur.. ...
vous qui venez à pas de velours lire mes articles sur Paname..
ces articles Historiques, retracent une certaine "VIE PARISIENNE LEGERE"
et ne doivent en aucune manière, être la cible de propos, commentaires,
doûteux.
 votre commentaire
votre commentaire
-
1807
Saint Denis sur la butte Montmartre.
Mons Martyrum ou Mons Martis ?

La butte Montmartre doit vraisemblablement son nom à un Mons Martis (Mont de Mars), référence à un temple dédié au dieu Mars qui, à l’époque gallo-romaine, se dressait à l’endroit qu’occupe actuellement l’église Saint-Pierre.
On y trouvait aussi un temple dédié à Mercure. Mais selon une légende chrétienne tenace, Montmartre devrait son nom au martyr du premier évêque de Paris, saint Denis, et de ses deux acolytes, Eleuthère et Rustique, d’où Mons Martyrum
(Mont des Martyrs).

Cette tradition fut fixée au 9e siècle par Hilduin, abbé de Saint-Denis, de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Médard de Soissons, et auteur d’une Vita sancti Dionysii (Vie de saint Denis (rédaction : 835-840), dont le nom latin rappelle celui du dieu grec Dionysos, comme on peut le constater).

La tradition « montmartroise » de saint Denis avait cours depuis le 6e siècle (alors que certaines sources prétendent que le saint aurait pu être exécuté sur l’Île de la Cité !), mais Hilduin ne précise ni le lieu exact, ni la date, même approximative, du supplice. Une charte du roi Robert reprendra bien la version de l’abbé de Saint-Denis, cette histoire n’en appartient pas moins, de toute évidence, au domaine de la légende.

Il est probable que Hilduin ait joué sur le rapprochement des termes Martis et Martyrum, pour y situer le martyr de saint Denis,à moins que le nom du « Montmartre » du 9e siècle, faisait déjà, tout simplement, référence à des martyrs, mais sans autre précision.

Cela devait permettre, comme nous allons le voir, de justifier quelques acquisitions de terrains.

Le Sanctum Martyrium.
La présence, sur la butte, de deux oratoires dédiés à saint Denis est attestée. L’un d’eux est cité vers le 8e siècle, par certains textes d’époque. Au siècle suivant, il eut vraisemblablement à souffrir des attaques des Vikings, lors du siège de Paris et subit d’importants dommages matériels.
En 944, l’église fut semble-t-il abattue par un ouragan.
Toutefois, la charte d’un certain Bouchard de Montmorency, la signale encore, en précisant que cet édifice religieux, situé sur la montagne, avec l’autel, le sanctuaire, le cimetière et un terrain environnant, est compris dans son bénéfice.

Mais c’est un autre oratoire, celui qui, selon certains témoignages, aurait existé sur la butte « de toute antiquité »,
qui nous intéresse plus particulièrement ici.

La tradition montmartroise de saint Denis, que Hilduin devait transmettre à la postérité, servit vraisemblablement à justifier certaines acquisitions de terrains par l’abbaye royale de Saint-Denis (actuelle basilique Saint-Denis) :

le meilleur moyen pour justifier certaines convoitises sur la butte n’était-il pas d’en appeler au sang versé supposément à Montmartre par les martyrs Denis, Rustique et Eleuthère ?
Ainsi, lorsque le marché de l’abbaye de Saint-Denis se transporta entre 673 et 710 vers le pas de la chapelle, entre Saint-Martin et Saint-Laurent, ladite abbaye fit l’acquisition de ses premiers territoires montmartrois, avant d’étendre ses ambitions à toute la butte,
au nom du sang versé par les martyrs.
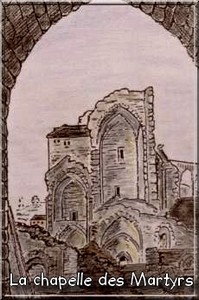
Ainsi, un texte du Cérémonial monastique de l’abbaye royale de Montmartre rappelle-t-il l’existence, « de toute antiquité », d’une chapelle, située sur le versant de la butte tourné vers Paris, qui, selon les dires des ecclésiastiques, aurait été érigée sur le lieu même où Denis fut exécuté, raison pour laquelle on donna à la chapelle le nom de Capella de Sancto Martyrio.
Il semble que la chapelle dont il est question ici soit le Sanctum Martyrium, cité par la charte de B. de Montmorency, mais en 1096 seulement.

Le sanctuaire, qui fut vraisemblablement érigé au 11e siècle donc, s’élevait semble-t-il à l’emplacement du n°9 de l’actuelle rue Antoinette. Sa très grande ancienneté et son attribution première à saint Denis paraissent toutefois relever de la légende.
Ayant appartenu originellement à des laïques, puis passé sous la juridiction du prieuré de Saint-Martin-des-Champs (et non de l’abbaye royale de Saint-Denis, comme on aurait pu s’y attendre), ce modeste sanctuaire paraissait bien peu digne de la célébrité du martyr qu’il était supposé honorer.

Si ce sanctuaire avait eu l’importance que d’aucuns lui ont prêté a posteriori, on imagine mal les moines de Saint-Denis le laissant tomber en des mains étrangères !
Mais l’humain, si souvent attiré par le merveilleux, ne se laisse que rarement convaincre par les mises en garde historiques.

Aussi ce lieu fit-il l’objet d’une grande vénération. Il reçut notamment la visite du pape Alexandre III, de Thomas d’Aquin et d’Ignace de Loyola. Tous les sept ans, les moines de l’abbaye royale de Saint-Denis venaient déposer processionnellement, à Montmartre, les reliques de leur saint patron.
Le sanctuaire fut toutefois totalement détruit, en 1598, durant les guerres de religions.

« Résurrection » du Martyrium : une crypte bien équivoque…
En 1559, un incendie avait également détruit une grande partie de l’abbaye des Bénédictines de Montmartre qui se trouvaient dès lors bien dépourvues et soumises à un impérieux besoin de monnaies sonnantes et trébuchantes.
En 1611, Marie de Beauvilliers, qui dirigeait alors l’abbaye, eut l’idée de faire restaurer le Martyrium, détruit treize années plus tôt, et de construire autour de la chapelle rénovée une nouvelle abbaye dite d’ « en bas », reliée à celle d’ « en haut » par une galerie longue et voûtée.
Et c’est là que se produisit un « miracle » bien opportun : on mit à jour un escalier conduisant à ce que l’on présenta bien vite comme étant l’ancienne crypte du sanctuaire d’origine. L’on prétendit y avoir découvert un autel rudimentaire, de même que des croix et des inscriptions gravées sur les murs (mais hélas bien vite effacées par l’afflux des visiteurs…).
La nouvelle ne tarda dès lors par à se répandre : une crypte venait d’être découverte ; pour certains, elle devait, à n’en pas douter, être un refuge des premiers chrétiens, pour d’autres, c’est à cet endroit précis que ce serait déroulé le martyr de saint Denis, pour d’autres encore, le lieu servit de cachette à Denis pour y servir la messe, et Marie de Médicis elle-même se rua sur le lieu de la découverte !
D’un point de vue historique, toutefois, rien ne vient étayer ces diverses thèses rocambolesques. Rien ne permettait de reconnaître avec certitude en ce lieu un monument antique. Une seule certitude, cette découverte réveilla la dévotion du peuple pour saint Denis et sa chapelle des Martyrs, et l’argent afflua dans les caisses des religieuses de Montmartre… La chapelle fut définitivement détruite en 1793, en même temps que le prieuré.
A son emplacement, s’élève aujourd’hui une chapelle moderne, sise au n°9 de la rue Antoinette. De l’abbaye des Dames de Montmartre ne subsiste que l’église Saint-Pierre dont le chœur servait de chapelle aux religieuses.
Saint Denis entre histoire et légende.
La prédication de saint Denis.

C’est donc vers l’an 250, si l’on en croit la légende, que sept évêques quittèrent Rome pour évangéliser les Gaules. Arrivé à Paris ou, plus précisément, à Lutèce, Denis aurait éprouvé bien des difficultés à intéresser les autochtones à ses discours. Mais à force de patience et de ténacité, il parvint à opérer, puis à multiplier les conversions, au point que les prêtres des cultes païens en prirent bien vite ombrage.
Aussi envoyèrent-ils des délégués à Rome pour réclamer l’intervention de l’empereur Domitien (on voit ici que les diverses légendes de Denis s’entrechoquent : Domitien vécut et régna au premier siècle et non au troisième ; en 250, nous sommes au début du règne de l’empereur Dèce). Dèce, donc, fait immédiatement marcher une armée sur Lutèce.
Il la confie au prévôt Sisinnius qui fait amener devant son tribunal Denis et ses deux acolytes, le prêtre Eleuthère et le diacre Rustique. Devant leur refus de se soumettre à l’empereur et de renier leur foi chrétienne, ils sont bien vite soumis à la torture. Mais rien n’y fait. On les jette donc en prison avec les nouveaux convertis.
Durant la nuit, le Christ apparut à Denis et lui administra la communion à travers les barreaux de la grille du cachot. Le lendemain, Sisinnius ordonna la mort de Denis et de ses deux acolytes, qui furent immédiatement décapités.
« Miracles » et origine d’un culte.
Mais alors, dit la légende, que les âmes des trois martyrs s’élevaient vers le ciel, le corps décapité de Denis s’anima, se leva, prit sa tête dans ses mains, et, soutenu par deux anges, s’éloigna. De Montmartre, il chemina jusqu’à un village nommé Catulliacum, qui devait prendre ultérieurement le nom de Saint-Denis. Il arriva bientôt à la maison d’une « prude femme » nommée Catulla qui reçut la tête sanglante des mains du martyr. Elle la déposa immédiatement dans un tombeau situé à proximité de sa demeure.
Laissons-là la controverse qui opposa jadis l’Eglise de Paris et les moines de l’abbaye de Saint-Denis, concernant les circonstances de la décapitation du saint, franche et brutale selon Paris, maladroite, selon Saint-Denis, et qui influença considérablement son iconographie, pour retenir que, comme on pouvait s’y attendre, les miracles se multiplièrent immédiatement après la mise en terre de Denis.
Ces miracles ne purent toutefois empêcher le massacre de nombreux chrétiens dans les alentours de Paris, et ce le jour même du martyre de saint Denis.
Et voilà comment Montmartre devint une terre sacrée, Grégoire XV allant jusqu’à accorder des indulgences à ceux qui embrasseraient avec respect le sol de la butte. On dit aussi que saint Denis ressuscita quelques heures pour accorder son pardon à son bourreau, un légionnaire gallo-romain rongé de remords et converti au christianisme. A noter que jadis, à Paris, on invoquait Denis pour les maux de tête ( !) et les morsures de chiens enragés.
Un mot sur Denis de Paris.
Que n’a-t-on dit et écrit sur saint Denis ? Personnage aux multiples facettes, on lui donne généralement trois identités, pourtant bien distinctes. Selon une première tradition, Denis ne serait autre que saint Denis l’Aréopagite, disciple direct de saint Paul.
Las, le disciple de Paul vivait au 1er siècle, alors que le Denis de Paris, lui, ne peut apparaître, au plus tôt, qu’au 3e siècle ! La thèse des origines athéniennes de Denis a pourtant longtemps conservé des adeptes. Selon une seconde tradition, Denis aurait été un missionnaire du pape saint Clément, évêque de Rome au 1er siècle.

Cette tradition rejoint la première et paraît, pour les mêmes raisons chronologiques, tout aussi invraisemblable. Enfin, une troisième tradition compte Denis au nombre des sept évêques qui, vers 250, vinrent de Rome pour évangéliser les Gaules. Pas plus convaincante, elle est exprimée par Grégoire de Tours
(539-594).
Avant cela, aucune trace de notre supposé missionnaire romain :
Denis aurait ainsi évangélisé au 3e siècle, mais sa légende, elle, n’apparaît qu’environ deux à trois siècles plus tard. Denis apparaît donc bien comme un personnage légendaire dont Hilduin, pour des raisons déjà évoquées, établira de fixer la légende, finalement parachevée, au 13e siècle, dans la « Légende dorée », par Jacques de Voragine.
Saint Denis à Paris et en Île-de-France.
La Seine-Saint-Denis.

Opérons d’abord une distinction entre l’enracinement historique de ce territoire et sa constitution récente en département. Le territoire de la Seine-Saint-Denis accueille une présence humaine depuis au moins 300.000 ans (on y a trouvé des outils en silex datés du paléolithique inférieur).

On y a également trouvé des campements préhistoriques, des traces d’activité agricole ancienne, puis des témoignages de son organisation en village gaulois, en agglomération gallo-romaine, en hameau médiéval, puis en village francilien. C’est une réalité enracinée de ce territoire que l’on évoque bien peu aujourd’hui, alors que l’actualité socialement difficile du département défraye, elle, régulièrement la chronique. Le département de la Seine-Saint-Denis a été créé le 1er janvier 1968, à partir de la partie nord-est de l’ancien département de la Seine.
Il reçut le code « 93 » qui, à l’origine, était dévolu au département de Constantine, dans l’Algérie française. Rappelons aussi le très beau nom des habitants de ce département : les Séquano-Dionysiens, double référence au peuple celtique des Séquanes (est de la Gaule) et au dieu grec Dionysos, bien que ces noms se rapportent plutôt respectivement à la « Sequana » (la Seine mais également la Saône) et à Denis.
A une époque où d’aucuns préfèrent se dire originaires du « quatre-vingt-treize »
ou du « neuf-trois », il est à craindre que ce vocable soit de moins en moins en usage…
La basilique Saint-Denis.

C’est en Seine-Saint-Denis que l’on trouve la nécropole des rois de France, en la basilique de Saint-Denis qui, comme nous l’avons vu, est largement liée à la légende de Denis de Paris. Selon la tradition, ce dernier aurait marché au supplice en parcourant des voies alors campagnardes qui devinrent la rue Saint-Martin, la rue Montmartre et la rue des Martyrs. Il aurait ensuite été décapité rue Antoinette, proche de la place des Abbesses, et ce serait ensuite miraculeusement relevé, pour emporter sa tête jusqu’au sommet de la butte.

L’ayant lavée à la fontaine jadis située impasse Girardon (ex-Saint-Denis), il aurait dévalé un sentier qui ne serait autre, aujourd’hui, que la rue du Mont-Cenis, pour aller déposer sa tête, comme nous l’avons vu, au village de Catulliacum, qui serait ensuite devenu le village de Saint-Denis. C’est là que devait être érigée l’abbaye royale de Saint-Denis qui usa largement de la légende de saint Denis pour justifier certaines de ses convoitises sur la butte Montmartre. L’église abbatiale porte toutefois le nom de « basilique » depuis l’époque mérovingienne. C’est au 4e siècle qu’un mausolée fut établi à cet endroit, soit sur le site d’un cimetière gallo-romain qui existait depuis le Bas-Empire.

C’est là que ce situe le maître-autel actuel. Vers 475, il est dit que sainte Geneviève acheta les terres situées aux alentours et fit construire une église, qui fut agrandie au cours des siècles suivants. Ce lieu jouit de tous temps d’un grand prestige. Si bien que l’on y inhuma nombre de personnages illustres, dont les corps de saint Denis et de ses deux acolytes, Eleuthère et Rustique. Dagobert Ier (602/605 – 638/639) fut le premier roi des Francs à être inhumé en l’église Saint-Denis. Suivi de Charles Martel, en 741, il fut rejoint, au cours des siècles, par bien d’autres monarques, tels que Hughes Capet, Philippe Auguste, Saint Louis, Philippe le Bel, François Ier, Catherine de Médicis, et une multitude d’autres personnages de la noblesse française.

Mais notons que la basilique, qui prit progressivement la forme gothique que nous lui connaissons encore aujourd’hui, fut également l’église du sacre des reines de France, dont ceux de Catherine et Marie de Médicis. Lors du saccage de l’église Saint-Denis par les révolutionnaires, en 1793, de nombreuses tombes furent profanées, et les cendres de 42 rois, 32 reines, 63 princes, 10 serviteurs du royaume, ainsi que d’une trentaine d’abbés et de religieux divers, furent jetées dans les fosses communes de l’ancien cimetière des moines, alors situé au nord de la basilique.

Une partie du trésor de la basilique fut transformée en monnaie, quant aux gisants, ils furent en grande partie détériorés. En 1805, Napoléon Ier fit notamment de la basilique un mémorial des quatre dynasties ayant régné sur la France. L’église fut réhabilitée sous Louis XVIII, en 1816, avant de se voir restaurée dans le courant du siècle. Ceci dit, malgré ces restaurations et des travaux entrepris il y a quelques années, la basilique continue à se dégrader.
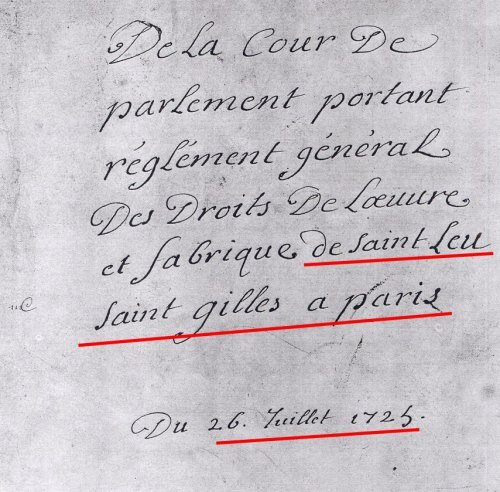
La rue Antoinette et la décapitation de saint Denis.
Juste un mot sur cette rue peu connue du 18e arrondissement, pour rappeler que, selon la tradition, c’est au niveau du n°9, que s’élevait le Sanctum Martyrium et qu’aurait été décapité saint Denis. Cela reste toutefois historiquement non-confirmé.
L’ancienne impasse et la fontaine Saint-Denis.
L’impasse Girardon, qui s’étend de l’avenue Junot au square Suzanne Buisson, se nommait jadis, et de manière bien plus judicieuse, l’impasse Saint-Denis. Au bout de cette impasse se trouvait une fontaine qui portait également le nom du saint décapité. Et, vous l’aurez deviné, c’est bien évidemment dans cette fontaine que, selon la légende, le corps de saint Denis aurait lavé sa tête ensanglantée. Avant d’être engloutie, en 1810, dans une carrière de plâtre, cette fontaine, originellement située au cœur d’un bois touffus, fit donc l’objet d’un grand nombre de pèlerinages.
 Rue St Denis
Rue St DenisElle prit notamment le nom de Fontaine du martyr ou des martyrs. L’eau de cette fontaine avait la réputation de guérir les fièvres :
« En 1641, le père Léon écrivait : « Du côté de la montagne qui regarde Saint-Ouen, sur la pente proche des trois moulins, il y a la montagne que le vulgaire nomme de Saint-Denys ; la tradition, de père en fils apprenant au peuple que le glorieux martyr s’y arrêta, portant sa tête entre ses mains, et qu’il laissa dans cette eau une vertu miraculeuse pour la guérison principalement des fièvres… »
(Guide de Paris mystérieux, p. 352). Selon une tradition nettement plus profane, l’eau de la fontaine de Saint-Denis aurait eu comme autre vertu de garantir aux époux la fidélité de leurs femmes, selon l’adage qui dit :
« Jeune fille qui a bu de l’eau de la fontaine Saint-Denis reste fidèle à son mari. »
(Guide de Paris mystérieux, p. 353).
La rue Saint-Denis.

A l’origine, la rue Saint-Denis, qui s’étend de la rue de Rivoli (1er arr.) au boulevard Saint-Denis (2e arr.) est une ancienne voie romaine conduisant à Saint-Denis, Pontoise et Rouen. Elle fut sans doute tracée au 1er siècle, même si selon d’autres sources, son tracé actuel remonterait à 750 et que ce ne fut qu’à la fin du 9e siècle qu’elle commença à être fréquentée. Son nom actuel fait évidemment référence au célèbre saint décapité de Paris. Très ancienne, cette rue fut pendant longtemps la plus longue, la plus belle et la plus riche de Paris, à tel point qu’au début du 12e siècle, elle supplanta la route qui conduisait à la foire du Lendit et, bien évidemment, à la basilique du bourg Saint-Denis, soit l’actuelle rue Saint-Martin. Elle devint un lieu de pèlerinage et de nombreux établissements religieux et chapelles s’établirent dans cette artère.
Au 14e siècle, elle porta le nom de Chaussée de Monseigneur Saint-Denis et elle fut la première rue pavée de Paris. Elle devint alors la voie triomphale qu’empruntaient les souverains lorsqu’ils entraient dans leur bonne ville de Paris pour se rendre à Notre-Dame. Sous la Révolution, elle fut rebaptisée « rue de la Franciade ». C’est aussi dans le rue Saint-Denis qu’avait été installé la Poste aux chevaux, et c’est donc de là que de nombreux voyageurs, arrivant à Paris par les voitures de poste, découvraient la ville. Le relais était établi à l’hôtel du Grand Cerf. Mais la rue Saint-Denis connut aussi une réputation sulfureuse, connue pour ses sex-shops et sa prostitution.
Tradition ténébreuse fort ancienne, puisque au n°237 l’on trouvait jadis, attenant le couvent les Filles-Dieu, deux passages nommés la cour Sainte-Catherine et la cour des Miracles.
« Ces passages menaient à un dédale de culs-de-sacs, de ruelles et de courettes adossées aux anciens remparts de Charles V, à l’emplacement de l’actuelle place du Caire. Les truands qui avaient trouvé là un maquis rêvé pour échapper aux rafles de la police, s’y installèrent à partir du XIIIe siècle.
Ils n’en furent chassés qu’en 1667, grâce à l’action énergique de Nicolas de La Reynie, lieutenant de police du roi. »
(Guide de Paris mystérieux, p. 643). C’est par ironie que l’on donna à ce quartier le nom de « cour des Miracles », de même que pour se moquer des mendiants qui contrefaisaient tous les estropiés connus pour extorquer quelque aumône…Les mendiants se prêtaient notamment à de fausses guérisons miraculeuses, sous les yeux d’une foule aussi naïve qu’admirative ! Mais lorsque ce quartier fut enfin assaini, cela réjouit tellement les habitants du voisinage que le quartier prit le nom de « bonne nouvelle » !
La rue du Faubourg Saint-Denis.
Dans le prolongement de la rue Saint-Denis, on trouve la rue du Faubourg Saint-Denis dont le tracé remonte sans doute à l’époque des derniers mérovingiens (750) et qui conduit tout droit à la basilique Saint-Denis. Elle doit son nom au fait qu’elle s’inscrit dans le prolongement de la rue Saint-Denis, mais à l’extérieur de l’ancien mur d’enceinte. Mistinguett a popularisé le faubourg en chantant Je suis née dans le faubourg Saint-Denis, bien qu’elle était elle-même native de Enghien-les-Bains.
Les marchandes des quatre saisons étaient jadis emblématiques du faubourg Saint-Denis, mais elles ont dû céder le pas devant la circulation automobile : on décréta un jour qu’elles gênaient le trafic…
Le boulevard Saint-Denis.
Ce boulevard a été tracé sur les ruines de l’enceinte de Charles V, abattue en 1660. Il constitue la section des Grands Boulevards comprise entre les portes Saint-Martin et Saint-Denis.
Il forme, en outre, la limite entre, d’une part, les 2e et 3e arrondissements au sud, et le 10e arrondissement, au nord.
La Porte Saint-Denis.

Il y eut plusieurs portes Saint-Denis à Paris.
La première (enceinte de Philippe Auguste) date du début du 13e siècle. Elle était située au nord du croisement où se rejoignent les rues Saint-Denis et Etienne Marcel. La seconde (enceinte de Charles V) fut bâtie au 14e siècle.
Elle se trouvait à hauteur de l’actuel n°248 de la rue Saint-Denis, au croisement avec la rue Blondel.
Cette porte servait à l’exposition des cadavres de certains condamnés et c’est ainsi qu’une partie du corps de Poltrot Méré, assassin de François de Guise, fut accroché à sa voûte.
C’est aussi là qu’en France, fut pendue la première femme.
Quant à la Porte Saint-Denis actuelle, elle s’apparente à un arc de triomphe élevé par la ville de Paris en 1672, à la gloire de Louis XIV. Elle célèbre le passage du Rhin, la prise de quarante villes fortifiées et la conquête de la Hollande.
L’actuelle Porte Saint-Denis est située à 100 m au nord de la porte précédente, celle du n°248 de la rue Saint-Denis.
Eric TIMMERMANS.
Sources : Contes du Vieux Paris, Pierre Jalabert, F. Lanore, 1966, p. 16-26 / « Enigmes, légendes et mystères du Vieux Paris », Patrick Hemmler, Editions Jean-Paul Gisserot, 2006 / Guide de l’Île-de-France mystérieuse, Les Guides Noirs, Editions Tchou Princesse, 1969, p. 672-678 / Guide de Paris mystérieux, Les Guides Noirs, Editions Tchou Princesse, 1978, p. 90, 103-112, 351-353, 680-681.
http://www.parisfierte.com/2013/02/saint-denis-de-paris/
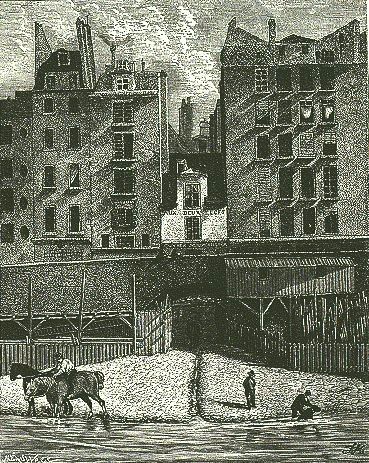
 3 commentaires
3 commentaires
-
1860 - L'Ile de la Cité avant Haussmann (suite)
Voici de nouvelles images prises entre 1860 et 1865 par Charles Marville.Ces clichés s'inscrivent en complément de l'article"L'île de La Cité avant Haussmann" (voir).Ils proviennent du fond de LaBibliothèque Historique de la Ville de Paris_______Here are some new images taken between 1860 and 1865 by Charles Marville. These shots are complementary to the article"L'île de La Cité avant Haussmann"(see). They come from the Historical Library of the City of Paris
 votre commentaire
votre commentaire
-
1855 - L'île de la Cité avant Haussmann
Berceau du Lutèce historique, l'Ile de la Cité fut considéré jusqu'au XVe siècle, comme le centre royal et épiscopal d'un Paris en perpétuelle croissance.Abandonné par Charles V au profit du Louvre, il fallut attendre le règne de Charles VII pour que le Palais Royal de la Cité (actuel Palais de Justice) soit définitivement transformé en Parlement.Malgré quelques ajustements architecturaux au XVII et XVIIIe siècle, l'île perdait progressivement son rôle central.Ce ne fut qu'au milieu du XIXe siècle qu'Haussmann dans sa logique de réaménagement, dépoussiéra l'ensemble.
La zone comprise entre le Palais de Justice et Notre Dame fut entièrement rasée. Des centaines de maisons empêtrées dans un enchevêtrement de rues étroites et insalubres furent détruites, générant du même coup 25000 expulsions.A la place, furent érigés les actuels Préfecture de Police et Tribunal de Commerce.Le Parvis de la Cathédrale fut six fois agrandi suite à la démolition de l'ancien Hôtel Dieu, reconstruit de l'autre côté en 1868, et des sanctuaires environnants.
Ces transformations suscitèrent de vives oppositions compte tenu de la valeur historique de ce patrimoine.Au cours des années 1970, à l'occasion de la réaménagement du parvis, les architectes marquèrent au sol les traces des anciennes rues. Il suffit de baisser les yeux, ces marques sont encore là aujourd'hui.
Quelques clichés complémentaires vous attendent sur la suite de l'article.
http://www.paris-unplugged.com/2012/03/1860-lile-de-la-cite-avant-haussmann_27.html
More pics at http://www.paris-unplugged. votre commentaire
votre commentaire
-
DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE, HISTORIQUE
PAR
A. GIRAULT DE SAINT FARGEAU
1845
MONTMARTRE, Mons Martis, Mons Martyrum, bg Seine (Ile-de-France), arr. et à 7 k. de Saint-Denis, cant. de Neuilly-sur-Seine. *. A 6 k. de Paris pour la taxe des lettres. Pop. 7,082 h.

Ce bourg, situé sur une montagne conique à peu près isolée, remonte à une haute antiquité. Il est assez difficile d'assigner la véritable étymologie de son nom ; la plus vraisemblable paraît être due à un temple de Mars qui aurait existé jadis sur cette butte, appelée Mons Martis dans un poème latin que le moine Albon écrivit en 896 sur le siège de Paris. Deux des plus anciens chroniqueurs, Frédégaire et Hilduin, le nomment Mons Mercurii, d'un temple dédié à Mercure ; enfin d'autres écrivains l'appellent Mons Martyrum, à cause, disent-ils, que ce fut au pied de cette montagne que saint Denis et ses compagnons furent martyrisés.

La montagne de Montmartre était couverte de maisons et formait, dès 627, un village qui fut presque entièrement détruit en 886, pendant le siège de Paris par les Normands. En 978, lors de la guerre que l'empereur Othon II fit à Hugues Capet, celui-ci établit son quartier général à Montmartre. En 1133 Burchard de Montmorency, à qui Montmartre appartenait, le céda à Louis le Gros et à la reine Adélaïde, son épouse, qui y fondèrent une abbaye de religieuses de l'ordre de Saint-Benoît, célèbre tour à tour par la piété et par les dérèglements de ses nonnes. Les Anglais portèrent un grand désordre dans cette maison religieuse. Henri IV y établit son quartier général pendant les guerres de la Ligue, et ses officiers, pour oublier l'ennui du siége de Paris, s'occupaient autant, dit Sauval, de la conquête des nonnes que de celle de la capitale.

Le roi lui-même sut se faire aimer d'une jeune religieuse nommée Marie de Beauvilliers, cousine de Gabrielle d'Estrées, qu'il fit abbesse de Montmartre, lorsque les brillants attraits de Gabrielle eurent effacé du coeur du monarque la douceur et les charmes de la naïve religieuse. Il vécut publiquement avec elle à Montmartre, et les religieuses, à son exemple, ne connurent plus de frein dans leurs dérèglements. Henri IV ayant été obligé de lever le siège de Paris, emmena avec lui sa charmante nonne, et ses officiers, imitant en cela leur prince, conduisirent à Senlis, où ils allaient, les jeunes religieuses, qui ne demandèrent pas mieux que de les suivre. - L'abbaye de Montmartre était la plus belle, la plus riche et la plus renommée des environs de Paris : elle fut détruite en 1794 ; aujourd'hui une belle et vaste maison de campagne s'élève sur son emplacement.

Le bourg de Montmartre est dans une situation remarquable et très pittoresque, sur la montagne de son nom, d'où l'on découvre, dans toute son étendue, la ville de Paris et ses gracieux environs. Cette montagne gypseuse fournit une masse énorme de plâtre et produit à elle seule plus des trois quarts de ce qui est nécessaire pour les constructions. Les carrières forment des galeries extrêmement curieuses, qui méritent d'être visitées.

La butte Montmartre, une des principales hauteurs qui dominent Paris, fut transformée en forteresse en 1814 et en 1815. Le 29 mars 1814 cette hauteur fut défendue par 15 ou 18,000 hommes de troupes françaises, au nombre desquelles étaient les braves élèves de l'école polytechnique, contre les armées des puissances coalisées, conjurées contre Napoléon. Cette petite armée soutint pendant la journée entière l'honneur national contre une supériorité numérique de plus de 40,000 ennemis, et ne se retira qu'après avoir perdu 5 à 6,000 hommes et avoir fait éprouver à l'ennemi une perte beaucoup plus considérable.

On voit à Montmartre, ainsi qu'aux alentours, plusieurs maisons de campagne, quantité de guinguettes et beaucoup de moulins à vent. Entre Montmartre et Saint-Ouen se trouve une glacière artificielle, établie d'après un principe ingénieux.

Montmartre possède un établissement philanthropique digne de figurer à côté des plus célèbres de la capitale, et connu sous le nom d'Asile de la Providence : c'est une espèce d'hospice, placé dans une grande et belle maison, accompagnée d'un vaste jardin, dans lequel on reçoit et l'on entretient cinquante à soixante vieillards des deux sexes. La moitié de ce nombre paye en entrant une modique pension ; les autres sont entretenus gratuitement.
Montmartre a pour annexe le hameau de Clignancourt, qui est situé à l'est et au pied de la montagne. - Son territoire est entouré par ceux des Batignolles-Monceaux, de Clichy-la-Garenne, de Saint-Ouen et de la Chapelle. Au midi il s'étend sur les boulevards extérieurs de Paris, devant les barrières du Faubourg-Saint-Denis, Poissonnière, de Rochechouart, des Martyrs, Pigalle, Blanche et de Clichy. Le village est disséminé sur toute la montagne, mais principalement sur le sommet et sur la pente méridionale jusqu'aux boulevards extérieurs.

Il n'est pas de commune aux environs de Paris qui offre plus de changements et d'améliorations, qui atteste davantage le progrès en tout genre. – Le quartier Montmartre, en face de l'abattoir de ce nom, s'appelle village d'Orcel, parce qu'il fut commencé, il y a environ cinquante ans, par un spéculateur qui se nommait Orcel, et qu'il était alors assez éloigné des autres habitations. - Montmartre s'est non moins accru du côté des barrières Pigalle, Blanche et de Clichy. Là un vaste quartier s'est élevé depuis une dizaine d'années. - L'ancienne partie du village occupe le sommet de la montagne, et s'améliore aussi rapidement par les sages dispositions prises par son embellissement. - Deux places publiques s'ouvrent l'une au sommet, près de l'église, l'autre à mi-côte, près des restes de l'ancienne abbaye. La première s'appelle place du Tertre ; la seconde, place de l'Abbaye. Sur l'un des côtés de celle-ci, le maire, secondé par le conseil municipal, a récemment fait élever la nouvelle mairie, bâtiment considérable et d'une belle apparence.

L
La situation de Montmartre le privait naturellement d'eaux abondantes, par conséquent des avantages nombreux qui en résultent. Il possédait jadis plusieurs sources, qui ont été successivement taries par l'exploitation des carrières. Quelques-unes existent encore sur le revers de la montagne au nord, mais dans un tel état d'appauvrissement qu'elles ne sont plus d'aucune utilité. La compagnie Bourelly a rendu à la commune l'éminent service de lui procurer en abondance, jusque sur les points les plus élevés, les eaux salubres de la Seine, au moyen d'une pompe à feu établie près de Saint-Ouen. Un réservoir, qui reçoit ces eaux refoulées dans des tuyaux d'ascension, les distribue ensuite dans tous les quartiers, soit publiquement aux porteurs d'eau et aux particuliers, soit dans les maisons et à domicile par des concessions et abonnements annuels d'un prix très modéré.
L'église de Montmartre, l'un des monuments les plus curieux du département de la Seine, est du XIIe siècle ; elle conserve encore des traces de son origine, surtout dans quatre colonnes, qu'on a eu la maladresse de peindre au lieu de les laisser dans leur état naturel. Placée au lieu le plus élevé de la montagne, on l'aperçoit de loin et de toutes parts. L'autorité supérieure a profité de cette situation favorable, elle a fait construire sur une partie de l'église une tour et un télégraphe qui, à cette hauteur, peut correspondre avec tous les points d'un immense horizon.
Sur la hauteur on remarque le fragment d'un obélisque, sur la face méridionale duquel était gravée l'inscription suivante :
L'AN 1736 ,
CET OBÉLISQUE A ÉTÉ ÉLEVÉ PAR ORDRE DU ROI,
POUR SERVIR D'ALIGNEMENTA LA MÉRIDIENNE DE PARIS DU CÔTÉ DU NORD.
SON AXE EST A 2,931 TOISES 2 PIEDS DE LA FACE
MÉRIDIONALE DE L'OBSERVATOIRE.Cet obélisque était un des quatre-vingt-seize que l'on avait projeté d'élever d'espace en espace dans toute la longueur du méridien de Paris qui traverse la France du sud au nord ; cette ligne, qui passe par l'église Saint-Sulpice, et dont la perpendiculaire est élevée à l'Observatoire royal, a puissamment servi au travail de la carte générale de France. A la latitude de l'Observatoire de Paris , le degré de longitude a été trouvé de 37,568 toises, la minute de 626 toises, et la seconde de 10 toises et demie ; et dans l'hypothèse que la terre est aplatie par ses pôles d'un 187e, ce degré est de 37,822. - Pour la latitude on a trouvé que de Paris à Amiens le degré était de 57,069 toises.
Deux cimetières sont établis dans la commune. L'ancien, situé près de l'église, est fermé depuis longtemps, excepté aux familles des concessionnaires à perpétuité. Le nouveau est ouvert sur le revers de la montagne, au nord. L'un des grands cimetières de Paris se trouve aussi dans la commune ; il est principalement destiné aux cinq arrondissements du nord de la capitale. Il est assis dans l'emplacement d'une ancienne carrière à plâtre. On y voit plusieurs tombes remarquables, entre autres celles de M. Larmoyer, de M. et de Mme Legouvé, de Mlle Volnais, de Saint-Lambert, de Greuze, de M. du Bocage, du maréchal de Ségur, du sculpteur Pigalle, etc., etc.
Montmartre possède l'un des principaux théâtres de la banlieue de Paris ; il est situé au village d'Orcel, en face de l'abattoir, précédé d'une jolie place et d'une petite promenade.

La fête patronale de Montmartre est celle de Saint-Pierre, 29 juin ; on la célèbre le dimanche suivant sur le plateau de la terrasse qui est près de l'église.
PATRIE du capitaine BONSERGENT, l'un des plus valeureux soldats des armées françaises.
Fabriques de tulle, savon vert, toiles cirées, instruments de marine, tapis peints et vernis, encre et produits chimiques. Fonderie de bronze. Maison de santé. Pension pour l'un et l'autre sexe.

Bibliographie.
* Conjectures sur la formation de Montmartre et de la butte de Chaumont près Paris (Mercure, p. 2330, 2339, nov. 1732).
ROBERT DE PAUL DE LAMANON. Description de divers fossiles trouvés dans les carrières de Montmartre près Paris, et vues générales sur la formation des pierres gypseuses, in-4, 1782.
* Représentation d'une chapelle souterraine qui s'est trouvée à Montmartre près Paris, le 12 juillet 1611, comme on faisait les fondements pour agrandir la chapelle des Martyrs, in-fol., 1611.
LÉON (de St-Jean). Abrégé des antiquités de l'abbaye de Montmartre dans le diocèse de Paris (imprimé avec sa vie de saint Denis, in-8, 1661).
PIERRE (de Ste-Catherine, dom). Cérémonial monastique des religieuses de l'abbaye royale de Montmartre-lès-Paris, in-4, 1669.
CHERONNET (D.-J.-F.). Histoire de Montmartre, état physique de la butte, ses chroniques, son abbaye, sa chapelle, ses martyrs, sa paroisse, etc., revue et publiée par M. l'abbé Ottin, in-8, 1843.
 votre commentaire
votre commentaire
-
MONTMARTRE(D'après Les environs de Paris illustrés, par Adolphe Joanne paru en 1856)

Vue de Paris prise de Montmartre Montmartre au XIXe siècle est une ville de près de 40000 habitants, située au nord de Paris, au pied, sur les pentes et sur le plateau d'une colline gypseuse, conique et isolée, dont les coquilles, les plantes et les ossements fossiles ont, depuis plus d'un demi-siècle, fait faire d'immenses progrès à la géologie, et dont le point culminant est à 129 mètres au-dessus de la mer, 65 mètres au-dessus des barrières Blanche, Pigalle et des Martyrs, 104 mètres au-dessus de la Seine. Elle fait partie du département de la Seine, arrondissement de Saint-Denis, canton de Neuilly. En 1817, M. Oudiette, qui du reste ne commettait pas une erreur, lui donnait une population de 2000 habitants, y compris les hameaux de Clignancourt et de la France-Nouvelle.
On a fait dériver tour à tour le nom de Montmartre de mono Mercadi (mont de Mercure), de mens Marlis (mont de Mars), et de monts Martyrum (mont des Martyrs). La première de ces étymologies ne compte plus qu'un petit nombre de partisans. Dans l'opinion de ceux qui soutiennent la seconde, il y avait sur le versant de la montagne un temple dédié à Mars. Si la troisième est vraie, saint Denis, décapité sur cette colline, y aurait, après son supplice, pris sa tête dans ses deux mains pour regagner son église, à là grande stupéfaction des spectateurs de son martyre. En février 1856, M. Edmond le Blant a soulevée la question sur l'origine du nom dans l'Athenaeum français. A l'en croire, il ne faut pas chercher ailleurs qu'à Montmartre le lieu de la passion de saint Denis, « Ce qui le prouve, dit-il, c'est la vénération attachée à ce lieu dès les premiers âges de l'Église ».
La crypte découverte en 1611, au-dessous de la chapelle de Saint-Denis, fut un sanctuaire creusé aux premiers siècles, sur la place, alors sans doute bien connue, où l'apôtre des Gaules et ses compagnons avaient souffert pour la foi ; les inscriptions gravées sur les murs de cette crypte, et constatées par un procès-verbal, furent les actes de visite des pèlerins qui y étaient venus prier.
L'affluence toujours croissante des fidèles rendit plus tard nécessaire l'érection d'une chapelle au-dessus de la crypte retrouvée au XVIIIe siècle. « Or l'antiquité de cette chapelle, mentionnée dès la fin du XIe siècle comme un lieu ancien et vénéré, recevant de nombreuses offrandes, est mise hors de doute , ajoute M. Ed. Le Blanc, par son nom même de Sanctum Martyrium, nom qui, dit les écrits des Saints Pères, désignent les basiliques primitives, qui n'existe plus dans la langue Fortunat et de Grégoire de Toua appliqué aux constructions nouvelles, et qu'un texte du IXe siècle relate comme une appellation d'usage. »
L'église actuelle de Montmartre date du commencement du XIIe siècle. Elle fut fondée ou plutôt rebâtie vers 1133 par Louis VI et par Alix de Savoie, sa femme, à la place d'une église beaucoup plus ancienne, qui demeura longtemps en ruine. Le pape Eugène III, accompagné de plusieurs cardinaux et prélats, la consacra en présence de saint Bernard et de Pierre le Vénérable. Près de cette église Louis VI fonda un monastère où il établit des Bénédictines et qu'il combla de bienfaits. Ces religieuses acquirent d'abord une grande réputation de sainteté par leur dévotion et par l'austérité de leur vie. Leur bonne renommée amena à leur couvent un nombre considérable de pèlerins qui leur firent, les uns, des aumônes, les autres, des présents. Elles s'enrichirent ; peu à peu leurs mœurs se relâchèrent, de méritoire, leur conduite devin scandaleuse.
Vers la fin du XVe siècle, J. Simon, évêque de Paris essaya, mais en vain, de réprimer leurs désordres. Son successeur. Et. Porcher, leur adjoignit dans le même but des religieuses de l'ordre de Fontevrault. Ce remède ne produisit pas tout l'effet désiré.
Ce couvent, presque entièrement détruit par un incendie en 1559, fut immédiatement rebâti. Les soldats de l'armée d'Henri IV vinrent alors l'occuper, et le pré-tendant lui-même s'installa dans l'appartement de l'abbesse. L'histoire contemporaine a mentionné la raison criminelle que contracta le béarnais avec Marie de Beauvilliers, jeune religieuse de 17 ans qui ne pouvant consentir à se séparer de son séducteur, le suivit jusqu'à Senlis. Depuis on a tenté, il est vrai, d'en contester l'authenti-cité mais le roi lui-même n'en faisait pas mystère, et se disait volontiers « moine de Montmartre. » Un monastère où des soldats avaient tenu garnison ne pouvait pas, on le comprend sans peine, offrir aux fidèles un spectacle bien édifiant. Les religieuses menaient une vie assez scandaleuse, comme au temps où l'évêque Étienne Porcher leur adressait de sévères reproches. Du reste, malgré ses immenses propriétés, la communauté subvenait avec peine à ses besoins.
Quand Marie de Beauvilliers, abandonnée par son royal amant, qui lui avait préféré Gabrielle d'Estrées, fut appelée à la diriger (1598), « peu de religieuses chantaient l'office, dit Sauval ; les moins déréglées travaillaient pour vivre et mouraient presque de faim, Les jeunes faisaient les coquettes, les vieilles allaient garder les vaches et servaient de confidentes aux jeunes. » Marie de Beauvilliers, guérie de sa passion pour le roi et repentante de ses fautes, essaya de réformer ces abus. Elle y réussit en partie ; mais ce ne fut pas sans peine et sans danger. Si l'on doit en croire les chroniques du temps, les religieuses essayèrent de l'empoisonner. Du contrepoison administré à temps la rappela à la vie, mais elle conserva jusqu'à sa mort une grande difficulté de respiration. A dater de cet attentat, l'abbaye de Montmartre recouvra peu à peu son ancienne renommée.
MONTMARTRE(D'après Les environs de Paris illustrés, par Adolphe Joanne paru en 1856)
- Ancienne église et la tour du télégraphe à Montmartre
En 1534, le jour de l'Assomption, saint Ignace de Loyola, le fondateur de l'ordre des jésuites, prononça ses premiers vœux avec neuf de ses compagnons dans la chapelle des Martyrs. Les jésuites avaient placé dans cette chapelle un tableau représentant cette cérémonie ; et une plaque de bronze doré, scellée dans le mur de la chapelle fermée qui contenait, outre ce tableau, diverses inscriptions, constatait que a la société de Jésus, qui reconnaît saint Ignace de Loyola pour père, était née dans le tombeau des martyrs.
Au commencement du XVIIe siècle, cette chapelle, qui avait été déjà souvent restaurée, mais que les guerres de la Ligue avaient détruite, fut encore agrandie et embellie. En travaillant aux fondations nouvelles, le 13 juillet 1611, on y fit la curieuse découverte dont nous avons déjà parlé. Un procès-verbal, rédigé le jour même, s'exprimait en ces termes :
« Sous laquelle il y a des degré pour descendre sous terre en une cave.... En laquelle voûte.... nous serions descendu.... et aurions trouvé que c'était une descente droite, laquelle a cinq pieds un quart de largeur. Par laquelle nous serions descendu trente-sept degrés fait de vieille maçonnerie de plâtre, gâtées et écornées. Et au bas de laquelle descente aurions trouvé une case ou caverne prise dans un roc de plâtre tant par le haut que par les côtés. Laquelle.... a de longueur depuis l'entrée jusque au bout qui est en tirant vers la clôture de dites religieuses, trente-deux pieds. Dans laquelle cave, du côté de l'orient il y a une pierre de plâtre biscornu, qui a quatre pieds de long et deux pieds et demi de large, prise par son milieu, ayant six poulses d'épaisseur, au dessus de laquelle au milieu il y a une croix gravée avec un ciseau, qui a six poule en quarré de longueur et demi poulse de largeur. Icelle pierre est élevée sur deux pierres de chacun côté, de moellon de pierre dure, de trois pieds de haut, appuyée contre la roche de plâtre, en forme de table ou autel : et est distant de ladite montée de cinq pieds. Vers le bout de laquelle cave, à la main droite de l'entrée, il y a dans ladite roche de pierre une croix, imprimée avec un poinçon ou couteau, ou autre ferrement ; et y sont ensuite ces lettres MAR.
Il y a apparence d'autres qui suivent, mais on ne les peut discerner. Au même côté un peu distant de la susdite croix, au bout de ladite cave, en entrant, à la distance de vingt-quatre pieds, dès l'entrée s'est trouvé ce mot écrit de pierre noire sur le roc, CLEMIN, et au côté dudit mot y aurait eu quelque forme de lettres imprimées dans la pierre avec la pointe d'un couteau ou autre ferrement où il y a DIO, avec autres lettres suivantes qui ne se peuvent distinguer. La hauteur de la cave en sorte entrée est de six pieds jusqu'à neuf pieds en tirant de ladite entrée vers le bout de ladite cave. Et le surplus jusque au bout est rempli de terre et de gravas, etc. »
La nouvelle de cette découverte attira à Montmartre un nombre considérable de visiteurs, parmi lesquels figurèrent la reine Marie de Médicis et plusieurs dames de qualité. Telle fut la sensation produite par cet événement, que Nicolas de Matthonnière fit immédiatement exécuter, par Jean de Halbeeck, une gravure au burin, représentant Montmartre et sa crypte, gravure qui, imprimée sur une feuille volante, avec une courte notice, se vendit à un grand nombre d'exem-plaires. Toutefois, si l'affluence des fidèles produisit de nombreuses offrandes pour la reconstruction du saint édifice, elle amena en même temps, au dire de D. Marrier, la destruction des inscriptions murales dont le procès-verbal avait con-staté l'existence.
Non seulement on avait rebâti la chapelle des Martyrs, mais on avais étendu l'enceinte du monastère de manière à l'y renfermer. En 1662, elle fut érigée en prieuré. Ce prieuré n'exista que dix-neuf années. On le supprima en 1681, quand Louis XIV fit construire, pour les religieuses, de nouveaux bâtiments, au pied du versant méridional de la butte ; car les anciens, situés près de l'église, et recon-struits depuis l'incendie de 1559, étaient devenus inhabitables. La grande église fut maintenue comme paroisse, et la partie réservée n'en demeura pas moins à la disposition des religieuses, qui avaient pourtant, dans leur nouvelle demeure, la chapelle des Martyrs.
Elles y venaient souvent prier. Elles y montaient par une galerie couverte qu'avait fait construire, en 1644, leur abbesse, Mme de Guise. Une grande grille, placée où se trouve aujourd'hui le maître-autel, séparait la paroisse proprement dite de ce qu'on appelait et de ce qu'on appelle encore le chœur des Dames. C'est sous le pavé de ce chœur que les abbesses étaient ensevelies, près du mausolée de Mme Alix, femme du roi Louis VI dit le Gros, que Marie de Beauvilliers avait fait transporter de l'intérieur du couvent au pied du maître-autel.
L'abbaye de Montmartre, supprimée en 1190, et vendue bientôt après, a été complètement détruite en 1193. Il n'en reste aucun vestige, et on chercherait vainement des débris de la chapelle de Saint-Denis ou des Martyrs, qui était située entre le calvaire actuel et le boulevard des Martyrs. La dernière abbesse, Marie-Louise de Laval, duchesse de Montmorency, qui s'était retirée à Saint-Denis, puis au ch-teau de Bondy, comparut le 20 juillet 1794 devant le tribunal révolutionnaire. Son grand âge et ses infirmités (elle était aveugle et sourde) rendaient impossible à soutenir l'accusation de complot portée contre elle. Un juré en fit l'observation à Fouquier-Tainville : « Qu'importe? s'écria celui-ci ; elle a conspiré sourdement. » Condamnée à mort, Mme de Montmorency fut guillotinée le même jour à la barrière du Trône.
L'église de Montmartre est seul restée debout, mais elle a été souvent pillée, mutilée, reconstruite peinte, badigeonnée, et enfin restaurée avec plus de luxe que d'intelligence et de goût. Elle se divise en deux parties, dont une seule est consacrée au culte. L'extrémité, appelée le chœur des Dames, et qui formait autrefois l'abside de l'église, était, comme son nom l'indique, exclusivement réservée aux religieuses. Convertie en un magasin où l'on dépose les cercueils, elle renferme l'escalier de la tour qui s'élève sur le chœur de l'église, et dont le sommet porte un télégraphe établi en 1795, et communiquant avec Lille avant l'invention de la télégraphie électrique.
La partie consacrée au culte a la forme d'un carré long, sans transepts, avec une nef et deux bas côtés. La voûte, jadis ogivale, des bas côtés, a été restaurée, et ressemble presque à un plafond. Du côté des collatéraux, les piliers affectent la forme cylindrique ; à l'intérieur de la grande nef, ils se transforment en boudins ou torses qui montent jusqu'à la naissance de la voûte ogivale, soutenue par des nervures qui se croisent en diagonales, et qui séparent chaque travée. Sur la clef de voûte de la troisième travée sont sculptées les armes de l'abbaye, et sur la quatrième les armes de France. La cuve des fonts baptismaux est richement ornée dans le style de la Renais-sance. On y remarque deux clefs en sautoir et un écusson portant la date de 1537.
A l'entrée de la porte principale, et de chaque côté, se voient deux colonnes en marbra vert antique, d'un style de décadente, mais qui ont certainement appartenu à un édifice païen. Leurs chapiteaux sont malheureusement peints. Deux autres colonnes, un peu plus élevées, mais de la même époque, et qui ont évidemment même origine, se trouvent dans le chœur des Dames. Le maître-autel a été fait avec une énorme pierre découverte en 1833, près de la ports du télégraphe ; on croit que c'est celle sur laquelle le pape Eugène III consacra l'église en 1147. Le buffet d'orgues provient de l'ancien chapelle de Notre-Dame de Lorette. La chaire est une menuiserie du XVIIIe siècle.
L'extérieur de l'église de Montmartre n'offre rien de remarquable La façade moderne, derrière laquelle se dresse à gauche une vieille tour carrée, n'a aucun caractère architecture. La paroisse de Montmartre possède encore aujourd'hui quelques-unes des anciennes reliques données à l'abbaye et à la chapelle de Martyrs. Adroite de l'église est le Calvaire, qui se compose de neuf stations, bâties dans un jardin où l'on ne pénètre que moyennant une légère rétribution que perçoit le propriétaire de ce terrain. A l'extrémité du jardin se trouve le Calvaire proprement dit, et à droite, dans une grotte souterraine, un saint sépulcre qui reproduit la forme et les dimensions de celui de Jérusalem. Ce calvaire, fondé en 1805, a obtenu des indulgences du pape Pie VII. Depuis la suppression du calvaire du mont Valérien, il est cité par un grand nombre de pèlerins.
Montmartre a si l'on doit en croire la tradition, possédait jadis un saint célèbre qui avait le pouvoir de rabonnir les maris méchants. On l'appelait saint Raboni. Un grand nombre de femmes venaient implorer sa protection. On raconte à ce sujet l'anecdote suivante : Une femme entreprit de faire neuvaine à Raboni, pour obtenir la conversion de son mari. Quatre jours après, le mari étant mort, elle s'écria :
« Que la bonté du saint est grande,
Puisqu'il donne plus qu'on ne demande ! »
La Rue De L'abreuvoir A Montmartre L 'histoire de Montmartre ne se compose que de sièges et de batailles. Toutes les armées qui ont attaqué Paris ont occupé tour à tour cette forteresse naturelle, les Normands s'y installèrent. Othon II vint y camper (978). Il ordonna à ses soldats de respectes tous les édifices consacrés au culte. Seulement pour tenir l'engagement qu'il avait contracté envers Hugues Capet, alors prudemment enfermé dans Paris, « de lui chanter un Alleluia, si haut et si fort, qu'on n'en aurait jamais ouï de semblable, » il fit entonner le cantique Alleluia te martyrum, etc., par une multitude de clercs auxquels répondaient en chœur des milliers de combattants. Un chroniqueur prétend que Hugues et tout le peuple de Paris, saisis de stupéfaction, en eurent les oreilles assourdies. Othon s'avança au galop jusqu'aux fossés de Paris, et darda sa lance dans la porte de la ville en disant : « Jusqu'ici, c'est assez. » Toutefois il ne tenta point l'assaut, et, après diverses escar-mouches, croyant son honneur satisfait, il commanda la retraite.
Lors du siège de Paris, en 1592 Henri IV fit braquer des canons sur une terrasse qui passait pour un débris du temple de Mars, et il envoya un certain nombre de projec-tiles à ses futurs sujets.
En 1814, Montmartre ne fut pas défendue. Quand, après avoir repoussé une première attaque, les défenseurs de Belleville et des buttes Chaumont virent s'avancer sans s'émouvoir les 100 000 soldats nouveaux amenés par Blücher, il n'en fut pas de même, dit M. Ac. de Vaulabelle, de quelques spectateurs enfermés dans un pavillon du Château-Rouge... « Six pièces de canon, deux obusiers, quelques détachements de cavalerie, un bataillon de sapeurs-pompiers et 150 ou 200 gardes nationaux, voilà tous les moyens de défense réunis à Montmartre. Quand j'arrivai à Montmartre », raconte le duc de Rovigo dans ses Mémoires, « je ne fus pas peu surpris de n'y trouver aucune disposition de dé-fense. » Éloignée de plus de trois quarts de lieue du théâtre de la bataille, dont la séparaient d'ailleurs les deux canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis, les villages de la Villette et de la Chapelle, la butte Montmartre ne fut pas inquiétée, même par les éclaireurs de l'ennemi, pendant la plus grande partie de la journée du 30 mars.
Ce fut à cet observatoire que le roi Joseph, lieutenant général de l'Empereur, accompagné du ministre de la guerre, Clarke, vint se placer pour juger et attendre les événements... Lorsque, vers une heure, le duc de Raguse fit dire à Joseph que les positions où il s'était jusqu'alors maintenu commençaient à être forcées, et qu'un des corps amenés par Blücher s'avançait par Romainville, Ménilmontant et Charonne ; quand ce prince, plongeant lui-même, ses regards sur la plaine Saint-Denis aperçut les nouvelles troupes qui noircissaient au loin la campagne, il chargea deux de ses officiers de porter aux maréchaux quelques lignes qu'il avait écrites une heure auparavant ; et, abandonnant à tous les hasards de la lutte le gouvernement, Paris et ses héroïques défenseurs, il s'élança au galop sur les boulevards extérieurs et prit la route de Versailles, accompagné de Clarke.
« Dans ce moment un officier général, accourant à franc étrier, paraît devant le Château-Rouge et demande Joseph à grands cris. On le lui montre au milieu d'un groupe de cavaliers qui s'éloignaient de toute la vitesse de leurs chevaux, dans la direction du bois de Boulogne. Ce général s'élance sur les traces des frères de l'Empereur. C'était le général Dejean, que Napo-léon avait envoyé à Joseph, pour lui annoncer son retour à Paris et lui enjoindre de tenir jusque-là. Il atteignit Joseph au milieu du bois de Boulogne et lui rendit compte de sa mission. « Il est trop tard, » lui dit Joseph, « je viens d'autoriser les maréchaux à traiter avec l'ennemi ». Le général Dejean eut beau le presser de retirer cet ordre, d'en suspendre au moins l'exécution ; après plusieurs refus, Joseph enfonça ses éperons dans le ventre de son cheval et reprit sa course, toujours suivi par Clarke. Ils rendaient à Blois où était déjà l' Impératrice. »
Cependant Blücher, ne pouvant pas croire que Montmartre n'était pas fortifiée, s'en approchait avec les plus grandes précautions. Ce fut à trois heures seulement que ses premiers détachements parurent au pied de la butte. Quelques boulets et quelques obus furent lancés contre eux ; mais à quatre heures il ne restait plus un homme armé sur ce point. Blücher l'occupa immédiatement en force et, à quatre heures et demie, huit pièces de canon que nos soldats y avaient laissées étaient tournées contre Paris et jetaient sur les faubourgs les plus rapprochés des boulets et des obus. Le soir même toutes les plates-formes de la butte étaient hérissées de batteries.
En 1815, la butte Montmartre avait été fortifiée, mais elle ne fut pas attaquée, une trahison ayant livré aux alliés le pont de Saint Germain. Les Anglais ravagèrent les vignes de Clignancourt, comme l'avaient déjà fait leurs ancêtres en 475, et ils en furent punis par les mêmes souffrances. Depuis lors la ville de Montmartre n'a plus fait parler d'elle.

Vue de Montmartre. Carrière et tour du Télégraphe V ers la même époque, les pèlerinages devinrent plus rares. Montmartre était alors un village de vignerons, de laboureurs et de meuniers. Les moulins surtout jouissaient d'une grande célébrité ; leurs propriétaires tenaient en même temps des cabarets, et déjà, comme aujourd'hui, ils voyaient chaque dimanche le peuple gravir le sommet du coteau pour venir s'asseoir sous leurs tonnelles et boire le vin du cru.
Les ânes de Montmartre étaient aussi en grande renommée, ce qui donna lieu à de méchants quolibets tombés en désuétude. Les ânes ont à peu près disparu mais les ânesses existent encore ; seulement elles ne portent plus de sacs de blé ni de farine ; leur lait sert à rendre la santé ou l'espérance d'une guérison prochaine aux poitrines faibles et aux estomacs débiles. Quant aux moulins, au lieu de moudre les dons de Cérès, comme on aurait dit il y a quelque cinquante ans, se contentent aujourd'hui de broyer tristement du noir animal, ce qui est singulièrement moins poétique.
Puisque nous avons parlé des ânes de Montmartre, nous raconterons ici une anecdote mentionnés par Dulaure, et qui fit grand bruit en 1779. La police avait ordonné des fouillés sur le territoire de Montmartre, où l'on avait déjà trouvé des vestiges antiques ; ces fouilles amenèrent la découverte, entre Belleville et la butte, d'une pierre couverte de caractères gravés, qui fut transportée immédiatement à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. L'Académie s'em-pressa de nommer une commission : mais cette commission ne parvint ni à déchiffrer le sens de l'inscription, ni à deviner dans quelle langue elle était écrite. Impossible de former des mots avec ces caractères.
Les académiciens ne savaient comment résoudre ce problème ; les plus savants y perdaient leur latin, leur grec, leur sanscrit ou leur hébreu. L'auteur du Monde primitif lui-même ; Court de Gébelin, s'était déclaré incompétent. Tout à coup le bruit se répand que le bedeau de Montmartre peut tirer l'Académie d'embarras. On le fait venir. Dès qu'on lui a apporté la pierre, il rassemble du premier coup d'œil les lettres composant l'inscription, et se met à lire d'une voix assurée : Ici le chemin des ânes. Les académiciens, assure-t-on rirent beaucoup.
Le Montmartre actuel ne ressemble plus au Montmartre du siècle passé. C'est une ville, et même une grande ville ; sa population actuelle dépasse, avons-nous dit 40 000 âmes : elle s'accroît sans cesse. Les démolitions de Paris l'augmentent de 3000 à 4000 âmes par an. A Cette métamorphose Montmartre a perdu son aspect pittoresque ; mais elle s'est enrichi et elle a gagné la sécurité qui lui manquait. Il y a Une vingtaine d' années, il eût été imprudent de s'attarder dans ses rues alors désertes Aujourd'hui on peut y circuler sans crainte aucune à toute heure de la nuit.
Elle devait sa mauvaise renommée aux carriers qui l'habitaient et à ses carrières ouvertes qui offraient un refuge aux voleurs et aux vagabonds de la grande ville. Mais depuis que l'exploitation des carrières a cessé, et que leur entrée est interdite même aux curieux, la population s'est en parti renouvelée. Les cabaretiers, les propriétaires de guinguettes et de tables d'hôte en forment la majorité ; la minorité se composant généralement d'employés, d'ouvriers, de petits rentiers qui attirent le prix des loyers moins chers qu'à Paris, et le bon marché relatif de certains objets, de consommation qui n'ont point à payer de droits d'octroi. Le sommet de la montagne est encore occupé par un certain nombre de nourrisseurs et de cultivateurs.
Ses rues étroites, tortueuses, et ses maisons d'un autre siècle dorment à ce quartier l'aspect d'une vieille ville de province perdue dans l'intérieur de la France. Est telle de ses rues, par exemple celle des Rosiers, où l'on se croirait à cent lieues de la capitale ; telle autre, la rue de l'Abreuvoir, aboutit à une mare ombragée de grand arbres qui rappelle, par son caractère original, certains motifs des paysages méridionaux. D'assez belles mai-sons de campagne, entourées de jardins, voient s'ouvrir leur entrée principale dans des ruelles solitaires, tandis que leurs parterres, leurs massifs de verdure s'allongent sur le versant septentrional de la butte. Un des plus beaux jardins de Montmartre est celui de l'ancienne maison du docteur Blanche.
Les moulins, comme bien on le pense, sont situés au sommet de la montagne. Nous avons dit à quel rôle ils s'étaient résignés. Il n'en reste plus que trois aujourd'hui, dont l'un, le moulin de la Galette, n'a d'autre destination que de servir d'enseigne à un cabaret qui porte le même nom, et qui a une antique origine. De la plate-forme sur laquelle est construit un de ses voisins, et où le public peut entrer moyennant une rétribution de 10 centimes, on jouit d'une des plus belles vues panoramiques des environs de Paris. On découvre : au sud, tout Paris et ses immenses faubourgs ; au nord, l'allée de la Seine, la plaine Saint-Denis et l'entrée de la vallée de Montmorency.
Tout prés de là se trouve un obélisque sur lequel était gravée l'inscription suivante, que le temps a effacée en partie :
L'an 1736 cet obélisque a été élevé par ordre du roi,
pour servir d'alignement
à la méridienne de Paris du côté du nord.
Son axe
est à 2931 toises 2 pieds de la face
méridionale de l'Observatoire.Si les pentes du versant septen-trional sont encore couvertes en partie de jardins ombreux, le versant méridional s'est garni depuis vingt ans d'un nombre considérable de maisons ; il est, au moins jusqu'à mi-côte, sillonné de rues qui ressemblent beaucoup aux rues de certains quartiers de la capitale, sauf la rue du Vieux-Chemin, en partie bordée d'arbres, ou les voies qui escaladent en droite ligne le sommet de la montagne et qu'accidentent çà et là des escaliers gigan-tesques. Pourtant de ce côté encore, et dans la partie comprise entre le sommet de la butte, la place du Nouveau-Marché et le hameau de Clignancourt, on trouve des coteaux abruptes et dénudés, d'un aspect singulièrement pittoresque ; leurs parois colorées ont plus d'une fois fourni à certains peintres de l'école moderne des sujets de paysages espagnols et italiens. Mais cette partie de la montagne, dont des travaux récents ont déjà altéré la physionomie caractéristique, est menacée d'une des-truction complète.
La municipalité a en effet conçu le projet d'établir à mi-côte, autour de Montmartre, de larges boulevards à rampes douces et plantés d'arbres. La partie nord-ouest de la montagne, où se trouve l'entrée des carrières, est seule restée jusqu'à ce jour ce qu'elle était au siècle dernier. On a parlé depuis quelque temps d'un projet plus vaste encore ; il s'agirait de ra-ser la butte elle-même, pour donner de l'espace aux constructions, qui ne peuvent pas s'étendre commodé-ment sur ses pentes trop rapides.
Les jardins, avons-nous dit, ont à peu près complètement disparu du versant méridional de Montmartre. Ceux qui subsistent encore dépendent des bals publics. Parmi ces bals, nous devons mettre au premier rang celui du Château-Rouge. Le Château-Rouge, situé dans le hameau de Clignancourt, est une charmante maison, contemporaine du règne d'Henri IV, et que ce monarque avait fait construire pour Gabrielle d'Estrées. Son nom lui vient des briques avec lesquelles il est en partie bâti. A l'extérieur il a conservé à peu près son antique physionomie et le caractère pittoresque qu'on retrouve dans les maisons de la place Royale. Depuis quelques années, le vaste jardin qui l'encadrait de ses massifs a été singulièrement rogné par les enva-hissements successifs des propriétés riveraines.
Le bal a vu également diminuer beaucoup la vogue dont il avait joui lors de son ouverture. Néanmoins il doit être encore mis au premier rang des autres bals de Montmartre, parmi lesquels nous mentionnerons ceux de l'Elysée-Montmartre, situé sur le boulevard, entre les barrières Rochechouart et des Martyrs ; de l'Ermitage, tout près de la barrière Pigalle ; et de la Reine-Blanche, à côté de la barrière Blanche. Ces établissements, consacrés au culte d'une Terpsichore. suspecte, ne sont pas fréquentés par une société choisie, et nous nous bornons à les indiquer seule nient aux étrangers curieux d'étudier les mœurs d'une certaine partie de la population parisienne.
Montmartre renferme aussi un grand nombre de tables d'hôte, presque toutes situées dans la partie méridionale de la ville, et dont le prix modique fait remonter chaque soir de l'année, du centre de Paris vers les boulevards extérieurs, une armée de petits employés, de dames aux allures équivoques et de rentiers nécessiteux. Pour 1 franc 50 centimes il n'y a pas plus de deux ans, ce prix ne dépassait pas la moyenne de 1 franc 30 centimes cette population de dîneurs se repaît d'une nourriture plus abondante que succulente, mais généralement saine.
Le restaurant des Princes, chaussée des Martyrs, le Véfour de la banlieue, a le privilège des repas de noce et des corporations. Le Petit-Ramponneau n'est qu'une gargote, pour parler la langue popu-laire ; mais c'est la plus immense gargote des environs de Paris. On mange et on y boit partout, dans ses vastes salles, dans des cabinets particuliers et dans la cour, et l'on y vide plus de brocs que de bouteilles. Nul luxe, bien entendu ; les cuillers et les fourchettes sont en fer, les couteaux ne valent pas piaf de cinq centimes ; le prix de la nourriture est à l'avenant. Pourtant elle est plus saine, à ce qu'il paraît, que celle qui se débite à des prix élevés dans certains établissements parisiens vernis, dorés et fréquentés surtout par des employés à qui leur toilette ne permet pas d'aller au cabaret. Le Petit-Rambonneau contient dans son enceinte sa boucherie, sa fruiterie et sa char-cuterie.Le chiffre de ses affaires est énorme. Son avant-dernier propriétaire y a fait une magnifique fortune, et son possesseur actuel semble réservé à la même destinée. Montmartre possède une mairie plus que modeste, un théâtre qui passait pour le premier de la banlieue avant la construction de celui de Batignolles, et deux établissements de bienfaisance : l'asile Piemontesi, fondé pour les vieillards indigents de la commune, et l'asile de la Providence, chaussée des Martyrs. Ce dernier établissement sert de retraite à 61 vieillards des deux sexes de la ville de Paris, qui y saut logés, nourris, blanchis , et soignés en cas de maladie. Il y a 6 places gratuites : 2 sont à la nomination des fondateurs et de leurs familles, 2 à la nomination du ministère de l'intérieur, et 2 à la nomination du conseil municipal de Paris.
Les 55 autres places sont à la nomination du ministre de l'intérieur, de la Société de la Providence et du conseil d'administration de l'établissement. Pour le prix de ces 55 places, il doit être payé une pension annuelle de 600 francs. L'asile est géré gratuitement par un administrateur en chef, que nomme le ministre, et sous la surveillance d'un conseil qui doit être composé de cinq membres. Six sœurs de la congrégation des Dames hospitalières du diocèse de NeVers desservent l'asile de la Providence.
sources
http://www.paris-pittoresque.com/rues/96-4.htm
 votre commentaire
votre commentaire
-
Histoire des ossuaires souterrains

 Au départ, des problèmes de surpeuplement des cimetières parisiens qui engendrent d'importants phénomènes d'insalubrité
Au départ, des problèmes de surpeuplement des cimetières parisiens qui engendrent d'importants phénomènes d'insalubritéLe cimetière des Innocents, en lieu et place du Forum des Halles actuel, était le plus grand cimetière de Paris, et ce depuis plus de trente générations. Il était composé en son centre du cimetière proprement dit avec ses tombes et ses fosses communes ; sa périphérie était faîte de bâtiments à arcades, les charniers. Mais dès 1554 des médecins de la faculté avaient été désignés à la suite de protestations de riverains pour réclamer la suppression de celui-ci. L'effroyable odeur qui s'en dégageait envahissait progressivement les habitations proximales. Particuliers et autorités ecclésiastiques se plaignaient de plus en plus.
Ce n'est cependant qu'à partir de la fin du XVIIè siècle que les plaintes croissent en nombre et en intensité, suivant en cela l'augmentation de la pestilence.
Dès le début du XVIIIè siècle, les inconvénients créés par les inhumations dans les églises, ou dans les cimetières surencombrés, rendirent nécessaire la création de nécropoles publiques. De nouvelles plaintes, de plus en plus nombreuses, s'exprimèrent en 1724, 1725, 1734 et 1755. Des protestations concernant d'autres cimetières dont les églises et les charniers débordaient également, exprimèrent le mécontentement de la majorité des parisiens.
Une fois de plus un fait nouveau fit évoluer la situation. Un incident spectaculaire se produisit à point nommé : le 30 mai 1780, rue de la Lingerie, à la limite sud du cimetière des Innocents, le mur d'une cave de deux étages céda et des centaines de corps envahirent le local dans une atmosphère pétride, intoxiquant les habitants de la maison, tandis que les murs des caves voisines se fissurèrent. La paroi latérale d'une fosse commune de plus de 15 mètres de profondeur, ouverte quelque six mois plus tôt et destinée à reçevoir mille huit cent corps, n'avait pu resister à la pression. Le scandale fut tel que le 4 septembre de la même années, le Parlement, après enquête, ordonna la fermeture du cimetière des Innocents et l'interdiction des inhumations à partir du 1er décembre. Le rapport de Cadet de Vaux du 30 mai 1780 avait également fait état d'incidents graves : un habitant de la rue de la Lingerie descendant dasn sa cave s'était vu éteindre sa flamme de lumière par les exhalations émanant de la fosse commune mitoyenne ; des cas d'intoxications avec vomissements ainsi que d'intoxications cutanées touchaient certains propriétaires de caves adjacentes.
On décida quand même de laisser le cimetère des Innocents reposer pendant 5 ans avant de transférer les débris mortuaires de trente générations de parisiens.
Cette opération, qui apparaîtra comme un succès, s'étendit progressivement de 1787 à 1814 à la majorité des cimetières intramuros amenant en outre la destruction des charniers. Les charniers avaient été inventés pour faire face au manque de place dans les cimetières ; on entreposait les corps par milliers sous les toit et au dessus d'arcades passantes.
Cependant beaucoup d'églises conservèrent des vestiges mortuaires sous leurs dallages et, parfois, dans leur combles.
Les inhumations ayant été arrêtées, la vie du quartier des Saints-Innocents reprit un cours plus paisible, mais les maisons riveraines continuèrent à déverser leurs ordures dans le cimetière.
La fermeture des Innocents accrut la clientèle des autres cimetières, comme par exemple celui de l'église Saint-Laurent, qui ne ferma qu'en 1797.
Des habitudes prises depuis plusieurs siècles ne peuvent disparaître en quelques années et les inhumations désormais interdites dans les anciens cimetières persistent parfois -par exemple au cimetière de l'église Saint-Bernard où on continua clandestinement à inhumer jusqu'en 1795-.
Quelques protestations contre les transferts s'élevèrent cependant. En 1785, le cimetière et la plus grande partie des charniers furent démolis et les pierres vendues sur place pour la continuation des travaux du Louvre.
Changé en marché aux légumes à partir de 1788, l'emplacement du cimetière des Saints-Innocents entre dans une époque calme de son histoire. Et ce n'est que près de deux siècles plus tard que les bulldozers, bouleversant le terrain du futur Forum des Halles, ramèneront des sarcophages mérovingiens, peut-être les derniers de la vieille nécropole. Il faut "vider" les cimetières parisiens dans de vastes espaces discrets : l'idée d'utiliser les grands vides sous Paris née.
Il faut "vider" les cimetières parisiens dans de vastes espaces discrets : l'idée d'utiliser les grands vides sous Paris née.L'idée initiale d'utiliser les carrières de Paris comme ossuaire revient au lieutenant de police Lenoir qui avait oeuvré pour la destruction du cimetère des Innocents, mais c'est son successeur, Thiroux de Crosne, qui en fit accepter le principe.
Un premier choix s'était porté sous les carrières souterraines dites de "La Fosse aux Lions", situées sous l'actuelles rue Cabanis et Ferrus.
Cependant, après avis de l'Inspecteur général des carrières, Guillaumot, le Conseil du Roi choisit un ensemble d'anciennes carrières dans de vastes carrières de pierre à bâtir à piliers tournés, situées sous le plateau de Montsouris, au lieu dit de la Tombe Issoire (au sud de l'actuelle place Denfert Rochereau).
On aménagea de façon assez sommaire une surface totale de 11 000 m2. Un puits maçonné destiné au déversement des ossements, situé au 21 bis de l'avenue du Parc-Montsouris (actuelle avenue René Coty), et un ancien escalier en colimaçon de 90 marches d'une hauteur de 19 mètres, furent utilisés. Dans le puits pendait une chaîne que l'on remuait pour éviter les entassements et les blocages.
L'ensemble de l'Ossuaire situé dans un quadrilatère délimité par les rues Dareau, d'Alembert, Hallé et l'avenue du Parc-Montsouris, ne représente que 1/700è des carrières souterraines de Paris. D'abord restaurées et aménagées par Héricart de Thury, puis en 1810 et 1811 par le comte Frochot, premier Préfet du département de la Seine, les Catacombes seront modifiées pour permettre des visites publiques. Sous le Premier Empire, elles seront isolées du reste des carrières et le déblaiement des galeries surencombrées nécessitera parfois l'aménagement de nouveaux passages dans les masses d'ossements de plus de 30 mètres d'épaisseur. L'ensemble sera pratiquement terminé en 1809.
 Le transfert aux Catacombes
Le transfert aux Catacombes Le 7 avril 1786, sous la conduite de Guillaumot et d'architectes, les abbés Mottret, Maillet et Asseline consacrent ce qui sera désormais les Catacombes de la Tombe Issoire. Le même jour commence le transfert des ossements du cimetière des Innocents et ceux du cimetière voisin de Saint-Eustache. Ce cortège funèbre formé de chars recouverts d'un drap mortuaire, accompagnés de prêtres en surplis chantant l'office des Morts se renouvellera chaque soir au déclin du jour pendant quinze mois, sauf durant les chaleurs d'été.
Le 7 avril 1786, sous la conduite de Guillaumot et d'architectes, les abbés Mottret, Maillet et Asseline consacrent ce qui sera désormais les Catacombes de la Tombe Issoire. Le même jour commence le transfert des ossements du cimetière des Innocents et ceux du cimetière voisin de Saint-Eustache. Ce cortège funèbre formé de chars recouverts d'un drap mortuaire, accompagnés de prêtres en surplis chantant l'office des Morts se renouvellera chaque soir au déclin du jour pendant quinze mois, sauf durant les chaleurs d'été.
Les ossements retirés de la couche supérieure du cimetière et des charniers des Innocents -5 des 8 pieds qui surplombait les rues environnantes- remplirent plusieurs milliers de tombereaux soit un total de 10 000 m3. On en enleva encore en 1786, 1787, 1788, 1809, 1811, 1842, 1844, 1846, 1859, 1860, et bien d'autres par la suite.
Au fur et à mesure de la suppression des cimetières parisiens, puis à chaque fois que des travaux d'urbanismes étaient entrepris, les ossements découverts furent transportés aux Catacombes avec un cérémonial très simplifié.SOURCES
http://geos1777.free.fr/cata_ossuaire_histoire.htm
 votre commentaire
votre commentaire
-
Alphonse Boudard, interview inédite
Il y a eu dix ans le 14 janvier 2010 qu’Alphonse Boudard a calanché. Boudard, contrairement à Bob Giraud , je l’ai rencontré.
Ah, je ne peux pas prétendre avoir été son ami, ça serait bien me vanter. Je l’ai invité deux fois à l’Obsidienne, la librairie que je tenais avec mon amie Hélène Bachet, à la Bastille, de 1989 à 1991.
Affable et chaleureux, Boudard possédait une espèce de prestance, une élégance mâtinée voyou, comme dirait Claude Dubois, qui n’incitait pas à lui taper sur les cuisses en sortant des vannes un peu graveleuses. Bref, c’était un monsieur.
Mais pas un de ces messieurs au cerveau calciné par des humanités acquises à grandes pelletées. C’était un monsieur qui avait vécu.
Ses livres on le sait puisaient du côté de l’autobiographie. Sa vie était un roman. Et lui un grand bonhomme qui, sans compter, accorda du temps au journaliste débutant que j’étais.
J'ignorais alors que l'auteur de La Métamorphose des cloportes avait connu Bob. Il faut dire qu'à l'époque, je ne connaissais pas ce dernier (ceci explique cela...).
Peu après la sortie de l’Age d’or des maisons closes (Albin Michel, 1990), l’auteur étant venu le dédicacer dans ma librairie, je lui avais proposé de l'interviewer dans l’idée de placer le papier quelque part.
Je viens de retrouver notre discusion en classant de vieux papiers. Le voici en exclusivité, 19 ans après !
Vous remarquerez au passage que les propos d'Alphonse Boudard à propos des maisons closes et de la prostitution en général n'ont pas pris une ride...
(Spéciale dédicace à Jean-Michel Moret qui sait pourquoi)
Olivier Bailly : A quand remonte votre intérêt pour les maisons closes ?
Alphonse Boudard. Je vais essayer de vous expliquer exactement la genèse de tout ça. J’ai toujours vécu avec ces histoires de bordels, de prostitution en toile de fond parce que ma mère se défendait comme ça.
Quand on m’a fait des reproches sur le fait que je choisissais ce sujet j’ai dit que j’étais mieux placé qu’un autre pour en parler. Bon, historiquement, il fallait que j’apprenne des tas de choses, mais enfin, pour l’essentiel, j’avais compris un petit peu de quoi il s’agissait. J’ai évoqué les maisons dans différents livres, par exemple dans Bleubite où il y a une scène célèbre dans un bobinard, mais je n’avais pas l’intention du tout d’écrire là-dessus. Un jour, j’ai raconté à un ami, qui est directeur littéraire chez Laffont, ce que je savais sur la mécanique de la Fermeture. Il me dit « Faut faire un livre ».
Moi je lui réponds que ça ne me paraît pas intéressant, suffisant, que tout ça est anecdotique seulement. Il en parle à Robert Laffont qui me rencontre, on discute et, de fil en aiguille, on en arrive à un contrat et un livre qui s’appellerait La Fermeture et qui serait inclus dans une collection, Ce jour-là dans laquelle il y avait eu le 6 juin 1944 le jour le plus long, le 14 juillet 1789 la prise de la Bastille, etc. et je pensais que finalement dans l’histoire les mœurs ont beaucoup d’importance et que le 13 avril 1946 est une date historique qui est d’ailleurs passée inaperçue parce que c’est une chose qui paraissait à l’époque un détail. Et puis la collection s’est arrêtée entre-temps, mais on a fait le livre qui s’appelle donc La Fermeture, le 13 avril 1946. Quarante ans après, en 86.

OB : Maintenant ça fait 45 ans. On va faire une fête… les rouvrir ?
AB : Ben oui… Pourquoi pas ? Non, ce n’est pas possible de les rouvrir parce que c’est le passé. La marine à voile, quoi. Ça ne pourrait se rouvrir que sous une forme très, très différente. D’abord, légalement, on ne peut pas le faire parce qu’on a adhéré à une convention européenne sur le traitement des êtres humains en 1949, donc on ne peut pas. On a supprimé la peine de mort, on ne peut pas revenir sur cette question à cause de cette fameuse convention. C’est pareil avec les maisons closes. Bien sûr, on peut toujours se débrouiller de casser avec les autorités européennes sur ce problème, mais enfin on ne va pas s’amuser à ça. Et puis, surtout, les choses ont évolué tellement depuis 45 ans… On ne se rend pas compte, mais on a évolué dans la plupart des domaines infiniment plus en 45 ans qu’en 800 ans auparavant.
Les mœurs s’en sont ressenties. L’éclatement de mai 68 fait partie de cette évolution. Alors, ce que je dis, par rapport à 1946, c’est que, si l’on n’avait pas fermé les maisons (parce qu’on ne les a pas fermées pour des raisons sociales ou morales, mais pour des raisons politiques), elles auraient continué, mais différemment. Parce que les filles qui viennent dire aujourd’hui « c’étaient des ghettos épouvantables… » ne le pourraient plus. Maintenant, les maisons seraient contrôlées par la police, par la sécurité sociale et les filles qui y travailleraient bénéficieraient toutes de l’assurance sociale, des congés payés et de la retraite comme les autres travailleurs…
OB : Des fonctionnaires du sexe…
AB : Oui, des espèces de fonctionnaires du sexe et ce serait encore le meilleur moyen pour contrôler le proxénétisme. Le gros défaut des maisons, c’est qu’elles étaient l’affaire des proxénètes et de la police, alors…
OB : Pourquoi de la police ?
AB : Parce que les proxénètes les contrôlaient et elle savait beaucoup de choses par les maisons. Maintenant les flics vous disent qu’ils s’en foutent, qu’ils ont les écoutes et que c’est bien plus intéressant que le bordel. Alors vous voyez que les choses ont évolué.
Photo Mandor
OB : A l’époque, la police a t-elle tenté d’exercer des pressions pour que les pressions restent ouvertes ?
AB : Oui, elle a essayé, mais elle ne le pouvait pas. Elle n’était pas assez forte. Pendant une période d’environ trente ans elle a essayé de faire marcher les clandestins, ce qu’on appelait les « clandés », c’est-à-dire des maisons qui avaient une autorisation des flics et qui continuaient à fonctionner. Marcellinest arrivé en place et a démantelé tout ça. Après, il y a eu les systèmes des flics qui contrôlaient les hôtels de passe. On a aussi démantelé ça en faisant tomber les patrons des hôtels pour proxénétisme hôtelier. A chaque fois on a cassé un peu le système, mais il renaissait toujours d’une autre façon et, la grande difficulté, c’est que, quand il renaît, on le contrôle encore moins et il est encore plus douloureux peut-être pour les prostituées.
Je veux dire qu’elles avaient plus de protection dans un bordel que dans le Bois de Boulogne, plus même dans un hôtel de passe qui était pourtant lamentable que dans le Bois de Boulogne. Quand Madame Barzach a été se balader naïvement dans le Bois, elle est revenue horrifiée en disant qu’il fallait rouvrir les maisons.
C’était une réaction de femme qui ne connaissait pas le problème. Les flics répondent à ça d’une part on ne peut pas les rouvrir à cause de la convention que j’ai évoquée et d’autre part qu’il vaut mieux les garder dans le Bois de Boulogne parce que pendant qu’elles sont là elles ne sont pas ailleurs et, au moins, on sait où elles sont… Mais pour en revenir à cette évolution dont je parlais tout à l’heure, je vois trois choses formidables depuis 1945 : il y a mai 68 et deuxième il y a la drogue. Autrefois, les macs tenaient les filles par le violon, la sérénade ? « j’t’adore », etc. Et puis il les mettaient au tapin et les tenaient ensuite par la violence. Maintenant, il y a la came. Et c’est terrible ! On met accroc les filles… Et puis tertio, qui va compliquer tout : le Sida. A ajouter à cela, que je rattache à 68 dans l’explosion des mœurs : les travestis, l’homosexualité. Alors, vous voyez que ce n’est plus la même chose. Quand on parle de nos histoires de l’âge d’or des maisons closes avec Romi, on parle du bateau à voiles, on parle de choses disparues.
OB : Ça fait partie de l’histoire
AB : Ça fait partie de l’histoire. Alors je ne vois pas pourquoi (agacé)…C’est là où j’ai été assez choqué. Parce qu’il y a des libraires qui ne me mettaient pas en vitrine ou qui disaient « nous on ne peut pas beaucoup vendre ce livre parce que notre clientèle ne comprendrait pas.. ». J’ai eu des gens qui venaient faire signer le bouquin en disant « mettez pas mon nom surtout ».
OB : Ou « c’est pour un ami »
AB : Ouais, c’est pour un ami ou « ah oui, j’aime bien lire vos livres, mais je ne peux pas prendre celui-là, je ne peux pas le laisser dans ma bibliothèque… ». On en est là. Des contradictions. ! D’un côté tu as Canal+…Minuit… T’as un film hard. Et de l’autre t’as des gens qui te disent ça. Tout cohabite, c’est curieux.
 OB : C’est vachement plus puritain qu’il y a 45 ans
OB : C’est vachement plus puritain qu’il y a 45 ansAB : Ah oui ! Onen parlait plus facilement parce que ça existait. On disait bon y’a le bordel et puis voilà.
OB : C’était une institution, en somme ?
AB : Dans une petite ville il y avait l’église, il y avait le bistrot du coin, le bordel et le couvent des oiseaux, enfin il y avait différentes choses qui cohabitaient. Et c’est fini. C’était une espèce de tissu social qui était autour du village, autour de l’artisanat, de la paysannerie, qui n’existe plus. Evidemment, on parle de marine à voile, c’est bien d’en parler parce qu’on dit « il est magnifique ce voilier, il est formidable », mais il y a les mecs dans la galère qui rament aussi, puisqu’on est sous Louis XVI… Donc, c’est beau, c’est une très belle chose à voir, mais, bien sûr, il y a toujours le côté noir… Ceux qui travaillent dans les soutes.
OB : Vous ne prenez jamais parti ?
AB : Ah je peux pas ! Je peux pas ! D’abord, je ne suis pas juge. Je ne dois pas me placer d’un point de vue ou d’un autre. Il est évident que quand je parlais des grands criminels, j’ai essayé de faire la part des choses. D’un côté les circonstances atténuantes et de l’autre les circonstances aggravantes. Prenons le cas de Bonnot. On vient de chez Maxim’s, on bouffe, on se conduit comme des procs devant ce qui type qui est seul aumonde. Mais auparavant, quand il est venu de Lyon avec son copain l’anarchiste et qu’il raconte comment il l’a blessé et achevé pour qu’il ne souffre pas et comment il lui a piqué son pognon… Là il se conduit vraisemblablement comme la pire des crapules. Mais c’est pourtant le même homme. Quand je prends le cas de Landru. Il s’occupe de sa famille, il a quatre gosses, il n’est pas si mal (rires)…
OB : C’est un bon père de famille !
AB : Oui, mais même quand il est avec sa maîtresse, il est un remarquable amant, et pas seulement au lit, mais dans le comportement. C’est ça le comportement des hommes. Il faut tout dire. Et c’est pareil pour les bordels. Il faut dire ses splendeurs, ses attraits, ses drôleries et puis il faut dire aussi la tôle d’abattage, les horreurs. Je trouve qu’on ne peut pas faire une étude sérieuse sur les bordels sans lire par exemple le livre de Maxence Van der Meersch Femmes à l’encan qui a exprimé des choses justes.
OB : Donc il y avait maisons closes et maisons closes ? Il y avait les maisons de société où la fine fleur du tout-Paris venait prendre un verre sans forcément consommer et puis il y avait les tôles d’abattage, immondes…
AB : Si vous voulez, au départ, quand il y a les maisons, dans la première période du XIXème siècle, elles existent, on sait qu’elles sont là, on sait que les militaires vont dans ces endroits et que les messieurs qui ont des petites envies ou des passions particulières y vont également, mais on n’en parle pas. Et puis, à partir du moment où les artistes commencent à en parler, ça explose. Alors Lautrec, alors Maupassant, alors Lorrain, etc. Mais elles ne sont pas encor, à ce moment-là, au point de devenir ce qu’on appellera des maisons de société. La première expérience dans ce domaine c’est le Chabanais qui l’inaugurera. Le Chabanais est d’abord réservé aux membres du Jockey-club. Là, on fait dans le snob. C’est là que va venir le futur roi d’Angleterre, le Prince de Galles qui sera Edouard VII. C’est là que vont venir une quantité de gens chics, les présidents, les rois en vadrouille… Ils viennent tous faire un tour là et, par la suite, en 1920 et quelque, quand Jamet ouvre le One two two, il invente la formule club, il fait une sorte de complexe. Alors il y a le bordel avec les filles, il y a le restaurant où on fait le bœuf à la ficelle et puis il y a le club et les gens viennent. Ça va faire le renom de la maison parce que tout le monde va y passer.
OB : C’est une sorte de salon. Il faut en être ?
AB : C’est ça. Et le fait qu’on voit Maurice Chevalier, Tino Rossi ou Colette donnera de l’éclat à la maison. Forcément, c’est rare que des types du niveau de Maurice Chevalier ou Tino Rossi grimpent devant tout le monde avec une pute. Mais il y a d’autres clients qui sont des célébrités comme Georges Simenon ou Michel Simon qui y vont carrément et on le sait et ils ne s’en cachent pas du tout. Mon ami Romi, lui, allait faire des dessins. Il finissait par être copain avec la patronne, elle était contente, puis après il gardait les dessins et c’est comme ça qu’il a des témoignages. Il gardait les cartes de visites, les cendriers parce que c’est un collectionneur et c’est un peu un esprit savant. Alors ça, c’était la nouvelle formule. Après, il y a eu le Sphinx qui était une espèce de club, également, et les choses auraient pu encore évoluer. On aurait vu Régine qui aurait tenu à la fois sa boîte, un bordel, un restaurant, etc. Elle aurait été fabuleuse, là-dedans ! D’ailleurs, on a eu un projet de film ensemble sur un sujet comme ça. Elle collait bien.
OB : Un peu avant 1946, au moment de la guerre, il y avait déjà des rivalités entre les grandes maisons. Certaines étaient pro-allemandes, d’autres non…
AB : Ah oui…Bof…On a raconté ça après… Mais il y avait des rivalités sérieuses qui étaient des rivalités commerciales, si je puis dire. C’était comme Leclerc et Carrefour. C’était ça…. Sous l’occupation, à mon avis, il s’est passé la chose suivante : vous comprenez qu’un type qui fait un business où il vend des bonnes femmes, c’est un voyou. Souvent il vient de la plus basse truanderie et il a monté les échelons parce qu’il est intelligent. Quand l’occupation est arrivée, ils ne savent pas ce qui va se passer. Personne ne le sait. Alors, les Allemands filent des règlements, réquisitionnent des maisons pour eux et puis s’arrangent avec les voyous.
Les Allemands avaient un fric fou qui leur était donné par le gouvernement de Vichy au titre de l’indemnité journalière de guerre. Ce fric, ils le dépensent et il va alimenter tout. Il y a le marché noir, il est là, tout près, parce que vous pouvez pas tenir des maisons de luxe sans faire du marché noir. Vous n’allez pas là-dedans pour bouffer des rutabagas et boire de l’eau fraîche. Donc, il sonttrès liés aux Allemands et ils sont liés au marché noir et les Allemands savent que le marché noir est une bonne façon de tenir les gens.
Les plus intelligents parmi eux ne viennent pas en disant « dites donc, on va faire ça, si vous ne nous donnez pas ça, vous serez fusillés ». Non, ils corrompent, ils se démerdent, ils s’arrangent, c’est plus malin. Les seuls tauliers qui auront un esprit vraiment à peu près résistant sont des gens par exemple qui sont d’origine juive. Ils comprennent très vite de quoi il retourne et eux sont forcément coincés. Quelques-uns uns. Mais dans l’ensemble ils attendent l’évolution de la situation et quand l’année 43 arrive, le vent tourne, ils prennent des garanties : ils ont caché trois Juifs dans la cave, ils ont planqué un parachutiste anglais, ils donnent de l’argent à la résistance qui traîne par là, de façon à être peinards.
Mais la plupart ont été très mouillés avec les Allemands au point que beaucoup de grands tauliers, ceux qui tenaient les taules d’abattage, en croquaient avec la Gestapo. C’était une super police qui était au-dessus de la police française et qui pouvait envoyer chier les flics français en s’appuyant sur les Allemands.
OB : C’était une époque idéale pour la pègre qui régnait impunément
AB : Bien entendu. Quand la Libération est arrivée se sont conjuguées deux choses : les moralistes qui venaient du MRP, parti chrétien qui était contre le bordel, et les communistes qui parlaient au nom de la patrie. Vous ne pouviez pas demander aux autres de ne pas suivre. Il est évident que quand l’affaire se déclenche on ne voit pas la nécessité absolue de s’occuper de fermer les bordels. Ce qui a sauvé les choses à ce moment-là, ce qui a sauvé les abolitionnistes, ces les antibiotiques. Si les antibiotiques n’étaient pas arrivés en même temps on avait une situation qui grimpait dans le domaine prophylactique… Un recrudescence de maladies vénériennes genre syphilis. Alors on aurait fait machine arrière.
Et là, boum ! tout d’un coup, ils arrivent. Parce que les anti-abolitionnistes avaient dit « attention ! si vous fermez, vous allez voir, ça va grimper. Parce que les filles sont surveillées, ici ». Il y avait même des endroits, les fameux bordels qui étaient tenus par les Allemands, où la capote anglaise était obligatoire.
OB : Malgré son nom ?
AB : (Rires). Malgré son nom, c’est que j’allais dire…Donc, la situation était grave et, tout d’un coup ça a été le miracle. C’est à ajouter à ce que je disais tout à l’heure à propos de l’évolution des mœurs. Il y a eu en 46-47 l’arrivée des antibiotiques qui suppriment les maladies vénériennes importantes de l’époque.
OB : A l’époque ça ne pardonnait pas…
AB : Sauf que le syphilis n’était pas mortelle à tous les coups et qu’on pouvait parfois en guérir... Si elle était prise à temps et même avant les antibiotiques. Et puis sont arrivés la pilule et tous les contraceptifs possibles plus la loi qui autorise la loi sur l’avortement. Autant de choses qui ont compté dans cette fameuse évolution des mœurs. <!--[endif]-->
OB : Venons-en à Marthe Richard. Vous avez découvert à son sujet des choses inavouables. Etait-elle complètement pure ?
AB : Ah non, non… Pas du tout. Je suis sévère avec elle quand elle se place sur le plan où elle s’est placée en disant « je suis une moraliste qui a fait fermer les maisons ». Ça , c’est une blague. Là, je démonte tout le truc et ça n’a été possible qu’après sa mort parce qu’elle avait bénéficié d’une loi d’amnistie en 47 et on ne pouvait évoquer un certain nombre de choses dans sa vie, entre autres le fait qu’elle avait été elle-même prostituée et qu’elle avait eu des problèmes pour des affaires de drogues et des complicités d’escroquerie avec des personnages qui émargeaient à la Gestapo du boulevard Flandrin. C’était donc on ne peut plus noir. Elle a cependant réussi ce tour de passe-passe de devenir le symbole de la lutte contre la prostitution.
OB : Elle s’est refait une vertu
AB : Ah oui ! Totalement ! Et elle n’a joué que de la vertu, après. Elle est morte à 92 ans, avec la Légion d’honneur. On disait « Marthe Richard, la mère la vertu ». C’était pas ça du tout ! C’était le contraire. Voilà. Quand j’ai écrit le livre j’en ai consacré la moitié à Marthe Richard pour démontrer point par point qu’il s’agissait d’une légende. Je l’ai fait avec des documents très sûrs, de police. J’ai eu la fiche des renseignements généraux entre les mains eh bien, malgré cela, on entend toujours les gens dire « Ah ! Marthe Richard qui a fait fermer les maisons…Cette dame est respectable, c’est formidable ». Bon, elle n’a pas toujours eu 80 ans. D’où viennent les vieilles dames !
OB : Revenons à la maison. Ou plutôt aux maisons. Filles du trottoir et filles des bordels bénéficient-elle du même traitement artistique ?
AB : On trouve une littérature autour des filles du trottoir. Chez Carco, chez les auteurs de la Série noire…Parce qu’il y a le lieu. Vous ne retrouverez pas cette jubilation ni ces artistes autour des taules d’abattage. Il y a quelques croquis, il y a des histoires, mais elles sont assimilées à peu près aux filles de la rue. Ce qui a provoqué l’intérêt des artistes autour des maisons c’est précisément parce qu’il y a eu le cadre, il y a une espèce de cérémonie, un lieu d’amour, le temple de l’amour physique, et puis il y a « Madame », il y a une ambiance et puis les gens, comme du One two two, du Chabanais, de la rue des Moulins où Toulouse-Lautrec avait sa chambre, ont créé un certain climat.
OB : Une mythologie ?
AB : Une mythologie. Et ils sont revenus en cela à l’Antiquité…Ce que l’on peut reconstituer de Pompéi, on le doit aux artistes de ce genre. Voilà pour les maisons luxueuses. Les maisons de qualité moyenne, si je puis dire, ont été reconstitué par des gens comme Lorrain ou Maupassant dans leur côté convivial, province, etc. C’est vrai que si vous imaginez des gens qui sont par exemple représentants de commerce, ils arrivent dans une ville, à Yvetot, à Carpentras, le soir, ils sont au restaurant, je les ai vus, j’ai été dans des endroits comme ça pour des films ou des livres, ils bouffent puis ils vont regarder la télé et ils vont se coucher. S’ils ont des envies d’aller draguer ou de chercher une fille, ils ne trouvent rien ! Il y a des fois des espèces de boîtes qui sont à 25 kms, puis barka ! Ils ne vont pas aller se fatiguer là toute la nuit. Quand ils avaient le bobinard, ils connaissaient, ils y allaient, ils se retrouvaient entre copains, ils y venaient pour consommer une fille ou simplement pour prendre un verre, une coup de champ’, je ne sais quoi… Ils discutaient avec la patronne, elle les connaissait, c’étaient le gars qui vendait le Pernod ou qui vendait des bas ou de la porcelaine [lire l’excellent Femmes blafardes de Pierre Siniac, Rivages. Ndr]… C’était ça.
OB : Il y avait donc un aspect très social
AB : Ah complètement, complètement ! C’était des bistrots avec des « montantes ». C’était ce que racontaient des gens comme Maupassant.
OB : Au moment de la Fermeture, des gens se sont retrouvés sur le sable, et pas seulement les filles.
AB : Les macs se sont pas trop mal débrouillés. Ils ont pris des prête-noms qui ont tenu les hôtels de passe et puis eux ils sont allés se retirer à la campagne, pécher à la ligne, taper le carton… certains, qui avaient des maisons de luxe, des maisons très célèbres, n’ont pas pu se recycler parce qu’on ne pouvait pas remplacer, refaire autre chose d’équivalent au One two two ou au Chabanais et ils ont été plus ou moins ruinés. Ils ont essayé de se lancer dans d’autres activités, mais ce n’était plus pareil. Alors le bluff a été pour les filles. Parce qu’on racontait « bon on va fermer les maisons et le problème est résolu », mais il n’est pas résolu du tout et elles se sont toutes retrouvées sur le trottoir. Elles avaient les mêmes macs, les mêmes structures, elles étaient autour des hôtels et elles faisaient le tapin dans la rue Saint-Denis ou à Barbès-Rochechouart. C’était exactement la même chose.
OB : Pire peut-être ?
AB : Peut-être pire, en tous cas, parfois, elles étaient carrément dehors et quand il fait froid…Alors il y a des gens, très respectables d’ailleurs, qui veulent sauver des filles de joie et qui leur proposent des lieux genre petite pension de famille où on va les rééduquer, leur apprendre un métier, mais ça a marché que pour des putes qui étaient en bout de parcours. Ils sont à côté de la plaque parce qu’ils font des choses tout à fait honorables, utiles, mais pour une infime minorité…
OB : Que sont devenus les objets baroques, les objets particuliers que l’on trouvait dans les maisons closes ?
AB : ça a été baladé de tous côtés, mais la plus grande vente a été faite après la Fermeture par Maître Maurice Rheims qui est aujourd’hui à l’Académie française. Romi, lui, a récupéré certaines choses.Le fameux siège et la baignoire en cuivre rouge en forme de cygnes se sont retrouvés chez Alain Vian, le frère de Boris, et chez Dali. C’est Dali qui a acheté la baignoire. Il trouvait que c’était un objet éminemment surréaliste. Le siège a été revendu en salle des ventes où il a fait 22 millions de centimes et c’est la descendante de l’ébéniste qui l’avait fabriqué qui l’a acheté.
OB : Est-ce qu’il y encore de signes visibles, des preuves de l’existence de ces maisons dans Paris aujourd’hui ?
AB : Il y a encore des petites traces par-ci par là, mais les principales maisons n’existent plus. Le Chabanais, par exemple, est toujours là. Il y a des gens qui y vivent. Rue des Moulins, il n’y a plus rien. Je crois qu’il y a une agence de voyage à la place. L’immeuble où était le Sphinx a été démoli, boulevard Edgar-Quinet. Reste comme témoignage évident celui où, dit-on, le Maréchal Goering est venu baiser un jour de 1941 au 50, rue Saint-Georges.Au 9, rue de Navarin il faut que vous essayiez de rentrer sous le porche et de regarder de côté. Là on comprend tout de suite. D’abord, il y a une façade curieuse. Il y a des fenêtres en forme de hublot et puis, sur le côté, on peut découvrir ce que c’était.
Au 106 boulevard de La Chapelle était une taule d’abattage célèbre qui est devenue après la Fermeture et pendant 25 ans environ le siège de l’Armée du salut. Et puis maintenant c’est un bazar nord-africain. Au One two two, 122, rue de Provence, c’est maintenant le syndicat des cuirs et peaux…Je crois qu’il y a eu un grand tort… On aurait du garder le Sphinx, le Chabanais, le One two two, la rue des Moulins, il y en a eu plusieurs comme ça… Enfin, on aurait pu en garder deux, trois. C’est des pièces historiques. On va bien voir la Conciergerie. C’est une taule, hein ? C’est moins gai encore
OB : Vous avez travaillé en collaboration avec Romi pour ce bouquin. Son nom évoque malheureusement peu de choses pour les lecteurs d’aujourd’hui. Pourriez-vous nous en parler ?
AB : Ah Romi ! Romi est un type formidable ! C’est un homme qui a tous les dons possibles. Il dessine très bien, il écrit très bien et il s’intéresse à tout ce qui est la petite histoire et aux choses qui paraissent être sans importance, mais qui finalement en ont. Il a fait de nombreux bouquins. Il y a quelques années il a sorti un livre tout à fait intéressant sur les célébrités oubliées. Il a regardé depuis 1789 les types qui, en leur temps, tout à coup, ont été aussi célèbres qu’aujourd’hui pourrait l’être Tapie et puis qui sont oubliés. Il s’est beaucoup occupé de l’histoire des mœurs puisqu’il a fait des livres sur la prostitution et il a une documentation, une iconographie fabuleuse. Il s’est intéressé à l’art, aux surréalistes notamment, et à l’art naïf.

Robert Doisneau
C’est un homme qui toute sa vie a collectionné des choses autour de lui. Il est âgé, il a un esprit absolument de jeune homme. Il est en train de faire un bouquin sur l’histoire anecdotique du pet depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours ! Je lui fais une préface. C’est un volume énorme. Il a été chercher des parties de pétomanie sous Louis XIV ! C’est formidable ! Il a un esprit curieux. On peut lui parler de n’importe quoi, il sait tout. Il a fait un n0 du Crapouillot sur les monstres. Non, mais vraiment, c’est un type qui m’épate ! Il a donné dans le fait-divers aussi. Enormément. Je suis certain que c’est un auteur qu’il faudra redécouvrir, qu’il faudra rééditer. Au même titre que Marcel Montarron qui a été le grand homme du fait-divers depuis la naissance de Détective jusqu’à ce qu’il s’arrête. Je voudrais bien qu’on redécouvre Romi parce que c’est aussi très précieux, ça fait vraiment partie de la culture, beaucoup plus que des spéculations intellectuelles. <!--[endif]-->
OB : A part ça, quoi de neuf ?
AB : Eh bien, je prépare une série d’émissions pour la télé sur des faits-divers. Je vais en tirer un bouquin…
OB : Et un roman ? Bientôt ?
AB : Pas maintenant. J’en ai un dans les tiroirs en préparation, mais ce n’est pas pour maintenant.
SOURCES
http://robertgiraud.blog.lemonde.fr/2010/02/07/
alphonse-boudard-interview-inedite/
 votre commentaire
votre commentaire
-
Les Pierres Fatales
Symbolisme des joyaux. - Le langage des pierres précieuses. - Tragique histoire du diamant bleu.
- Le « Sancy » et le « Kohinoor ». - Un roi qui n'était pas superstitieux.
On a raconté que le diamant bleu, connu sous le nom de diamant de Hope, se trouvait dans le Titanic et j'imagine que les gens superstitieux ont dû accueillir cette nouvelle sans trop de regret.
Le diamant de Hope, en effet, passe pour être une de ces pierres fatales qui portent malheur. Le naufrage du paquebot géant de la White Star Line serait donc son dernier méfait. Englouti désormais dans les abîmes de l'Atlantique, le diamant bleu aurait terminé sa carrière maléfique, carrière singulièrement remplie, comme nous le verrons tout à l'heure.Dès la plus haute antiquité, les hommes ont attribué aux pierres précieuses des influences diverses. Ils ne se sont pas contentés de leur faire parler un langage symbolique : ils leur ont accordé tantôt des vertus, tantôt un pouvoir de maléfique ; ils en ont fait tour à tour de bonnes amulettes ou de funestes talismans.
Les Anciens croyaient même à la « lapidothérapie ». Certaines pierres avaient, prétendaient-ils, le pouvoir de guérir certaines maladies. Exemple : pour déshabituer les pochards de l'ivrognerie, on leur suspendait au cou une améthyste. Il parait que le remède agissait en ce temps-là.
Du moins, Dioscoride l'assure-t-il. Je doute qu'il ait gardé aujourd'hui son efficacité.
Vous auriez beau attacher toutes les améthystes du monde au col de certains ivrognes invétérés que vous ne les empêcheriez pas de succomber aux charmes de l'alcool.
Les pierres avaient toutes, comme les fleurs, leur sens symbolique ; elles possédaient, en outre, chacune leur pouvoir particulier, leur influence sur l'âme ou sur la destinée des personnes entre les mains desquelles elles se trouvaient.La cornaline induisait à la mélancolie ; l'onyx était également symbole de tristesse.
Au contraire certaines agates rouges avaient la propriété de chasser les pensées mauvaises et les idées noires.
La sardoine faisait naître l'amitié entre hommes et femmes ;
La sardonyx inspirait la chasteté et la pudeur à qui la portait.
L'oeil-de-chat. donnait santé, richesse et longue vie ;
le jaspe procurait l'éloquence, on l'offrait aux avocats et aux prédicateurs.
Le corail détournait du meurtre, préservait des mauvais génies, éloignait les terreurs paniques, il chassait les mauvais rêves et enlevait aux enfants toutes craintes nocturnes, il apaisait la tourmente et la fureur des vagues. Il guérissait, par surcroît, les maladies d'yeux.
L'ambre: avait également une influence thérapeutique : c'était un remède préventif contre le goître ; on l'employait contre la surdité et aussi contre l'obscurcissement de la vue.
La croyance populaire, d'ailleurs, attribue à la plupart des pierres ou des matières précieuses, dont on fait des bijoux, un heureux effet sur la vue. On gardait autrefois, au château de Vériville, dans l'Isère, un diamant qui guérissait de la cataracte.De cent lieues à la ronde on venait lui redemander la vue.
L'aigue-marine apportait l'espérance dans le malheur; le béryl donnait à la femme le pouvoir de se faire aimer par l'homme de son choix.L'hyacinthe passait pour procurer, à qui la possédait, tous les honneurs terrestres.
La malachite était le symbole de la tranquillité ; elle préservait des procès et donnait le succès dans les affaires.
D'autres pierres encore, l'opale, le saphir, la topaze étaient regardées nomme des porte-bonheur.
Plus rares étaient celles auxquelles la croyance populaire attribuait une influence funeste.Les pierres n'étaient maléfiques que par exception ; et le fait que le diamant de Hope a conquis la triste renommée que l'on sait, ne veut point dire pour cela que tous les diamants bleus soient des jeteurs de mauvais sorts
Mais l'histoire de cette pierre est, en effet, liée à une telle suite de calamités qu'on ne saurait s'étonner de la fâcheuse réputation que le diamant bleu a conquise, par le monde.* **
Il y a exactement deux cent quarante- quatre ans que le diamant fatal fit son entrée en Europe. C'est en 1668 que le célèbre voyageur Tavernier le rapporta des Indes avec un certain nombre d'autres pierres précieuses qu'il vendit à Louis XIV pour la somme de trois-millions. Le diamant bleu avait été trouvé dans les mines de Golconde.
Il commença par porter malheur à l'homme qui l'avait rapporté. Peu de temps après son retour Tavernier que son commerce de pierres précieuses avait fait très riche perdit toute sa fortune. Quoique vieux déjà, il se remit en route pour la Perse, fut pris par la fièvre et mourut abandonné de tous en ce pays lointain.Le roi Soleil ne garda pas pour lui le diamant bleu. Il l'offrit à Mme de Montespan, Or, du jour où la favorite se para du joyau fatal, elle commença de perdre la faveur du roi.
Cependant, l'influence funeste du diamant bleu n'est pas encore marquée par des catastrophes. Louis XIV fait monter la pierre dans un chaton qu'il porte au-dessus de son jabot ; le régent Philippe d'Orléans la porte de même.
Louis XV, en 1749, commande au bijoutier Jacquemin cette fameuse décoration de la Toison d'Or qui, à l'inventaire de 1791, fut estimée trois millions trois cent quatre vingt quatorze mille livres. Le diamant bleu fut la pierre principale qui orna cette Toison d'Or. Le « Bien-Aimé » la porta pendant tout son règne sans que la pierre fatale semble lui avoir causé de graves malheurs.
Marie-Antoinette la fit détacher de la Toison d'Or et la porta. On assure même que la princesse de Lamballe, séduite par l'éclat du diamant, demanda à la reine de le lui prêter et s'en para quelquefois. Or, Marie-Antoinette périt sur l'échafaud et la princesse de Lamballe fut massacrée par la populace révolutionnaire.
La vente des diamants de la couronne ayant été décrétée par l'Assemblée, en 1792, les joyaux furent transportés au Garde-Meuble, rue Saint-Florentin. Mais. dans la nuit du 16 au 17 septembre, des voleurs pénétrèrent, au moyen d'échelles de corde, dans la salle du premier étage où ils étaient enfermés, et, après avoir crocheté les armoires, s'emparèrent des plus belles pièces du trésor.
Le diamant bleu était parmi les pierres volées. Il tomba entre les mains d'un receleur nommé Cadet Guyot, qui l'emporta à Rouen, puis de là, en Angleterre.
Pendant près de quarante ans on perd la trace de la pierre fatale. On la retrouve alors chez un diamantaire d'Amsterdam, qui l'achète pour la retailler.
Ce négociant, nommé Fals, a un fils, gredin de la pire espèce qui, un beau jour, vole à son père les plus belles pièces de sa collection et s'enfuit. Le père Fals meurt de chagrin ; et le fils, traqué par la police, n'a d'autre ressource que de se suicider.
La pierre passe, on ne sait comment, à un pauvre diable de Marseillais, nommé Beaulieu, qui meurt de faim avec cette richesse dans sa poche.
Elle échoit ensuite à un Juif, nommé Daniel Eliason, lequel, en 1830, la revend au collectionneur Henry Thomas Hope, dont la famille, par une immunité singulière, la garde sans inconvénient jusqu'en 1901.
On pourrait croire qu'elle a perdu définitivement sa fatale influence : il n'en est rien. Celle-ci, au contraire, va se manifester plus cruellement que jamais.Un marchand de Londres, M. Weil achète le diamant bleu pour le compte de M. Frankel, joaillier de New-York. Celui-ci le cède à un courtier français nommé Colot, lequel le revend un million et demi au prince Kanitowski.
Le prince offre le diamant à une artiste des Folies-Bergère, qu'il tue d'un coup de revolver le premier soir qu'elle le porte.
Quand à l'intermédiaire, M. Colot, il devient fou peu peu de jours après cet événement.
Le propriétaire suivant, un joaillier grec du nom de Montharides, tombe dans un précipice avec sa femme et ses deux enfants.Le diamant est alors rapporté à Paris et acheté au mois de mai 1908 pour le compte de la Cour ottomane.
Abd-ul-Hamid le confie, pour le faire polir, à un certain Ibn Sabir.Cet homme, faussement accusé de tentative de vol, est bâtonné et jeté en prison. Un gardien veille sur le diamant : on le trouve étranglé. Un eunuque, Kouloub bey, lui succède : il est pendu par la foule pendant les troubles de Constantinople. Le sultan lui-même est détrôné et envoyé en exil.
Un riche marchand turc, M. Habib, achète le diamant. Il part pour un voyage en Extrême-Orient et périt dans un naufrage près de Singapour.
On crut même, alors, que le diamant avait disparu avec lui ; mais la pierre fatale était demeurée en France.
Enfin, en janvier dernier, elle fut achetée par un milliardaire américain pour la somme de 1.500.000 francs. Expédiée à son nouveau propriétaire, elle aurait disparu dans le naufrage du Titanic : et désormais le charme funeste serait définitivement rompu.***
Telle est l'histoire tragique et fatale du diamant de Hope. Ce n'est pas là, d'ailleurs, la seule pierre précieuse célèbre qu'on ait accusée de porter malheur.
Le premier diamant qui fut taillé, le Sancy, eut aussi jadis la réputation d'être un jeteur de mauvais sort. Charles le Téméraire le portait sur lui quand il fut tué à la bataille de Nancy en 1477.
Plus tard, un serviteur, auquel le sieur de Sancy l'avait confié, fut assassiné par des brigands de grand chemin. Henriette de France, fille de Henri IV et femme de Charles Ier d'Angleterre, dont la vie fut une longue série d'infortunes, le posséda et l'apporta en France lorsqu'elle s'y réfugia. Elle fut même forcée de vendre le diamant fameux pour se procurer quelques ressources.
Le Sancy, acheté par le domaine de la couronne, semble dès lors perdre son influence néfaste. Il fut volé en 1792 avec le Régent, le diamant bleu est diverses autres pierres célèbres. Depuis 1829 il figure parmi les joyaux d'une famille princière de Russie.
Autre diamant fatal, le Kohinoor qui, suivant une légende hindoue, condamne tous ses possesseurs à mourir tragiquement. De fait, le Grand Mogol Humayan, son premier propriétaire, fut chassé de ses états et succomba dans l'exil.
De ses descendants qui se léguèrent la pierre néfaste, l'un mourut en esclavage, l'autre en prison ; le troisième eut les yeux crevés. Le vainqueur de ce dernier s'étant emparé du Kohinoor, le porta. Il fut assassiné par son fils. Le diamant passa ensuite dans le trésor des souverains persans puis revint au roi de Lahore qui, il y a environ un demi-siècle, l'offrit à l'Angleterre.
La reine Victoria le laissa dormir au fond de son écrin. Mais, Édouard VII, en dépit de la mauvaise réputation du diamant, le fit enchâsser dans le diadème que portait la reine Alexandra le jour du sacre. .
Edouard VII n'était pas superstitieux....N'est-ce pas là le meilleur moyen de rompre le mauvais sort que la croyance populaire attribue aux pierres fatales?
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 5 Mai 1912
http://cent.ans.free.fr/pj1912/pj112005051912b.htm
 votre commentaire
votre commentaire
-
Le Petit
 Journal
JournalSUPPLÉMENT ILLUSTRE
D'MANDEZ LES DERNIÈRES NOUVELLES !
Le public est toujours extrêmement curieux de ce qui se passe dans les journaux et pourtant, depuis qu'il existe des feuilles publiques, on a mis en circulation tant de légendes que personne, sauf les professionnels, ne sait exactement ce qu'est ce formidable organisme; un journal moderne !
Notre collaborateur va promener, par la pensée, ses lecteurs dans les principaux services du Petit journal ; pour illustrer ses explications nous publions ci-après quelques photographies qui permettront à chacun d'apprécier la tâche de ceux qui sont chargés d'éclairer l'opinion publique.
Comment on fait un numéro d'un grand journal d'informations
Vous habitez, à Paris, un quartier de la périphérie, ou bien vous êtes installé dans une ville des départements. Il est huit heures du matin. On vous apporte le Petit Journal qui, d'ailleurs, depuis une heure ou deux, était sur le paillasson, devant votre porte ou dans la loge de votre concierge.Vous le dépliez. Vous y jetez un coup d'œil. Aussitôt, vous savez que, la veille, à onze heures du soir, le boxeur Criqui a battu Kilbane, à New-York, qu'un grand crime a été commis aux environs de Versailles, sur le coup de deux heures du matin, qu'un bijoutier de la rue, de la Paix s'est aperçu, à l'aube, qu'il avait été cambriolé. En troisième page, on vous annonce une éruption de l'Etna.
Vous avez beau être blasé.Vous avez beau, peut-être, avoir des préjugés sur les journalistes et répéter, sans y attacher d'ailleurs autrement d'importance, des plaisanteries sur leur façon de travailler. Les jours où l'actualité est aussi chargée, vous avez un mouvement d'étonnement. Et vous vous dites :
- Comment font-ils pour savoir tout ça ? Comment font-ils pour me le rapporter si vite ? Comment font-ils - puisqu'il y a des photos dans mon journal pour me le faire voir ?
Si vous le voulez, ami lecteur, nous allons tâcher de satisfaire rapidement votre curiosité. Nous allons vous montrer comment on fait un numéro d'un grand,'journal d'informations. Nous allons, comme on dit vulgairement, « débiner nos trucs ». Si la promenade vous intéresse, suivez le guide.
Les sources des renseignementsPour publier un journal rempli d'informations intéressantes, il faut savoir les recueillir à la source et n'en « rater » aucune. Il faut donc avoir des « yeux » et des « oreilles » dans tous les endroits où il peut se passer quelque chose, où, tout au moins parvient le premier écho d'un événement.
C'est pourquoi, rien qu'à Paris les informateurs du Petit Journal qui passent leur journée au dehors sont extrêmement nombreux.Il y a d'abord les préfecturiers, qui demeurent en permanence à la Préfecture de Police pour y récolter toutes les « affaires » dont les limiers du quai des Orfèvres ont à s'occuper. D'autres rédacteurs font « la tournée des commissariats » pour s'y tenir au courant des faits divers moins importants.
D'autres rendent visite aux bureaux de la Sûreté générale et à ceux de la brigade mobile afin de s'y renseigner sur les recherches et les enquêtes Policières en cours.
La Chambre et le Sénat ont leurs tribuniers et leurs couloiristes chargés, les uns, de faire le compte rendu des séances publiques, les autres d'informer le journal sur les travaux des commissions, les réunions, des groupes, les manoeuvres en préparation et les menus potins de la politique. D'autres informateurs sont attachés: à l'Élysée et aux divers ministères. Ils ont mission d'y recueillir les renseignements concernant

Un des ateliers de Photogravure où l'activité se poursuit nuit et jour.
les conseils des ministres, les projets de lois à l'étude, les mesures administratives en cours d'exécution. Tout ce personnel a à sa disposition des téléphonistes et des sténographes. Il fait partie du service politique qui a son centre aux bureaux du journal.
Au Palais de Justice se tiennent les rédacteurs qui font le compte rendu des procès et ceux qui suivent les instructions des affaires criminelles et correctionnelles.
Ceux qui s'occupent des faits et gestes du Conseil municipal sont en Permanence â l'Hôtel de ville.D'autres se tiennent à la Bourse pour se renseigner sur le cours des valeurs et celui du change. D'autres sont en liaison avec tous les organismes industriels, commerciaux, agricoles, scientifiques. Ils forment les services techniques de notre journal.
Les courses de chevaux sont justiciables de notre service hippique.
Les aérodromes, les stades, les rings de boxe, les courts de tennis, les terrains de foot-ball, les pistes et les routes où circulent les coureurs sont placés sous la surveillance de notre service sportif qui est un des mieux agencés de tous ceux qui existent dans la presse, y compris la presse purement sportive.
En haut, le service dactylographique où sont reçus et recopiés les message de nos correspondants de province.
Au milieu, le standard téléphonique où deux employées se relayent sans interruption.
Un coin d'une des salles de rédaction.Des rédacteurs spécialisés s'occupent des académies, des universités, des écoles, dit mouvement social, des salons et des expositions artistiques, des théâtres et des music-halls, des concerts, des livres, de la mode. Bref toutes les activités humaines sont observées attentivement par nous et aucune de leurs manifestations ne doit nous échapper.
En dehors des spécialistes que l'argot journalistique nomme des rubriquards, il existe tout une équipe de rédacteurs «volants », les reporters, toujours prêts à s'élancer vers les endroits ou il se passe quelque chose et où nous n'avons pas d'observateur fixe, ou à partir, comme envoyés spéciaux, pour n'importe quel lieu de la terre. Les reporters, souples et habiles par définition, comptent parmi les collaborateurs les plus précieux du journal.
Nous avons décrit sommairement quelques-uns des différents services installés à Paris et qui recueillent les informations parisiennes. Il faut y ajouter le service de la banlieue, avec ses reporters chargés de rassembler les nouvelles provenant des alentours de la capitale ; le service des départements qui est en relations télégraphiques et téléphoniques avec des correspondants établis dans toutes les villes et même les bourgades de France ; enfin le considérable service de l'étranger, chargé de réunir toits les renseignements envoyés par les correspondants des deux mondes et de les présenter à notre public.
Cette énumération de sources de renseignements serait encore incomplète si nous ne signalions pas l'existence de notre bibliothèque et de nos archives, admirablement classées, qui nous permettent de retrouver par exemple, en quelques instants, avec documents photographiques à l'appui, les origines de n'importe quelle affaire criminelle plaidée en cour d'assises, ou de dresser, en cinq minutes, la biographie d'un personnage important qui vient de mourir.
Quant à notre service photographique, son rôle, au point de vite de la récolte des renseignements par l'image, est très analogue à celui de notre rédaction et il a, comme elle, ses reporters et ses correspondants.
Une Section du Service des abonnements.
Le fonctionnement des services
Ce que nous venons de décrire sommairement, c'est en quelque sorte l'anatomie de quelques-uns de nos différents services. Reste à en expliquer la physiologie, autrement dit le fonctionnement. Chemin faisant, nous aurons encore à décrire plusieurs organismes qui servent à transformer la chose vue ou entendue en nouvelle imprimée et dont le public connaît très imparfaitement le rôle.
Mais il nous faut d'abord parler de quelques hommes qui sont l'âme même dit journal. Ce sont d'abord le directeur, le rédacteur en chef et le secrétaire général, trinité indissoluble et toute-puissante dont les délibérations servent à donner au journal son cachet personnel, à chaque numéro sa physionomie particulière.
Le chef des informations apporte une base à leurs travaux et tient compte ensuite de leurs conseils. C'est à lui qu'il appartient de prévoir tous les événements prévisibles et d'en assurer le compte rendu. Mais ce n'est là que la partie la plus facile de sa tâche. Il doit aussi avoir toujours sous la main les troupes informatrices nécessaires pour courir immédiatement vers n'importe quel endroit où il se passe quelque chose d'imprévu. Il centralise tous les renseignements qui lui parviennent. Il provoque des compléments d'enquête. Il aiguillonne constamment toute la rédaction du journal.
Représentons-nous le chef des informations à sa table. La journée est commencée. Il a en main le programme - encore incomplet - du prochain numéro.
En haut, le service des abonnements et des petites annonces.
Dans le médaillon, l'antichambre directoriale.
En bas, une partie du grand hall de la rue La Fayette.Il a en tète les directives générales, qui lui ont, été données. A chaque instant, on lui apporte des « papiers » C'est le compte rendu de la Chambre et du Sénat, téléphoné de quart d'heure en quart d'heure, à mesure que la séance se déroule, à l'aide de notre fil téléphonique spécial, et recueilli par nos sténo-dactylographes. C'est le compte rendu des procès en cours, expédié dans les mêmes conditions.
Ce sont les nouvelles de toutes sortes, envoyées des départements et de l'étranger, par des dépêches que les petits télégraphistes n'ont pas la peine de nous apporter, car elles sont recueillies directement par le central télégraphique installé dans notre journal. L'arrivée des nouvelles se fait normalement. La journée s'avance. Tout va bien.
Tout à coup, un de nos rédacteurs téléphone au chef des informations dix lignes sensationnelles : la Sûreté générale est sur la piste d'un assassin qui vient d'étrangler trois femmes, quelque part, très loin de Paris, mettons par exemple à Morlaix, dans le Finistère. Suivent les noms et les adresses des victimes, ainsi que quelques renseignements très succints les concernant et un signalement sommaire Lire du criminel.
Sans perdre un instant, le chef des informations expédie un envoyé spécial et un photographe à Morlaix, par le premier train. Il envoie trois rédacteurs dans Paris et dans la banlieue pour rechercher des parents des victimes qui se trouvent y habiter, pour les interroger et pour se procurer, si possible, des photos des pauvres femmes étranglées. Un quatrième rédacteur part à la poursuite des policiers chargés de l'enquête, avec mission de leur arracher des confidences
.

Un coin du Service d'Expédition du Petit Journal
Puis, le chef des informations se rassied et attend... Il n'attend pas longtemps... Déjà, notre correspondant de Morlaix vient de lui adresser un télégramme qui donne les premiers détails sur l'étrangleur. Une heure après, les reporters en chasse dans Paris téléphonent des interviews. Une ou deux photos arrivent. Dans la nuit, notre envoyé spécial télégraphie d'amples renseignements et notre photographe - qui a opéré au magnésium --- expédie des clichés sensationnels.
Ainsi les éléments d'une enquête approfondie parviennent, les uns après les autres, sur la table du chef des informations. A mesure qu' ils arrivent, ils sont soumis - ainsi d'ailleurs que tous les autres «Papiers » destinés à paraître dans le journal - à notre service de révision qui, suivant les indications du chef des informations, les résume, les met au point, les débarrassé des erreurs qui ont pu s'y glisser au cours de la transmission.
Une fois révisé, chaque « papier » descend à la « composition » où il se trouve prêt à être inséré dans les éditions successives du journal, qui absorbent ainsi les nouvelles à mesure qu'elles sont constituées. -
Pendant ce temps, le service photographique n'est pas resté inactif. Nos « tireurs » ont « contretypé » les photos qui leur sont parvenues, développé les plaques, exécuté des épreuves par des procédés quasi instantanés. Les épreuves encore humides sont

En haut, à gauche, une presse Marinoni.
En haut, à droite, une rangée de linotypes.
En bas, le « marbre », partie de l'atelier de composition où se fait la mise en pagesapportées au secrétaire général, qui choisit les meilleures et indique la façon dont elles devront être présentées dans le journal. Séchées au gaz et rapidement retouchées, elles passent à l'atelier de pholographure où, en moins d'une demi-heure, elles sont transformées en clichés sur zinc, à « passer » aussitôt dans nos colonnes.
Il en est de même des dessins et graphiques réalisés par nos artistes..
...Et maintenant, descendons à l imprimerie où nous attendent, nous l'avons vu, les « papiers » et les clichés.Les clichés y sont « montés », en quelques secondes, sur un socle de métal. Les « papiers » sont distribués par le « metteur en pages », qui est le chef de notre équipe de typographes, à ses linotypistes.
Une linotype c'est, on le sait, une machine à clavier qui fond et moule un caractère neuf chaque fois qu'on frappe sur une de ses touches. Ces caractères s'assemblent automatiquement et forment des lignes d'un seul bloc, faciles à réunir en colonnes.
Nous possédons un grand nombre de linotypes d'un nouveau modèle, capables de composer des articles en caractères très lisibles et très variés. Elles « composent » également les sous-titres et certains petits titres. La plupart des titres et sous-titres sont pourtant « composés » à la main par des ouvriers spécialisés, habiles et rapides.
Les articles, une fois « composés », « titrés » et Purgés de fautes d'impression par nos correcteurs, sont insérés dans des « formes », c'est-à-dire de grands cadres de fer installés sur des tables du même métal... et qu'on appelle pourtant le « marbre » de l'imprimerie.
C'est le metteur en pages qui réalise cette opération. Mais ici intervient l'homme qui a presque toujours le dernier mot en tout ce qui concerne la confection du journal, celui qui le « fait » matériellement, le secrétaire de la rédaction.
Grand maître de l'imprimerie, le secrétaire de la rédaction est aussi le juge absolu de tous les articles et de tous les clichés qui paraissent dans le journal. C'est lui qui détermine leur présentation typographique. C'est lui - et ses aides - qui les dispose, à son gré, dans le journal. C'est lui qui apprécie leur importance relative et les raccourcit impitoyablement, lorsque l'actualité le lui impose.
Le secrétaire de la rédaction, dont la besogne écrasante reste absolument anonyme, est la cheville ouvrière du journal. Sa principale qualité est le sang-froid.Si, à trois heures du matin, heure critique où les dernières éditions s'achèvent, lui parvient la nouvelle de la mort du pape, il doit conserver un calme parfait et dire posément au metteur en Pages
- Faites remonter « la une » de la clicherie. Faites sauter le cliché qui est en bas et représente une vue de l'exposition de chiens. Vous m'abaisserez ensuite les deux articles qui sont au milieu de la page. Et vous me mettrez la mort du pape en tête des 2e et 3e colonnes, avec des sous-titres « en 14 ».
Les secrétaires de la rédaction sont toujours sur la brèche. C'est à peine si lorsque les « formes », une fois « justifiées » et «serrées » partent vers la clicherie, il a le temps de souffler un Peu... avant de s'attaquer à une nouvelle édition....Cependant, on travaille à la clicherie. Par des procédés dont la description serait plus longue que l'opération elle-même, des « flancs » demi-cylindriques, en métal malléable, sont moulés sur les « formes »planes. Ces « flancs » sont placés sur les rouleaux de nos machines rotatives et le « tirage » du journal commence.
En moins d'une demi-heure, les merveilleuses « rotos » inventées par M. Marinoni impriment, brochent et plient des, centaines de milliers d'exemplaires à six et huit pages, avec le titre du journal en noir ou en rouge, prêts à Partir Pour tous les endroits de Paris, de la France et du monde où on lit le Petit Journal.
...Comment ils s'y acheminent ? Il faudrait décrire pour cela nos services de « départ » et de « routage », vous expliquer comment travaillent nos dépositaires et nos porteurs. Ce serait trop et nous avons été déjà bien long. Pourtant nous n'avons parlé ni de nos services d'abonnements et de Publicité, ni de notre administration.
Nous nous sommes borné à expliquer, en gros, comment on réalise des informations et nous n'avons pas dit comment on varie le texte du journal en y insérant des « leaders », des articles documentaires, des reportages « à côté », des fantaisies, des contes, des romans. Nous n'avons fait qu'un tableau très incomplet.
...Nous serions bien heureux, quand même, si, Par hasard, nous avions réussi à vous donner une petite, idée de ce qu'est un grand journal.L'Almanach du Petit Journal 1924 : GEORGES MARTIN
SOURCES
http://cent.ans.free.fr/visite%20services%20du%20petit%20journal/dernieres%20nouvelles.htm
COMMENT ON FAIT LE « PETIT JOURNAL ILLUSTRÉ » Le Petit
 Journal
JournalSUPPLÉMENT ILLUSTRE
La Direction de ce journal a demandé à ses lecteurs de rester en étroite communion avec elle et ce souhait a été longuement exaucé si l'on en croit le nombre considérable de lettres reçues, lettres d'approbation et d'encouragement très sincères
Dans ces conditions, nous avons pensé qu'il serait agréable à nos amis de les faire vivre un peu de notre vie, de leur montrer la succession d'efforts différents et pourtant concordants, nécessaires pour la fabrication d'un journal, de les faire pénétrer enfin dans les coulisses - si j'ose dire - d'un grand hebdomadaire illustré comme le nôtre
***
Ici, comme partout ailleurs, la division du travail s'impose. Au-dessus de tout, se trouve le Directeur qui, se basant sur l'expérience acquise et sur la connaissance du public à satisfaire,donne les directives à suivre et en surveille l'exécution. Sous ses ordres, le service de rédaction, rédacteur en chef, secrétaire général et secrétaire de rédaction, met en oeuvre et réalise les conceptions qui lui sont indiquées.
C'est ainsi que, chaque semaine, la rédaction s'occupe de réunir les matériaux qui composeront le numéro de la semaine suivante. Ces matériaux sont de deux sortes : d'abord ce qu'on appelle en terme de métier, la « copie », c'est-à-dire les articles et les contes; ensuite les illustrations, comprenant les dessins et les photographies.
Il y a là un travail très délicat, non seulement parce qu'il s'agit de plaire au plus grand nombre possible de lecteurs et que tous, on le pense bien, n'ont pas les mêmes goûts, mais aussi parce qu'il convient, pour être intéressant, de suivre l'actualité. L'actualité est fugace. Ce qui est intéressant un jour peut ne plus l'être huit jours après.
Or la fabrication d'un hebdomadaire est infiniment plus longue que celle d'un quotidien. On risque à chaque instant d'arriver trop tard.
Supposons pourtant les matériaux réunis entre les mains de la rédaction. Celle-ci les passe aussitôt aux organes d'exécution.La « copie » d'abord. Elle est envoyée au service de la composition. Autrefois, on ne l'ignore pas, on ne connaissait que la composition à la main.
Les caractères, distribués dans les compartiments d'une « casse », étaient pris, un à un, par un ouvrier qui en formait ainsi des lignes. Aujourd'hui, on a beaucoup simplifié et activé ce travail en utilisant des machines appelées linotypes.
Ces linotypes possèdent un clavier assez semblable à celui des machines à écrire. Il suffit à l'opérateur - qui est souvent une opératrice - - de presser chaque touche du clavier pour que la matrice de la lettre correspondante vienne tomber dans un compartiment destiné à la recevoir. Lorsque la ligne est complète, un simple coup de levier déclenche la machine.L'ensemble des matrices est présenté à l'orifice d'un foyer où se trouve du plomb en fusion. Il en résulte une petite tablette qui porte, sur une de ses tranches, les caractères en relief de la ligne tout entière. Les matrices sont enlevées et distribuées automatiquement dans le magasin d'où elles sortiront, à nouveau, lorsque l'opérateur pressera la touche correspondante.
De même qu'il y a des dactylos plus adroites que d'autres, il existe des opérateurs plus adroits. En moyenne, un bon opérateur compose 6.000 lettres, soit 150 lignes à l' heure.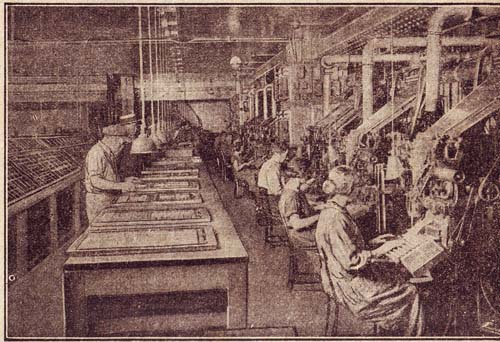
De jeunes opératrices composant les articles du journal à la linotype.
Quand tout un article ou tout un conte est composé, on en fait une épreuve en passant sur sa surface de l'encre grasse, puis en posant dessus une feuille de papier et en frappant avec une grosse brosse. L'épreuve ainsi obtenue est confiée à un correcteur. Celui-ci relit l'épreuve, la comparu avec la « copie » et signale les fautes de composition. Les fautes sont corrigées à la linotype en refaisant la ligne tout entière.
Seuls, les titres sont encore composés avec des caractères mobiles alignés, un à un, à la main. On commence toutefois à utiliser des machines spéciales pour faire les titres.
***
Pendant ce temps, les illustrations sont traitées par les services de photogravure.
Les illustrations en noir et les photographies sont reproduites par un procédé, courant aujourd'hui, et dont l'origine remonte à l'invention de Talbot, en 1852.Longtemps, il est vrai, on n'a connu que la gravure sur bois obtenue par le travail manuel de l'artiste, sculptant pour ainsi dire une planche de buis et le gravure sur cuivre, travaillée de même au burin. Aujourd'hui, grâce à une ingénieuse utilisation de la photographie, on reproduit mécaniquement sur zinc ou sur cuivre les documents destinés à l'illustration d'un journal.
Le procédé est le même, quoique plus délicat et plus compliqué, pour les grandes compositions en couleurs qui se trouvent à la première et à la dernière page du Petit Journal Illustré. Il faut noter toutefois qu'il est nécessaire d'obtenir autant de clichés qu'il y a de couleurs. Pour le noir, le bleu, le jaune et le rouge, cela fait quatre clichés qui seront, plus tard, fixés sur la rotative et sur lesquels passera successivement la feuille de papier blanc.
Quatre couleurs, direz-vous ! Mais il y a bien plus de quatre couleurs dans les gravures qui illustrent votre journal ? Sans doute, mais le vert s'obtient par la superposition du bleu et du jaune et les autres teintes par des superpositions du même genre.***
Enfin voici réunies la « copie » et les illustrations clichées. Alors commence le travail de mise en page.
Ce travail s'exécute sur de grandes tables que, par une très ancienne tradition, on continue à appeler « le marbre ». Sous la surveillance du secrétaire de la rédaction qui indique la place des articles et des clichés, ceux-ci sont disposés dans les formes ou de grands cadres de fonte qui les enserrent étroitement. Quand ce travail est achevé, on fait, du contenu de chaque forme, une épreuve qui porte le nom spécial de « morasse ».Les morasses sont révisées par le correcteur qui cherche à y dépister les dernières fautes oubliées ou les erreurs de mise en page. Puis le rédacteur en chef les examine à son tour et, s'il n'a aucune observation à faire, donne le bon à tirer.
Si l'on tirait sur des machines plates, on pourrait porter immédiatement ces formes à l'imprimerie.Mais nul n'ignore plus que, de nos jours, on utilise des rotatives pour les énormes tirages des grands journaux modernes. Un travail de transformation est donc encore nécessaire.
Il s'exécute à la clicherie.
Là, les formes apportées sont placées dans une machine spéciale qui moule sur elles une empreinte prise par une sorte de large carton de papier pressé. Ce flan, on l'incurve pour lui donner la forme exacte correspondant aux rouleaux de la rotative. Enfin, chaque flan, ainsi incurvé, sert à faire un ou plusieurs clichés cintrés, et ce sont ces clichés, résultat de toute une suite de transformations, qui serviront enfin à tirer le journal.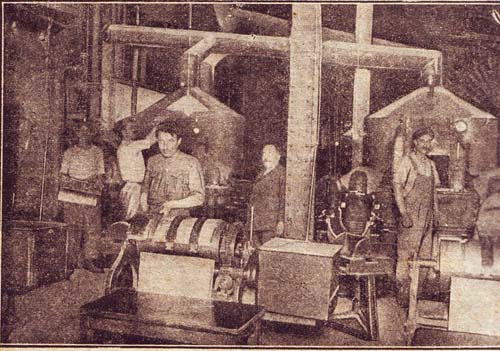
La clicherie où les formes servent à faire les clichés cylindriques.
Maintenant, c'est la dernière partie du travail d'exécution qui commence. Il se fait, comme je l'ai dit, sur une de ces admirables machines rotatives dont l'invention est due à Hippolyte Marinoni, à la fois créateur de l'imprimerie moderne et, pendant de longues années, directeur du Petit journal.Sous les ordres du chef conducteur, les clichés venant de la clicherie sont fixés sur les rouleaux de la machine et la grosse bobine de papier commence à dérouler sa feuille sans fin à travers les méandres des roues, des bielles et des innombrables organes d'acier.
Malgré l'apparence, la mise en train demande un soin minutieux. A cause des quatre encres différentes employées pour les gravures en couleurs, il faut se livrer à un travail de repérage très délicat. Il faut aussi régler la pression sur les clichés et l'arrivée des encres de façon que le texte ne soit ni trop gris ni trop noir. Enfin tout est prêt, après plusieurs heures d'expériences et d'essais.
La grande « roto » se met à dévorer le papier à toute vitesse et à le rendre sous la forme d'exemplaires imprimés, pliés, coupés, tels enfin qu'on peut les voir, quelques jours plus tard, chez les dépositaires et chez les marchands de journaux de toute la France.
On se rendra compte, par la comparaison de deux chiffres, des avantages de la rotative sur la machine plate ; celle-ci tirait autrefois un moyenne de 2.000 feuilles par jour. La rotative du Petit Journal Illustré, moins rapide pourtant que celle d'un quotidien, tiré uniquement en noir, débite 10.000 exemplaires par heure. - R
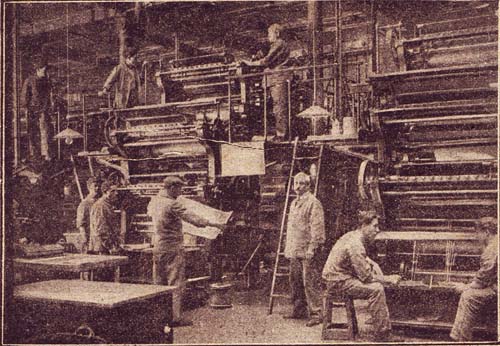
Les rotatives qui servent chaque semaine à tirer le « Petit Journal Illustré »
maj 27 mars 2011
sources
http://cent.ans.free.fr/fabrication%20petit%20journal.htm
 votre commentaire
votre commentaire
-

Les galeries du Palais-Royal,
ancêtre des passages couverts
Contexte historique
Une spéculation immobilière
Le Palais-Royal devint la propriété des Orléans, branche cadette du royaume de France, en février 1692, quand Louis XIV l’offrit à Monsieur, son frère. Le jardin du palais était alors ouvert sur la ville.
En 1781, Philippe d’Orléans, duc de Chartres, plus connu sous le nom de Philippe Égalité, est au bord de la ruine lorsqu’il entreprend un grand projet de spéculation immobilière consistant à lotir le pourtour du jardin du Palais-Royal. Il confie le projet à l’architecte Victor Louis, qu’il a rencontré à Bordeaux en 1776.Les maisons, larges de trois ou quatre arcades, sont élevées sur sept niveaux : un étage de caves, un rez-de-chaussée destiné aux boutiques et surmonté d’un entresol, un étage noble, un attique, un étage mansardé et un dernier, pris dans les combles, pour les domestiques. Ce lotissement amputait le jardin de près de 60 mètres sur sa longueur et de 40 mètres sur sa largeur, au grand dam des propriétaires mitoyens qui perdaient leur vue sur les parterres.
En 1786, les galeries de pierre étaient achevées sur trois côtés. Victor Louis avait prévu de fermer la cour d’honneur, au sud du jardin, par une colonnade surmontée d’une terrasse. Faute de crédits, le chantier fut interrompu au stade des fondations. Afin de protéger ces dernières, le duc concéda l’emplacement à un entrepreneur qui y construisit des hangars de planches abritant trois rangées de boutiques desservies par deux allées couvertes. Ce baraquement provisoire (démoli quarante ans plus tard !) servira de prototypes aux passages couverts de Paris.
Les marchandes de modes, perruquiers, cafés-limonadiers, marchands d’estampes, cabinets de lecture, libraires et autres commerçants se partagèrent les quatre-vingt-huit boutiques, tandis qu’une foule interlope de flâneurs, de joueurs, de pickpockets et de prostituées investirent le lieu et en firent le succès et la réputation.
Une scène de genre
Cette peinture à l’huile imitant l’estampe est la reprise d’un tableau, probablement en couleur, que Boilly exposa au Salon de 1804 et qui aurait été détruit lors de l’incendie de la préfecture de Paris en 1871.
L’image, rythmée par les arcades, se lit de gauche à droite. Le propos est introduit par des pourparlers engagés entre un homme derrière la grille et une femme vue de dos et dont les deux chiens, un noir et un blanc, se font l’écho. La composition, en frise, s’articule ensuite autour de trois groupes de figures où alternent un personnage féminin, vêtu de clair et en pleine lumière, et un personnage masculin en costume sombre, dans l’ombre.Les bras nus et tout en sinuosités des demoiselles sont autant d’invitations à la promenade tandis que les échanges de regards en coin et le placard « Avis aux sexes » permettent de comprendre l’activité de ces dames. Dans le premier groupe, l’affaire semble conclue et l’homme empoigne la femme par la taille. Accompagnée d’un petit garçon, la femme du deuxième groupe est en train de vendre ses charmes aux deux hommes qui lui font face.
La présence de l’enfant pourrait faire pencher l’interprétation vers une simple scène de la vie quotidienne, mais le geste et le regard de la jeune femme ne laissent aucune ambiguïté. Quant au troisième groupe, il reprend une iconographie licencieuse fort prisée au XVIIIe siècle : une fille caresse la marmotte nichée dans le panier d’un petit savoyard avec l’approbation de sa nourrice qui, dans l’ombre, lui sert d’entremetteuse.
La critique de l’époque reprocha à Boilly de ne pas avoir pris position contre le phénomène de la prostitution. En effet, il traite cette scène avec réalisme, sous la forme d’une simple description du quotidien, et ses prostituées pourraient presque être confondues avec des femmes honnêtes.
La fin d’un haut lieu de la prostitution
La scène se situe dans la galerie du Tribunat, dont le Palais-Royal fut le siège de 1800 à 1807. L’endroit était réputé depuis la construction des galeries pour être le rendez-vous des filles publiques qui venaient y exercer leur commerce (elles disaient « faire leur palais »). Les sources de l’époque estiment que 600 à 800 filles habitent au Palais-Royal, auxquelles il convient d’ajouter les « hirondelles » qui n’y résident pas mais qui viennent à la recherche de clients le soir venu. La prostitution était libre mais très organisée : les demi-castors opéraient dans les allées et les galeries de bois, les castors dans les galeries de pierre, et les cocottes de luxe à la terrasse du café du Caveau.
Cette activité du Palais-Royal cessera avec le futur roi Louis-Philippe, à qui le palais et son jardin seront restitués en 1814. En 1829, il fera d’abord remplacer les galeries de bois par la galerie d’Orléans. Spacieuse (65 mètres de long sur 8,5 mètres de large) et couverte d’une somptueuse verrière, elle abritait vingt-quatre boutiques. Entièrement démontée en 1935, il n’en reste aujourd’hui que la double colonnade de pierre.
Puis, dès son arrivée au pouvoir en 1830, Louis-Philippe réglemente la prostitution, désormais interdite en dehors des maisons de tolérance. Le Palais-Royal est déserté quand, en 1836, s’ajoutent à ces mesures celles décrétant la fermeture des salles de jeu. Avec les filles de joie et les joueurs, c’est toute la jeunesse qui quitte le lieu pour se replier sur les boulevards.Auteur : Béatrice MÉON-VINGTRINIER
Bibliographie
- Le Palais-Royal, catalogue de l’exposition du musée Carnavalet, 9 mai-4 septembre 1988, Paris, Paris-Musées, 1988.
sources
 votre commentaire
votre commentaire
-
"Chaque égout de Paris a ses immondices particulières" (Jules Janin, 1836)
Egout collecteur construit sous le boulevard de Sébastopol à Paris,gravure du Monde Illustré (1858).« Chaque égout de Paris a ses immondices particulières. L'École Militaire, l'Hôtel des Invalides, la Salpêtrière, font de l'égout qui les traverse une véritable fosse d'aisances ; l'égout des abattoirs est rempli de matières animales ; l'égout des Gobelins est une teinture noirâtre. Comme aussi chaque égout a une odeur qui lui est propre ; — odeur fade — ammoniacale — d'hydrogène sulfuré — odeur putride, — odeur d'eau de savon ou de vaisselle croupie en été entre les pavés. L'odeur fade est la plus innocente de toutes ; c'est l'odeur des égouts bien tenus et dans lesquels l'air circule. — l'odeur ammoniacale, c'est l'odeur des fosses d'aisances en grand. — L'hydrogène sulfuré a la propriété de noircir l'or et l'argent, et surtout de tuer son homme comme ferait un coup de sang.C'est l'odeur des égouts qui ont été négligés depuis longtemps. — L'odeur putride, qui est rare, se trouve cependant dans toute sa pureté à l'embouchure de l'égout de l'abattoir du Roule. — L'odeur forte, repoussante et fétide domine au Gros-Caillou , dans les rues de l'Oursine, de Croulebarbe, au faubourg Saint-Denis. Il y a encore une septième classe d'odeurs, qu'on peut appeler odeurs spéciales. Ainsi l'égout Amelot c'est la vacherie et l'urine des animaux ; la rivière de Bièvre exhale une douce odeur de tan qui est le serpolet de ces rivages ; l'égout de la Salpêtrière réunit à lui seul le plus horrible assemblage de toutes ces douces odeurs.Mais en fait d'odeurs fades, putrides, repoussantes, variées ; en fait d'ammoniaque et d'hydrogène sulfuré, que dirons-nous donc du grand égout où se décharge la voirie de Montfaucon, dans laquelle voirie on apporte, bon an mal an, quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante bouches de vidanges, formant ensemble un million cent quatre-vingt-dix-sept pieds cubes de matières fécales ?Dans cet aimable lieu, le liquide se sépare du solide et s'en va se perdre dans le grand égout de la rue Lancry, non sans couvrir d'un épais nuage les faubourgs Saint-Denis et Saint-Martin.Or, les égouts, ces tristes réceptacles de tant d'odeurs nauséabondes et mortelles, Paris a trop peu d'eau pour les laver et pour les assainir ; il faut que des hommes descendent, au péril de leur vie, dans ces voûtes étroites, pour balayer le sable et la boue qui les obstruent. Il faut pourtant bien que vous sachiez comment cela se fait, vous autres heureux de ce monde, qui ne voyez que le ciel et la terre, et qui mourriez d'effroi s'il vous fallait descendre dans les entrailles infectes de la belle ville que vous habitez.Le malheureux que la faim condamne à ce travail, descend dans l'égout, armé d'une longue planche au bout d'un bâton. Il rencontre d'abord une boue liquide, et tant que la boue est liquide, il la pousse devant lui, avec un grand râteau. Si la boue résiste, on fait une digue au bout de l'égout, l'eau qui monte a bientôt rendu à cette boue compacte toute sa limpidité. Quand la boue est enlevée, reste le sable.Ce sable qui provient du pavage des rues ou de l'inondation, est enlevé à l'aide de seaux et de poulies. L'asphyxie ou tout au moins l’ophtalmie est au fond de ce sable, qui a gardé traîtreusement toutes les émanations de l'ammoniaque. Et voilà à quel prix vous n'avez pas la peste tous les dix ans!Cependant on demande ce que deviennent les immondices que charrient incessamment tous les égouts de cette immense ville ? Il faut bien vous le dire, ces immondices se rendent, tout infectés et tout chargés de leurs odeurs, dans la Seine, cette fière rivière où s'abreuvent chaque jour huit cent mille individus.Vous frémissez ! Vos pères ont eu peur bien avant vous : une ordonnance du prévôt de Paris en 1348, etunédit du roi Jean, de 1356, défendaient aux habitants de Paris de jeter leurs immondices sur la voie publique, en temps de pluie, de peur que l'eau ne les entraînât à la rivière.Une autre ordonnance du prévôt des marchands défend, sous peine de soixante sous d'amende, de jeter dans la Seine aucune boue ou fumier. Le règlement du 27 juin 1414 ordonne aux chirurgiens de porter le sang des personnes qu'ils auront saignées dans la rivière, au-dessous de la ville. Un arrêt du parlement du 21 juin 1586 condamne au fouet un valet du bourreau qui avait jeté des matières fécales dans la rivière.Nous sommes de plus intrépides buveurs d'eau que les Parisiens des siècles passés ; nous jetons dans notre rivière tout ce qu'on y peut jeter, cependant nous nous appelons sans façon des hommes civilisés ! et nous nommons nos pères des barbares.Mais il ne s'agit pas de nous, il s'agit des malheureux qui, cachés dans les fanges de la ville, travaillent incessamment à l'assainir. A peine descendus dans le cloaque immonde, ils sont saisis à la tête d'une vive douleur. La bouche se dessèche et devient brûlante comme elle le serait après huit jours d'une horrible fièvre ; à peine plongés dans cette boue infecte, leur peau devient sanglante, elle se couvre ensuite d'une croûte épaisse, une horrible infiltration purulente est établie dans ces tristes cadavresCependant, chose étrange ! Ces malheureux qui ne gagnent que deux francs par jour, sont attachés à cette triste profession comme si elle était la plus belle du monde. Non-seulement ils l'exercent sans dégoût et sans fatigue, mais encore avec joie. Ceci est un des mystères de la toute-puissance d'attraction qui s'établit entre tous les malheureux. Ces pauvres diables, séparés du monde, habitués à s'aimer, à se plaindre, à se secourir, à se sauver les uns les autres, ne voient rien au-delà de l'égout dans lequel ils vivent. La grande cité parisienne les foule aux pieds de ses chevaux, elle n'a pour eux que des excréments et de la boue; peu leur importe ! […]Mais cependant, qu'est-il besoin d'aller chercher si loin ou si bas des égouts et des cloaques? Chaque maison de Paris ne porte-t-elle pas dans son sein son égout et son cloaque ? L'histoire des fosses d'aisance n'est pas moins digne d'intérêt que toute autre histoire de ce genre. Autrefois, la fosse d'aisance laissait couler tout ce qui pouvait s'échapper dans les nappes d'eau environnantes ; aujourd'hui, c'est une citerne imperméable qui garde tout ce qu'on y jette. Autrefois, les lieux à l'anglaise étaient un luxe, c'est presque une nécessité aujourd’hui. Autrefois, le bain à domicile était une espèce de viatique médical ; aujourd'hui, le bain à domicile est une habitude, c'est autant d'eau pour les fosses d'aisance ; vous croyez qu'il n'y a là dedans rien qui doive inquiéter ? Voici ce qui doit arriver inévitablement. Plus on jettera d'eau dans les fosses d'aisance, et plus souvent il les faudra vider, et plus souvent il faudra payer la vidange, et plus vous verrez les loyers renchérir. Il y a dans les fosses d'aisance, tout simplement, une chose que du reste on trouverait partout aujourd'hui, une révolution. »
Jules Janin, « Les égouts », La Revue de Paris, t. 34 , 1836. votre commentaire
votre commentaire
-

L’Eclairage Public
Historique
La "préhistoire"
•En 1318 Philippe V Le Long fait placer une chandelle dans une lanterne de bois garnie de vessie de porc à la porte du tribunal du Chatelet "afin de déjouer les entreprises des malfaiteurs".
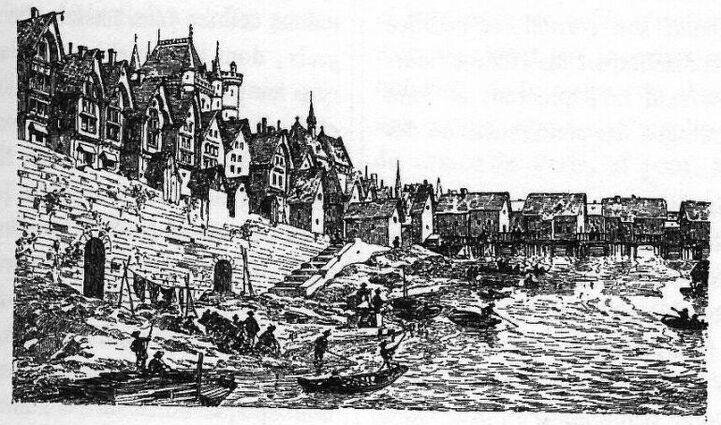
•A la fin du XIVe siècle un fanal à la Tour de Nesle indique aux mariniers l'entrée de Paris.
•En 1524 et 1558, des arrêtés du Parlement demandent aux bourgeois d'installer à leurs frais des "flambeaux ardents" à leurs fenêtres. Mais cela n'est que très peu suivi d'effet.

•Louis XIV confie au Sieur Abbé Laudati Caraffa la "concession" de proposer des porte-flambeaux et porte-lanternes à louage, en complément de l'éclairage insuffisant.
La police faisant respecter la réglementation plus rigoureuse instituée par le Lieutenant Général de Police Monsieur de la Reynie, le nombre de lanternes atteint 2736 pour éclairer 912 rues de Paris.•En 1697, l'éclairage public passe à la charge de l'Etat moyennant redevance, et en 1729 il ya 5772 lanternes.
Celles ci sont constituées de petits carreaux assemblés au plomb protégeant une chandelle dont il faut couper toutes les heures la mêche charbonnée.•En 1744 la lanterne à réverbère (lampe à huile et réflecteur argenté) est inventée, Mais il faut attendre 1766 pour que la lanterne de Monsieur Bourgeois de Chateaublanc soit retenue pour équiper les rues de Paris. Faute de trottoir, elles sont suspendues au dessus des rues ou accrochées à des potence tous les 50 mètres.
•En 1788, l'huile de tripes est remplacé par de l'huile de colza, et ainsi la flamme est plus blanche ... et moins nauséabonde.
•La lampe à réverbère est perfectionnée par l'adoption d'une cheminée en verre avec double courant d'air (lampe "Quinquet" du nom du pharmacien inventeur - ou plutôt plagieur du suisse Ami Argand), puis à partir de 1821, lampes "Vivien".
Il y a alors 12761 "becs de lumière" qui éclairent la ville.La période gazière
•Découverte du principe d'éclairage par le "gaz hydrogène" (hydrogène carboné) en 1791 par Philippe LEBON
•De 1791 à 1829, diverses expérimentations de l'éclairage au gaz dans des sites privés de Paris
•en 1829, premiers essais officiels d'éclairage public place du Carroussel, rue de Rivoli, places Vendôme et de l'Odéon, Palais Royal.
Diverses petites usines de production sont installées à l'intérieur de Paris gérées par plusieurs compagnies (voir chapitre Gaz)•Le remplacement de l'éclairage à huile par le gaz se poursuit ensuite ainsi :
Année Nb de becs à gaz Nb de becs à huile
1831 69 12941
1839 600 5400
1848 8600 2608
1852 13733
1870 20766 dans l'ancien Paris (enceinte 971 lanternes à huile
des fermiers Généraux) et 569 à pétrole
et 11256 dans l'espace jusqu'aux fortifications
•C'est en 1846 qu'une ordonnance définit des situations de monopole pour 6 sociétés.
•En 1855, alors que le préfet Haussmann était à la tête de l'administration parisienne, il organise la fusion des 6 sociétés gazières en concession unique à la "Compagnie parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz".
EN CONSTRUCTION
A mettre en forme : Complément sur les éclairages pré électrique (généralités-(1)
En 1817, à Paris le gaz était obtenu dans les manufactures (la Compagnie parisienne du gaz-2) qui regroupe en 1855 de nombreuses sociétés préexistantes, il était principalement utilisé pour l’éclairage des particuliers et des rues (Allumeur de réverbères-3)
– Découverte de Philippe Lebon en 1767, après des expérimentations de distillation sur l’huile, la résine, le bois c’est la houille qui donne le meilleur résultat. Il met au point le thermo-lampe l’ancêtre du bec de gaz .
En 1811 première expérimentation d’éclairage à Paris avec Ryss Poncelet dans un passage près du Palais royal, mais le procédé thermo-lampe n’est pas au point.
Le financier allemand WINDSOR renouvelle l’expérience passage des Panoramas au Palais Royal, sous les arcades de l’Odéon et dans le jardin du Luxembourg.
Le préfet de la Seine Chabrol de Volvic décide d’installer un éclairage collectif dans un lieu public : hôpital St Louis.
1840 Invention des premiers luminaires électriques par un système à arc électrique entretenu dans une enceinte isolante entre deux électrodes – (Sir Humphry Davy-4).
(Ce type d’éclairage-5) se développait à grands pas mais il restait à usage spécial essentiellement pour de grandes surfaces, chantiers, ateliers, rues.
1880 – Les installations de distribution à courant continu commencèrent à concurrencer les sociétés gazières pour l’éclairage des villes.
(Des accidents graves provoqués par le gaz-6) comme des asphyxies, des intoxications et des incendies accélèrent les installations électriques dans les grands espaces en dynamisant les recherches dans les nouveaux systèmes d’éclairage
1879 Thomas Alva Edison et sir Joseph Wilson Swan mettent au point la première ampoule électrique. Cette année Edison présente sa première lampe à incandescence à filament de carbone dans le vide, elle reste allumée 45 heures, c’est l’ancêtre de nos ampoules.
(Eclairage mixte-7)
En 1856 un artiste souffleur de verre l’allemand GEISSLER découvre qu’un courant alternatif à haute tension en passant dans un tube en verre scellé renfermant de l’air à basse pression produit une lueur (Geissler-8)
Le passage à l'électricité
•Expérimentation en 1844 place de la Concorde et en 1855 pour l'exposition universelle
•La première utilisation pérenne est l'éclairage de l'avenue de l'Opéra en février 1878, gràce à 62 foyers équipés de bougies Jablochkoff.
•Incendie de l'Opéra comique en 1887
•Pour l'exposition universelle de 1889, les grands boulevards sont équipés de lampes à arc.
•A partir de cette date, et avec l'invention d'Edison de la lampe à incandescence, l'éclairage électrique commence à entamer le monopole du gaz, et son utilisation devient systématique à partir de 1914.
•Les dernières lanternes à gaz sont converties à l'électricité en 1962
•En 1979, le nombre total de foyers électriques d'éclairage était de 104 600
Le premier essai d’éclairage public au gaz s’est déroulé le 1er janvier 1829.
A l’aide de 10 lanternes rue de la paix et 4 sur la place Vendôme, le système s’est révélé suffisamment concluant pour se généraliser petit à petit sur l’ensemble de la commune de Paris.
En 1831, il y avait 12.941 lampes à huile contre 69 au gaz.

En 1870, la tendance s'est complètement inversée avec 971 lampes à huile
contre plus de 30 000 à gaz.
L’arrivée sur l’avenue de l’Opéra de l’électricité fait entrer Paris dans l’ère moderne, et la « fée électricité » triomphe à l’exposition de 1900. Malgré tout le gaz subsiste et ne disparaît définitivement… qu’en 1962 !
Réverbère, Pont des Arts, 6ème arrondissement, Paris.
Charles Marville, 1858-1871
Tirage sur papier albuminé
 votre commentaire
votre commentaire
-

la girafe du Roi
par Ariane Chottin
Connaissez-vous l’histoire de la première girafe qui posa le pied sur le sol français ? En 1826, le vice-roi d’Égypte, Méhèmet Ali, décida de faire présent au Roi de France, Charles X, d’un gracieux girafon femelle...
L’arrivée d’un quadrupède aussi mal connu suscita un tel émoi que le pays tout entier vécut à l’heur des péripéties de la belle étrangère pendant près d’un an.
Tout débuta en 1825, lorsque Berbardino Drovetti, zélé consul de France au Caire, reçut une circulaire du Ministère des Affaires Étrangères rédigée par le Museum d’Histoire Naturelle : on y réclamait des spécimens d’animaux exotiques.
Le Pacha Méhèmet Ali venait justement de recevoir deux jolis girafons d’un seigneur soudanais. Envoyer en France une girafe ! Voilà à coup sûr de quoi faire un magnifique coup d’éclat, se dit Drovetti en son palais...
On ne possédait de cette géante de la savane que quelques gravures approximatives et une description que Buffon avait rédigée à partir de compte-rendus d’explorateurs assez fantaisistes.
Ce ruminant, qui pouvait atteindre 5 mètres de haut et peser 1000 kg — baptisé Caméléopardis parce qu’on le croyait issu des amours d’un léopard et d’une chamelle — était de taille à frapper les esprits ! Drovetti glissa l’idée à l’oreille du Pacha, en lui faisant miroiter la reconnaissance infinie du Roi de France. Or l’Égypte se trouvait dans un climat politique très tendu avec la France, à cause de sa participation à la répression de la révolte des Chrétiens grecs contre les Turcs.
Le Pacha trouva l’idée fort judicieuse et chargea son consul du délicat transport de l’animal au long cou. Quatre mois plus tard, les deux girafons remontaient le Nil par bateau à destination du Caire. L’un fut destiné à la France et l’autre à l’Angleterre qui avait réclamé pour son compte un spécimen tout pareil à celui que les français attendaient.
En France, Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier débordaient d’enthousiasme :
jamais une girafe vivante n’était arrivée en France !
Mais comment acheminer un tel trésor ?
Drovetti, promu en un tournemain spécialiste de sa protégée, rédigea toute une liste de recommandations : l’animal devait boire 25 litres de lait par jour, il fallait donc lui adjoindre trois vaches laitières ; pour lutter contre l’effet brutal de dépaysement, elle devait être accompagnée de deux jeunes soudanais, Atir et Youssef ; enfin on fit partir avec elle deux antilopes et des chevaux.
Ainsi entourée, la « Girafe du Roi » embarqua sur un petit navire à deux mâts dans le pont duquel on avait pratiqué une ouverture tapissée de paille, afin qu’elle puisse déplier sans se blesser ce cou qu’elle avait si long et auquel on avait suspendu les versets du Coran.
Un abri fut édifié au-dessus de sa tête pour la protéger des embruns et du soleil.
La curieuse embarcation accosta Marseille le 23 octobre 1826 sans autre incident qu’une vache souffrant du mal de mer ! Le préfet des Bouches-du-Rhône, fort conscient de l’intérêt qu’une telle arrivée suscitait, décida d’installer pour l’hiver l’immigrante dans la cour de la Préfecture, où il avait aménagé à son attention des appartements chauffés. Ce fut bientôt le défilé : toute la bonne société provençale accourut.
Les académiciens se relayèrent jour et nuit pour noter tous les détails de son comportement et découvrirent avec stupeur que la girafe était muette : sa gorge si élégante était dépourvue de cordes vocales. Les journaux parlaient d’elle.
Lors des promenades quotidiennes que le Préfet organisait pour sa protégée, encadrée de gendarmes à cheval, la foule se pressait avec ravissement.
Aux premiers jours du printemps, le Roi manifesta des signes d’impatience et se mit à réclamer « sa » girafe.
Mais comment diantre faire circuler cette encombrante « enfant des tropiques » ?
Une brève querelle flamba :
devait-elle être convoyée par mer, selon le cours des fleuves ou sur terre ?
Malgré sa santé fragile et ses 55 ans, le zoologue Geoffroy Saint-Hilaire résolut de se lancer dans l’aventure et arriva à Marseille en avril pour les préparatifs du départ. On s’aperçut alors que la girafe était nue !
Il fallait lui confectionner sur le champ un costume pour le voyage : on la revêtit donc d’un habit impérial entièrement boutonné, pourvu d’un capuchon assez allongé pour couvrir la tête et le cou et frappé à la fois aux armes du Roi de France et à celles du Pacha d’Égypte.
Une bien étrange caravane se mit en route le 19 mai 1827 : la girafe vêtue et chaussée, ses accompagnateurs Atir et Youssef, les vaches, des Égyptiens en costume, un voiturier chargé du transport de l’antilope survivante, de deux mouflons et des bagages, des gendarmes et leurs montures et enfin tout un cortège de badauds.
Il fut décidé que la girafe donnerait, sous la surveillance de la gendarmerie, deux audiences par étape : l’une pour le peuple, l’autre pour les notables. Arrivée à Lyon le 6 juin, moyenne : 27 kilomètres par jour.
À chaque halte, les curieux se pressaient et c’étaient des oh ! et des ha ! à n’en plus finir : voyez combien ses yeux sont larges et veloutés, sa marche élégante, son port de tête noble. Mais lorsque la girafe quittait inopinément son humeur placide pour arracher quelques branches de mimosa d’un coup de sa... ...longue langue protractile, un frisson d’horreur parcourait la foule : on avait aperçu un serpent noir lui sortant de la bouche !
Peu avant la fin juin, Paris était en vue. Des excursions en calèche et en bateau sur la Seine proposèrent aux plus impatients d’aller à la rencontre de la girafe tant attendue. Le 30 juin, la Girafe du Roi rallia enfin le Jardin des Plantes.
Le Roi exigea aussitôt qu’elle lui rendit visite en sa demeure de Saint-Cloud. Le cortège s’ébranla encore une fois pour un trajet très officiel le long de la Seine : quinze kilomètres avec en tête la garnison de Paris, les chevaux emplumés des généraux, les professeurs et les hauts dignitaires dans leurs robes de grand apparât.
Le Roi, le duc d’Angoulême, la duchesse, la petite duchesse de Berry et ses deux enfants étaient là pour réceptionner l’étrangère. La girafe se comporta parfaitement : elle happa délicatement les pétales de rose que lui présentait le souverain, laissa la duchesse lui glisser une guirlande de fleurs autour du cou — parfaite pour dissimuler les versets du Coran — et les enfants caresser sa belle robe tachetée. Sur le chemin du retour, les haies de spectateurs furent difficiles à contenir. Au cours des six mois qui suivirent, 600 000 Parisiens achetèrent des tickets pour rendre visite à la Girafe venue d’Égypte.
Bien que son régime se fût considérablement diversifié, assister à la dégustation de son lait quotidien restait un spectacle fort prisé : inclinant son cou jusqu’au seau posé à terre, elle faisait le grand écart avec ses pattes avant sous les hourras de la foule.
Le péage du pont d’Austerlitz, qui était alors l’une des voies d’accès à la ménagerie, fit une recette sans précédent, on s’arrachait des billets vendus au double de leur prix pour contempler de plus près la vedette. Puis la gloire de l’animal exotique se ternit et Balzac en décrivit le déclin dans une nouvelle publiée par le journal La Silhouette.
La girafe vécut cependant paisiblement jusqu’à l’âge de 21 ans entre les jardins et des appartements aménagés pour elle dans la rotonde du Jardin des Plantes, chauffés et capitonnés de paillassons, qu’elle partageait avec Atir, son soigneur attitré, fidèle cuisinier et attentionné lustreur de pelage, qui logea pendant douze ans sur un balcon suspendu à l’intérieur de cette rotonde à hauteur de tête de sa belle.
Après la guerre de 1914, le Museum disposant de trop de girafes empaillées, ces élégantes ayant par la suite « envahi » les zoos, s’étant assez docilement acclimatées à la captivité et ayant même donné naissance à de nombreux girafons, la Girafe du Pacha d’Égypte qui, la première de son espèce avait ouvert une voie entre l’Afrique et la France, fit un ultime voyage jusqu’au musée de La Rochelle ou on peut l’admirer en compagnie de l’Orang-outan de l’impératrice Joséphine
L’histoire de cette girafe est merveilleusement contée dans un ouvrage écrit par G. Dargaud, Une girafe pour le Roi, préface de G. Poisson, Paris, 1985. Ce texte en est largement inspiré.
SOURCES
http://www.vacarme.org/article1009.html
 votre commentaire
votre commentaire
-
Paris pendant l’Exposition Universelle de 1900
En 1900 William Henry Goodyear, le fils de l’inventeur de la vulcanisation, a voyagé à Paris avec le photographe Joseph Hawkes pour une visite de 6 semaines dédiée à l’Exposition Universelle, son but était de rapporter des images aux Etats Unis pour montrer l’exposition parisienne au grand public américain qui ne pouvait pas faire le voyage, c’est dans ce but qu’il fit coloriser les images de façon à ce qu’elles se rapprochent plus de la réalité.
Ces images sont maintenant dans les collections du Musée de Brooklyn.- Vues aériennes :
- La Tour Eiffel :
- Pavillons :
- Palais :
- Reconstitution du vieux Paris :
- Extérieurs :
- Autres :
 votre commentaire
votre commentaire
-

Le châle jaune des prostituées au XIXe siècle :
signe d’appartenance ou signe de reconnaissance ?
Véronique Bui
L’histoire de la prostitution est marquée par une multiplicité d’édits qui n’imposent pas seulement des peines, mais aussi le port de signes distinctifs, tels que des accessoires ou des couleurs. Parmi ces couleurs, l’une revient régulièrement, de l’Antiquité aux représentations des artistes – peintres ou écrivains – du XIXe siècle : le jaune.
Mais si, à certaines époques, les prostituées furent tenues de porter cette couleur, le jaune n’est pas pour autant devenu leur signe distinctif, comme ce fut le cas pour les juifs. Depuis le quatrième Concile de Latran en 1215 jusqu’aux lois nazies, la couleur jaune a fini par se confondre avec la judéité.
En revanche, pour les filles publiques, le jaune n’a franchi la frontière du XIXe siècle que dans les représentations artistiques. Est-ce dû au fait que, dans la législation des prostituées, le jaune fut parfois en concurrence avec d’autres couleurs, notamment le rouge, ou est-ce lié à la pudibonderie d’un siècle, le XIXe, qui refuse de mettre en lumière – et le jaune est aussi symbole du soleil – ce qui pour lui connote le sexe ?
Car la prostituée est un problème pour le siècle du triomphe de la bourgeoisie. Cette femme représente le vice, le vice ambulant. Elle véhicule le mal, en général, et la syphilis, en particulier. Image de la paresse, de l’embonpoint, de l’alcoolisme et même du tribadisme, image de la lascivité, de la débauche, du désordre, la prostituée, aux yeux de cette société, représente un danger, comme en témoigne le tableau de Degas intitulé La Fête de la patronne.

Datée de 1876, et exposée au musée Picasso à Paris, cette toile est une représentation-charge des filles des maisons de tolérance. Avachies, vautrées, difformes, elles forment une masse autour de la taulière, seul personnage habillé de la scène. Le pastel jaune du mur du fond est criard ; la couleur, au lieu de distinguer les corps des filles, renforce l’effet caricatural de forme grotesque et presque inquiétante.
Le heurt des couleurs primaires – le jaune du mur du fond, le bleu des bas, seul vêtement des filles, et le rouge de la moquette – fait violence et la présence en noir de la patronne au centre du tableau fait contraste avec les corps blancs des six filles dénudées qui l’entourent et envahissent l’espace de la toile.
C’est un des paradoxes du XIXe siècle : si ce siècle cherche à cacher la prostituée, en lui interdisant de pratiquer en dehors de lieux clos, selon l’article 2 de la loi de 1829, il est aussi l’âge d’or de la représentation de la fille publique dans les arts et dans les lettres ; et nombreuses sont, également, les études et enquêtes sociales qui la prennent pour objet. La prostituée doit être recluse, mais la prostituée fascine.

Image extraite du film L’Apollonide de Bertrand Bonello qui se passe au début du XXe siècle. Très précis historiquement, magnifiquement joué et magistral visuellement : un excellent film à voir sur le sujet.
Elle devient un motif littéraire et pictural, un sujet pour celui que Baudelaire nomme « le peintre de la vie moderne ». Dès lors, quelle valeur est associée au jaune dans la représentation artistique des prostituées au XIXe siècle et dans quelle mesure le jaune sort-il de sa valeur d’infamie pour s’exhiber comme réalité du désir ?
Dans un premier temps, on verra l’ensemble des dispositions prises au cours des siècles pour que les prostituées soient distinguées des honnêtes femmes et nous étendrons ce tableau jusqu’au XIXe siècle en nous appuyant sur l’incontournable étude de Parent-Duchâtelet2.
Dans un deuxième temps, nous soulignerons les limites de la législation du XIXe siècle :
la résistance de la part des filles publiques, le détournement des signes d’appartenance en signes de reconnaissance à l’adresse du client et surtout la volonté des artistes de représenter ce qui ne doit pas avoir de visibilité.

Aussi la couleur jaune, couleur visible et chatoyante, en particulier lorsqu’elle est celle d’un châle, leur a-t-elle permis de désigner le tabou. Enfin, nous verrons qu’en voulant effacer les signes distinctifs de la prostitution, le XIXe siècle, siècle de l’ascension de la dévoreuse bourgeoisie, a engendré un flottement des signes tel que, dans cette perte de repères, la figure de la prostituée, loin d’être circonscrite, est finalement devenue volatile au point de pouvoir émerger sous les dehors d’une bourgeoise voire d’une aristocrate.
« Quand les prostituées s’affichaient », rappel historique des signes distinctifs des prostituéesOn l’a dit en préambule, l’histoire de la prostitution est aussi une histoire de la législation. Depuis les lois de Solon, la prostitution est soumise à un certain nombre d’ordonnances qui obligent les prostituées à pratiquer dans tel ou tel endroit et en respectant tel ou tel code. Or, en matière de code, c’est principalement le code vestimentaire qui a fait l’objet de la législature.

Ainsi, en Grèce, les prostituées, qui pratiquent en dehors de lieux clos, se voient refuser l’entrée de la ville et des temples et sont assujetties à porter des robes brodées à fleurs.
Ce n’est pas la couleur de la robe qui les distingue, comme ce sera le cas à Rome, mais le motif. Le jaune, chez les Grecs, n’a pas la signification de luxure et de débauche qu’il a à Rome : il s’agit d’une couleur quasi-virginale puisqu’elle est celle des mariés.
En revanche, à Rome, le jaune désigne la courtisane.
Le spectateur de théâtre ne s’y trompe pas quand il voit apparaître sur la scène de théâtre le costume jaune. Il sait que c’est celui de la courtisane, au même titre que le blanc est celui des vieillards, le multicolore indique les jeunes personnes, le bariolé signale le proxénète et le pourpre distingue les riches.
Mais, en dehors de la scène, la prostituée se reconnaît également à la tunique qu’elle doit porter, très proche de celle des hommes puisqu’elle s’arrête, comme pour eux, à mi-cuisses, alors que celle des femmes honnêtes leur descend jusqu’aux pieds.
Mais si l’empire romain fut clément avec les prostituées, il n’en fut pas de même à toutes les époques. Avec les débuts de la chrétienté, la prostituée n’a plus droit de cité, qu’elle soit vêtue de jaune ou d’une autre couleur.
Et sous Charlemagne, les lois sont dures pour celles qui vendent leur corps.
Par une capitulaire de 800, Charlemagne prononce la peine du fouet à l’encontre des prostituées et les condamne à parcourir le pays pendant quarante jours avec un écriteau autour du cou.
Néanmoins, ces condamnations restèrent vaines. Et vouloir interdire la prostitution, c’est s’exposer à la clandestinité des pratiques. Aussi les autres législateurs créèrent-ils des codes de visibilité afin de distinguer les prostituées des femmes honnêtes. Dans cet historique, la très renommée ceinture dorée tient une place particulière.
En effet, elle fut si fortement assimilée aux prostituées qu’elle en en est devenue proverbiale et, dans l’étude de Maxime Du Camp, intitulée Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie jusqu’en 1870, on peut encore lire, au chapitre consacré à la prostitution que : « Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée7 ».
Cette fameuse ceinture dorée leur fut longtemps imposée jusqu’à ce qu’elle soit remise en cause par Saint-Louis. En effet, sous le règne de ce pieux roi, cette fameuse ceinture, signe distinctif des prostituées, fit l’objet d’une interdiction, car les femmes de ce siècle étaient parées de tant de signes de richesse que lorsque la reine Marguerite de Provence, femme de Louis IX, se rendit à l’offrande, et toucha de ses lèvres la paterne, elle rendit le baiser de la paix à sa voisine et embrassa une femme richement vêtue qui n’était autre qu’une « ribaude folieuse » ainsi que l’on disait alors.
D’après Maxime Du Camp, ce fut là l’origine des lois somptuaires et interdiction fut faite aux prostituées de porter des vêtements de grand prix.

Sabatier précise, dans son Histoire de la législation sur les femmes publiques et les lieux de débauche, qu’il leur est défendu de « porter des ornements, broderies, boutonnières d’argent, perles, manteaux fourrés de gris sous peine de confiscation ».
Les vêtements confisqués devenaient propriété royale, à l’instar de ce qui se passe dans le conte drolatique de Balzac intitulé Le Succube.
L’action se déroule à Tours, à l’époque de Louis IX et l’héroïne, soupçonnée d’être une démone, se voit confisquer ses richesses ainsi que ses habits de prix. Précisons qu’au moment des lois somptuaires ces habits étaient revendus et un quart du prix revenait à ceux qui avaient arrêté ces filles dites «folles de leur corps ».
 Comme on peut le constater, ces lois condamnaient le luxe plus encore que la prostitution et l’efficacité de ces lois fut d’autant plus réduite que la législation n’était pas la même sur tout le territoire.
Comme on peut le constater, ces lois condamnaient le luxe plus encore que la prostitution et l’efficacité de ces lois fut d’autant plus réduite que la législation n’était pas la même sur tout le territoire. À Narbonne, les consuls et habitants étaient en possession du droit d’avoir une rue chaude, c’est-à-dire un lieu de prostitution. Dans le prologue du Succube, Balzac évoque également une rue de Tours qui se « nommoyt la rue Chaulde » et, ce faisant, par cette indication, il invite le lecteur à lire son conte comme une histoire portant sur la prostitution autant si ce n’est plus que sur la sorcellerie.
Ainsi la localisation des maisons de débauche dans les rues chaudes était un moyen de circonscrire les prostituées, mais ce qui fut valable dans telle ou telle région ne l’était pas ailleurs et n’a pas traversé les siècles.
En Provence, par exemple, au XIVe siècle, sous la reine Jeanne, reine des Deux Siciles et comtesse de Provence, une ordonnance, datée de 1347, stipule qu’à Avignon les femmes débauchées doivent porter une aiguillette rouge sur l’épaule. Mais si l’expression est restée de « courir l’aiguillette », c’est-à-dire de vendre son corps, cette marque distinctive ne fut pas non plus adoptée dans tous les pays et elle ne perdura pas au fil des siècles. Comme l’écrit Michel Pastoureau, dans Bleu, histoire d’une couleur :
il est patent qu’il n’existe aucun système de marques de couleurs commun à toute la Chrétienté pour désigner les différentes catégories d’exclus. Au contraire, les usages varient grandement d’une région à l’autre, d’une ville à l’autre, et à l’intérieur d’une même ville, d’une époque à l’autre. À Milan et à Nuremberg, par exemple, villes où au XVe siècle les textes réglementaires deviennent nombreux et pointilleux, les couleurs prescrites – aux prostituées, aux lépreux et aux juifs – changent d’une génération à l’autre, presque d’une décennie à l’autre.
Néanmoins, il signale un certain nombre de récurrences et ajoute :
Si l’on tente une étude par catégories d’exclus et de réprouvés, on peut remarquer (en simplifiant beaucoup) que le blanc et le noir, soit seuls soit en association, concernent surtout les misérables et les infirmes (notamment les lépreux) ; le rouge, les bourreaux et les prostituées ; le jaune les faussaires, les hérétiques et les juifs ; le vert, soit seul soit associé au jaune les musiciens, les jongleurs, les bouffons et les fous. Mais il existe de nombreux contre-exemples.

Ainsi pour les prostituées (pour lesquelles le port d’une marque discriminatoire a une fonction autant fiscale que morale) : elles sont fréquemment emblématisées par la couleur rouge (robe, aiguillette, écharpe, chaperon, manteau selon les villes et les décennies) […]
Mais à Londres et à Bristol, à la fin du XIVe siècle, c’est l’usage de vêtements rayés de plusieurs couleurs qui leur permet d’être distinguées des honnêtes femmes ; même pratique dans les villes du Languedoc quelques années plus tard. À Venise, en revanche, en 1407 c’est le port d’une écharpe jaune qui joue le même rôle.
Ainsi le rouge et le jaune entrent en concurrence quand il s’agit d’attribuer des signes aux prostituées, mais dans la rivalité entre ces deux couleurs, le jaune semble avoir gagné puisque cette couleur est encore mentionnée au XVIIIe siècle par l’avocat Sabatier dans son Histoire de la législation sur les femmes publiques et les lieux de débauche.
Il précise qu’en 1775, à la foire de Beaucaire, les officiers municipaux enjoignirent aux filles publiques de porter à leur coiffure une rosette de ruban jaune qui pût les faire distinguer et pour laquelle on exigeait douze sous.
Ce recours au jaune comme couleur distinctive est resté dans les esprits : Parent-Duchâtelet, dans son étude sur la prostitution dans la ville de Paris, mentionne la proposition d’un médecin de Montpellier qui écrivit, en 1827, un long mémoire au préfet Delavau dans lequel il expliquait que, pour enrayer la syphilis et réprimer les désordres de la prostitution, « il fallait placer en première ligne l’obligation imposée à toute prostituée de porter une marque distinctive : il demandait donc pour elles un chapeau de soie jaune serin garni d’un ruban et d’un voile de même couleur ; il complétait ce costume par une ceinture jaune portant une plaque plus ou moins ornée, suivant les moyens de la fille, et de plus le numéro de la carte. »

Mais, les conseils de ce médecin vont à l’encontre de ce que préconise le XIXe siècle. Les filles publiques ne se voient plus attribuer par le législateur une couleur déterminée, et c’est surtout l’interdiction de porter des couleurs trop voyantes qui leur est faite. Comme l’écrit Parent-Duchâtelet :
Il est maintenant reconnu qu’en donnant aux prostituées une marque distinctive, ce serait infecter les lieux publics d’enseignes ambulantes du vice, et indiquer à l’adolescent timide les personnes auxquelles il peut hasarder des demandes qui ne seront pas refusées.
On se contente donc d’exiger des femmes de cette classe une mise décente et en même temps salubre, il faut qu’elles aient de tout temps les épaules ainsi que la tête couvertes, qu’elles ne se fassent pas remarquer du reste de la population, et qu’elles attirent le moins possible les regards.
Les couleurs voyantes sont donc interdites aux prostituées : en cas d’infraction, elles risquent l’incarcération et le vêtement est déposé à la prison tout le temps de la détention.
Ce petit rappel historique des signes distinctifs imposés aux prostituées dessine un mouvement qui part d’une volonté de les distinguer via des signes tangibles, à un mouvement qui leur enjoint de se faire les plus discrètes possible. Et quand, à certaines périodes de l’histoire, les signes leur sont totalement refusés, ce n’est pas forcément parce qu’il y a clémence à leur égard, mais plutôt parce que l’existence même de la prostituée est interdite.
La volonté du XIXe siècle de n’accorder aucun signe de reconnaissance à la prostituée est certes un moyen de ne pas l’exposer à la vindicte populaire – ce qui fait partie d’ailleurs des préoccupations de Parent-Duchâtelet – mais cette volonté s’accompagne aussi d’un désir de ne pas laisser voir l’existence de ces femmes. Ceci explique que les maisons closes soient tolérées voire préconisées.
Enfermées, surveillées, soumises à une visite médicale hebdomadaire, les prostituées sont sous l’œil vigilant de la médecine et de la police. Mais bien qu’il y ait 128 maisons de tolérance à Paris en 1878, celles-ci sont loin de contenir l’ensemble des prostituées parisiennes. Comme l’indiquent les statistiques présentées par Alain Corbin, 33% seulement des filles inscrites sur les registres de la police sont pensionnaires de ce type de maisons, et les filles inscrites sont très loin de représenter la somme réelle des prostituées.
La plupart ne sont pas en cartes, soumises au contrôle, mais sont, au contraire, clandestines. Elles opèrent plus ou moins librement dans des garnis, dans des cabarets, dans des arrière-boutiques et même dans la rue.
Le XIXe siècle n’interdit donc pas la prostitution, mais il veut qu’elle soit confinée dans certains lieux, et dans des lieux clos. Cependant, cette loi est débordée par la réalité des faits et paradoxalement, plus le XIXe siècle cherche à cacher, plus la prostitution se fait voir, déborde du cadre qui lui est assigné.
Du signe à l’enseigne ou la réversibilité des signesDans le domaine de la prostitution, les signes abondent, à certains égards on pourrait en parler comme d’un autre empire des signes. Mais ces signes ne sont pas toujours discriminants. Ils n’ont pas tous pour fonction de désigner l’infamie, mieux ils peuvent servir d’enseignes.
Dans le cas de la maison de prostitution, la lanterne que l’on retrouve mentionnée à propos de la Maison Tellier, décrite par Maupassant, n’est pas du même registre que l’obligation de tenir les croisées constamment closes, avec les vitres dépolies ou à défaut de fermer les persiennes à l’aide de cadenas.

Certes, les deux font signe et les deux offrent un indice au client potentiel. Les persiennes fermées sont la condition sine qua non pour obtenir le droit d’une tolérance, et pour qu’elle vous demeure ; sans cette clause remplie, la maison de tolérance se voit retirer sa licence et est fermée pour plusieurs jours. Mais, dans un cas il s’agit d’une obligation officielle que vérifient régulièrement les inspecteurs, tandis que, dans l’autre, il s’agit d’un choix commercial.
La lanterne rouge est un signe envoyé par les tenanciers de la maison à la clientèle. Elle permet d’être distinguée dans la nuit, à une époque où les réverbères sont loin de couvrir toute la ville et même tout le pays. Son usage existe depuis l’antiquité où les lupanars avaient pour enseigne une lampe ou un pot-à-feu : comme les filles publiques n’avaient pas le droit d’exercer avant la neuvième heure, pour se faire voir dans l’obscurité, elles se plaçaient à proximité de ces sources de lumière
Au XIXe siècle, la lanterne remplit toujours son office d’enseigne dans la nuit ; à cet égard, elle est du même acabit que le gros numéro qui figurait au-dessus de la porte des maisons de tolérance et dont la taille pouvait atteindre 60 centimètres de hauteur.
Le gros numéro est une marque distinctive de ce type de maisons en province aussi bien qu’à Paris : en témoigne l’établissement où demeure la fille Elisa qu’Edmond de Goncourt situe avenue de Suffren : « À la nuit, la maison au gros numéro, morne et sommeillante pendant le jour, s’allumait et flambait, par toutes ses fenêtres, comme une maison enfermant un incendie »
Ce gros numéro a pour fonction d’attirer l’œil, comme la couleur de la lanterne, comme aussi la couleur des murs.
Ceux de la Maison Tellier, située à Fécamp, sont jaunes et par ce choix ils se signalent davantage à l’œil. Maupassant décrit ainsi cette maison : « La maison était familiale, toute petite, peinte en jaune, à l’encoignure d’une rue derrière l’église Saint-Etienne. »
Ainsi, bien des signes ne relèvent pas d’une obligation légale, mais sont de l’ordre de la publicité. Les tenanciers signalent leurs établissements et le type de services qu’ils proposent. À ces signes s’ajoutent parfois la présence d’une femme dans le rôle d’indicatrice ou même la distribution de cartes au nom de l’établissement, cartes dont les ornements ne laissent aucun doute sur le type de commerce pratiqué. Il s’agit de le rendre public comme les filles du même nom.
Pour les filles clandestines du XIXe siècle, l’absence de signes distinctifs est à certains égards positive car bien souvent elles ne sont qu’occasionnelles et exercent un autre métier. Elles pratiquent la prostitution quand le besoin s’en fait sentir.
C’est le cas de Nana qui retourne faire le trottoir quand la Tricon, entremetteuse professionnelle, n’a pas besoin de ses services. Mais Nana, comme bien des prostituées, n’est pas une marcheuse à temps plein. Les statistiques établies par Parent-Duchâtelet attestent que les filles inscrites sur les registres de la police, indiquent une autre profession.
Elles se déclarent blanchisseuses, repasseuses, empailleuses, la plupart sont domestiques, et si certaines se font inscrire sous la profession d’actrices ou même d’institutrices, la grande majorité appartient à une classe sociale inférieure dont le degré d’instruction demeure limité. Sur 4470 filles nées et élevées à Paris, 2332, précise Parent-Duchâtelet, n’ont pas pu signer.
Comme on peut le constater, si le XIXe siècle ne veut pas donner de signes distinctifs aux prostituées, en revanche, il cherche à en connaître le visage, à en dessiner un portrait, à établir des statistiques, sur la provenance géographique, l’âge, la taille, le poids, la couleur des cheveux et même les yeux.
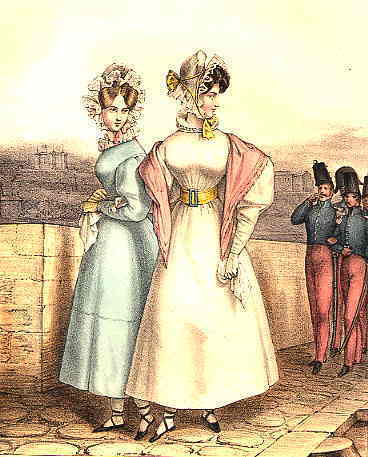
C’est donc par l’enquête que le XIXe siècle essaie de cerner celles qui pourraient être des prostituées, c’est un moyen de connaître sans afficher, un moyen de rendre visible, mais sur des registres, ce qui cherche à rester clandestin. Mais si le siècle du Code civil réclame aux filles publiques une forme d’invisibilité sauf sur ses registres – s’entend –, les filles publiques ont, quant à elles, besoin de visibilité. Aussi, l’interdiction de porter des couleurs voyantes est-elle couramment transgressée par elles, comme l’attestent les romanciers de l’époque.
Dans la 6ème nouvelle des Diaboliques de Barbey d’Aurevilly, le narrateur situe l’action à Paris, la nuit. Son héros, Robert de Tressignies, a remarqué une femme dont « la mise trop voyante » et « le tortillement de la démarche » sont de « suffisantes étiquettes ».
Intrigué par une ressemblance entre elle et une femme qu’il a connue autrefois, il se décide à la suivre, mais de loin. Cette femme, comme le précise le narrateur, est vêtue d’une « robe de satin safran, aux tons d’or », elle s’enveloppe dans un « magnifique châle turc à raies blanches, écarlate et or , et de son chapeau une longue plume rouge descend qui lui vibre jusqu’à l’épaule.
La description fournie de son costume et de sa gestuelle est explicite et pour Robert de Tressignies et pour le lecteur. La robe de satin safran, aux tons d’or, en tant que mise trop voyante fait signe, mais elle fait signe aussi au sens où sa couleur devient, à la clarté des réverbères, un point lumineux, repérable dans la nuit sombre. Barbey précise :
Tressignies, qui croyait qu’elle allait prendre la rue de la Chaussée-d’Antin, étincelante de ses mille becs de lumière, vit avec surprise tout ce luxe piaffant de courtisane, toute cette fierté impudente de fille enivrée d’elle-même et des soies qu’elle traînait, s’enfoncer dans la rue Basse-du-Rempart, la honte du boulevard de ce temps !
Et l’élégant, aux bottes vernies, moins brave que la femme, hésita à rentrer là-dedans…Mais ce ne fut guère qu’une seconde… La robe d’or, perdue un instant dans les ténèbres de ce trou noir, après avoir dépassé l’unique réverbère qui les tatouait d’un point lumineux, reluisit au loin, et il s’élança pour la rejoindre.
Comme le prouve cette page, la couleur jaune de la robe remplit une fonction dans ce Paris nocturne des quartiers malfamés, elle devient une lumière dans la nuit, un repère visible, un signe qui se transforme en signal.
Le jaune de la robe n’est plus ici signe d’appartenance, mais fonctionne comme signe de reconnaissance à l’égard du client. L’obscurité de la nuit justifie la couleur de la robe et du châle. Pour être reconnue comme telle la fille publique doit se faire voir, c’est par les signes extérieurs qu’elle se donne à elle-même qu’elle fait signe.
Outre la fréquentation de lieux réputés pour la prostitution, tels que les grands boulevards, elle est tenue d’envoyer des signaux non-verbaux et verbaux. Zola, dans Nana, décrit la chasse aux clients de son héroïne accompagnée de Satin, « dans les premières flammes du gaz ».
Nana et Satin longeaient l’église, prenaient toujours par la rue le Peletier. Puis, à cent mètres du café Riche, comme elles arrivaient sur le champ de manœuvres, elles rabattaient la queue de leur robe, relevée jusque-là d’une main soigneuse ; et dès lors, risquant la poussière, balayant les trottoirs et roulant la taille, elles s’en allaient à petits pas, elles ralentissaient encore leur marche, lorsqu’elles traversaient le coup de lumière crue d’un grand café.
En plus des signaux caractéristiques du roulement de la taille et de la lenteur de la démarche, on peut remarquer la mention des flammes du gaz et cette curieuse expression de « coup de lumière crue du grand café ». La prostituée parisienne du XIXe siècle, comme son ancêtre de la Rome antique, a besoin de lumière pour être reconnue ; Nana et Satin, à l’instar des Lycisca à la perruque blonde, se postent près des établissements dont l’éclairage fera ressortir leur mise voyante et leur gestuelle. Le naturaliste Zola rend compte de la réalité de son époque et, avec la peinture de Nana, il témoigne de la transgression des codes de la part des prostituées.
Mais, dans le cas de l’héroïne du puritain Barbey d’Aurevilly, la mise voyante qu’est « la robe de satin safran, aux tons d’or » et cet accessoire qu’est le châle « turc à larges raies blanches, écarlates et or » ne sont pas portés par une quelconque prostituée, mais par une duchesse espagnole.
La protagoniste de la nouvelle de Barbey d’Aurevilly se livre à ce commerce sexuel par vengeance : pour traîner dans la boue le nom de l’homme qu’elle a épousé, elle a décidé de devenir une fille publique et de contracter une maladie qui permettra de salir pour l’éternité le nom de Turre-Cremata. C’est en effet ce qui va se produire puisque le narrateur, quelques années après avoir suivi la duchesse découvre un resplendissant catafalque sur lequel est inscrit « en grosses lettres d’argent sur fond noir » :
CI-GIT
SANZIA-FLORINDA-CONCEPTION
DE TURRE-CREMATA,
DUCHESSE D’ARCOS DE SIERRA-LEONE
FILLE REPENTIE,
MORTE A LA SALPETRIERE, LE…
REQUIESCAT IN PACE !
Ainsi alors que le XIXe siècle cherche à cacher la prostitution, celle-ci résiste, se montre quand même, son commerce s’étale et son absence de signes distinctifs finit par la rendre plus délicate à cerner, elle franchit les frontières : qui est qui ? une duchesse peut se prostituer ? dans ce flottement des identités, à quels signes peut-on se raccrocher ?
Aux franges du châle : détournement des signes et flottement des identitésAvec son magnifique châle turc, l’héroïne de Barbey d’Aurevilly fait signe, mais un signe dont la portée va au-delà du seul repère dans les ténèbres des mauvais quartiers.
Le châle dans le cas de cette nouvelle est aussi détourné de son usage habituel : au lieu d’être là pour couvrir les épaules d’une bourgeoise et mettre en valeur sa richesse, il est l’accessoire d’une femme qui se prostitue. Ce détournement du signe est d’autant plus préjudiciable à la société que le châle au XIXe siècle est l’accessoire type de l’honnête femme. Comme l’écrit Greimas dans La Mode en 1830 :
Le shall ou châle, comme on commence à l’orthographier vers l’année 1829, fit son apparition sous l’Empire, provoquée par la nécessité de couvrir les toilettes par trop légères des merveilleuses. Il ne tarda pas à être prisé, surtout en raison du fait que son excessive cherté ne permettait de l’exhiber qu’aux femmes appartenant à la nouvelle aristocratie de rang et de fortune.
La vue des shalls de cachemire ou cachemires importés des pays lointains des Indes ou du Tibet, garnis de bordures arabesques et de franges turques, faisait bondir le cœur de toutes les femmes élégantes.
Mais ce signe de noblesse va se démocratiser : d’une part, par la vente d’imitations ; d’autre part, par la mise au point de procédés de fabrication, avec le développement des châles Ternaux, nom de leur fabricant.
Aussi la variété est-elle grande dans les cachemires, du cachemire bas de gamme à 70 francs au cachemire d’Inde à plus de 5000 francs, mais quelle que soit sa valeur, le châle connaît un franc succès auprès des femmes. Comme le précise Greimas : « Leur grande variété et la faveur qu’ils trouvent auprès du public assurent leur domination sur la mode aux dépens d’autres accessoires du même genre ».
Et cette domination sur la mode durera bien au-delà de l’Empire.
Sous la Monarchie de Juillet, il devient un des symboles de la bourgeoisie, comme en témoigne Madame Arnoux, dans L’Education sentimentale, dont le châle sur le point de tomber, et rattrapé par Frédéric Moreau, sera au point de départ d’une histoire d’amour ; et il demeure un bien convoité par les femmes de la petite bourgeoisie, comme le prouve la cousine Bette de Balzac qui rêve de posséder le châle jaune de sa cousine Hortense Hulot.
Son succès perdure jusqu’au second Empire, où on le retrouve été comme hiver.
En été, il est en mousseline, en soie, en dentelle ; en hiver, il devient cachemire carré ou long, si long qu’on peut le plier de différentes façons pour en faire apparaître l’un ou l’autre motif et sembler ainsi en posséder plusieurs. Ce n’est que sous la troisième république que les élégantes commencent à se déprendre du châle car la mode est à ce que l’on nomme les tournures, qui rejettent en arrière l’ampleur de la jupe.
Le tombé du châle convient donc mal à cette nouvelle silhouette. Par ailleurs, produit en très grande série, le châle est devenu accessible à un public nouveau, ce qui suffit à le faire plonger dans la disgrâce.
Aussi, quand lors du Salon du 1857, le visiteur découvre la toile de Courbet, intitulée Les Demoiselles des bords de la Seine, il aperçoit au premier plan un châle aux motifs raffinés et y reconnaît l’un des accessoires types de la bourgeoisie.
Mais, très vite, le visiteur peut être désorienté dans sa lecture du tableau car l’attitude des personnages représentés n’est pas typique des portraits de cette classe sociale : au lieu d’être debout ou assises, les deux femmes sont allongées sous un arbre ; l’une tient sa tête dans la main, l’autre a posé sa joue contre le sol.
Le peintre a choisi pour titre Les Demoiselles des bords de la Seine qui reste plus révérencieux que Les Filles des bords de la Seine ; néanmoins, les modèles sont bien des prostituées et Courbet a glissé des indices qui attestent la profession de ces deux demoiselles : l’embonpoint, l’affaissement du corps, le cadre, surtout, dans lequel la scène est représentée – les bords de Seine, lieu notoirement connu comme celui du commerce sexuel.
Et ce lieu peut être souligné dans sa dimension de débauche via l’emploi du déterminant : le titre n’est pas « bords de Seine » mais « bords de la Seine », où l’on entend explicitement le mot « bordel ».
Or, étymologiquement, le « bordel », et son ancêtre « bordeaus », désigne au XIIIe siècle le lupanar du fait de sa localisation, soit près de l’eau, soit dans des maisons de bains.
Enfin, parmi ces indices, le regard, voire son caractère provocateur, est significatif, et n’a pas trompé certains contemporains de Courbet, en particulier, l’esthète Maxime Du Camp qui compare, dans son Salon de 1857, ces deux demoiselles à deux « créatures qui, sans doute, sont sorties le matin même de la rue de Lourcine, et qui, dans huit jours, y retourneront », faisant allusion à l’hôpital de Lourcine destiné aux personnes atteintes de maladies vénériennes.
Mais si, pour le contemporain de Courbet, le statut de ces demoiselles ne fait aucun doute, quel spectateur d’aujourd’hui est encore capable de lire ces signes ?
d’autant plus que même à l’époque, ils étaient déjà brouillés : la composition bucolique de la scène, la légèreté et la fraîcheur de la toilette rendent équivoque cette représentation, et, par-dessus tout, cet emblème de la bourgeoisie qu’est le châle achève de désorienter et pourrait faire confondre ladite créature avec la femme honnête.
Entre les deux la différence n’est plus que dans l’affaissement du corps et dans le regard, en d’autres termes le signe n’est plus que dans la gestuelle.
Dans la très courte nouvelle intitulée « Le signe » de Maupassant, ce motif de la fragile frontière entre la femme honnête, voire mondaine, et la prostituée est explicité.
La baronne de Grangerie, héroïne du Signe, confesse à sa meilleure amie, la marquise de Rennedon, que la veille elle a découvert, en se mettant à sa fenêtre, que sa voisine dont l’appartement fait face au sien, se livre à la prostitution.
D’abord choquée, elle connaît un moment de recul, puis se ravise et commence à analyser les signes qu’émet la femme à sa fenêtre pour faire comprendre le marché qu’elle propose.
À l’aide de ses jumelles de théâtre, elle étudie le geste presque imperceptible que fait sa voisine à sa fenêtre, remarque l’échange de regards, en découvre la signification. Puis, après avoir retenu la leçon, à son tour, elle met en pratique ce qu’elle vient de saisir et trouve un client en la personne d’un beau jeune homme blond qui passe justement dans sa rue.
« Femme du monde ou putain », pour reprendre les termes d’une célèbre chanson, ne sont pas antinomiques, nous dit Maupassant. Pour que l’une puisse se faire passer pour l’autre, il lui aura suffi de refaire, depuis sa fenêtre, le signe des prostituées ; que la vraie prostituée de l’histoire ait été vêtue de rouge et elle de mauve ne change rien en ce XIXe siècle qui a aboli les signes d’appartenance.
S’il est vrai que la baronne prend peur en voyant monter le jeune homme et essaie de lui faire croire à une méprise, devant l’insistance du client et, sous le charme de ce beau blond, elle cède et se livre à lui pour deux louis.
Ainsi la distinction entre femmes et prostituées est difficile à opérer.
En voulant cacher, le XIXe siècle suscite finalement un mouvement inverse qui va consister à mettre à nu, à faire voir l’étendue de la prostitution et à démasquer l’hypocrisie de cette société. Les signes ne sont plus là pour distinguer celle qui vend son corps, mais, au contraire, pour dire la frontière ténue entre la femme honnête et la prostituée.
L’époque est au flottement des identités et à la perte des repères dans le rang de la femme. Plus de 600 ans après le décret instituant la ceinture dorée, Charles Desmaze, un contemporain de Maxime Du Camp, écrit en 1881 dans Le Crime et la débauche à Paris au XIXe siècle :
Autrefois, la prostitution était limitée à certaines femmes, connues, inscrites, portant ceintures dorées, cantonnées en certains quartiers, aujourd’hui, à Paris, elle se répand partout, peuple toutes les rues, revêt tous les costumes, dont elle règle la coupe et la mode.
Jadis la débauche se dénombrait par un certain chiffre fixe ; maintenant elle se nomme légion, et ses rangs s’augmentent chaque jour ; alimentés par les ateliers ; les magasins et les théâtres; dans le pêle-mêle des âges ; des sexes ; des ingénuités, des vices ; on peut acheter toute vertu.
Dans cette « macédoine sociale », pour reprendre l’expression de Balzac, les signes sont si indistincts que les seuls vêtements ne suffisent plus à savoir qui est qui. Plus de frontière de classes, comme dans les nouvelles de Barbey d’Aurevilly ou de Maupassant où duchesse et baronne se livrent au commerce sexuel, c’est le flottement des signes, la perte des repères, voire des valeurs.
La prostituée, loin d’être traître de sa patrie, est une furieuse patriote. Boule de Suif, l’héroïne de la nouvelle éponyme de Maupassant, est plus honnête à l’égard de son pays que les bourgeois frileux de la diligence qui sont prêts à toutes les compromissions avec l’occupant.
La représentation de la prostitution brouille les frontières : les signes distinctifs d’une classe se retrouvent dans une autre, la parure ne suffit plus à les distinguer, et le châle ne couvre plus les épaules des aristocrates portraiturées par Ingres mais se trouve déplié sur la couche épaisse d’une prostituée telle que l’Olympia de Manet. Le scandale de cette très célèbre toile tient, certes, à la nudité et à la pose de la femme.
Avec l’Olympia, la nudité sort de la référence mythologique, mais le scandale tient également au cadre dans lequel la femme est située, au contraste entre le modèle et le caractère de luxe un peu voyant qui l’entoure.
Si certains ont pu gloser sur le degré de « prostitutionnalité » d’Olympia, se demandant s’il s’agissait d’une courtisane entretenue, d’une cocotte, ou d’une fille professionnelle, les critiques de l’époque ont cependant, d’après Emmanuel Pernoud, vite penché vers la seconde hypothèse en s’appuyant sur deux indices : la fatigue du modèle et surtout ses pieds rugueux.
Ce détail indique qu’il s’agit d’une marcheuse ou d’une pierreuse qui opère sur la voie publique.
Or, cette fille, de la plus basse condition au sein de la large palette de la prostitution, est installée dans un cadre luxueux qui n’est pas le sien, comme un modèle en photographie.
Le luxe du bouquet, de la camériste, de l’épais canapé choquent au vu de la condition de cette fille. Et l’étoffe chatoyante du châle, sur lequel son corps nu est étendu, ne vient pas rehausser la beauté d’une femme du monde, mais celle d’une prostituée et, ce faisant, elle signe elle aussi la transgression des codes artistiques et sociaux opérée par Manet.

Ainsi le châle jaune des prostituées au XIXe siècle n’est pas un signe d’appartenance à une catégorie que ce siècle leur aurait imposé, comme ce fut le cas à Venise au XVe siècle.
Le châle jaune est un accessoire parmi d’autres que leur donnent les artistes, un accessoire qu’ils choisissent parce qu’il fait signe dans la nuit et aussi, parce qu’avec lui, la prostituée sort de l’invisibilité dans laquelle ce siècle veut la confiner. Le châle jaune est une transgression car il est voyant et d’autant plus préjudiciable qu’il est un symbole de la bourgeoisie.
En décidant d’en revêtir une prostituée, peintres et écrivains trahissent que la fille publique n’est pas si éloignée de la femme honnête et que la femme honnête trouve en elle un double singulier.
La prostituée concentre donc en elle les flottements identitaires du XIXe siècle et les physiologies, qui visent à cerner les types sociaux et moraux, sont dépassées par cette catégorie de femmes qui s’introduit dans tous les milieux, prend des poses d’odalisque et se pare des emblèmes de la bourgeoisie.
La grisette, selon Balzac, dans Les Parisiens comme ils sont, sait « singer la grande dame » mais « possède » aussi « toute la câline urbanité de la petite bourgeoise » et « lorsqu’elle se laisse aller à un familier abandon, elle rappelle la classe au-dessus de laquelle elle est cependant ».
Les repères sont dilués, il n’est pas jusqu’à la différence des sexes qui ne pâtisse de cette brèche ouverte par la prostituée : lorsque Balzac, grand observateur de ses contemporains, donne pour titre au roman où figure Esther Gobseck Splendeurs et misères des courtisanes, le pluriel jette un doute sur l’identité de la courtisane dans ce texte. Et, pour en faire deux, en dehors d’Esther Gobseck, il n’y a que Rubempré !
La représentation de la prostituée bouscule donc les codes et les repères, et si le XIXe siècle a tant voulu la cacher, c’est aussi parce qu’elle connote plus que la sexualité : elle révèle la part maudite en chacun et fait vaciller les repères de classe et d’identité. Lui refuser une visibilité a finalement produit l’inverse et les signes de discrimination se sont renversés en signes dans la nuit.
Certes, le jaune demeure à cette époque, comme dans tout l’occident, une couleur mal aimée : teint jaune, fièvre jaune, jaune des briseurs de grèves, comme dans la toile de Kupka, « le travail jaune », datée de 1906, qui présente un « mac » avec la femme qu’il a mise sur le trottoir.
Le jaune ne s’est pas départi de ses valeurs de trahison, valeurs qui se trouvent déjà dans la couleur du manteau de Judas dont le pare Giotto, aussi bien dans « Le baiser de Judas» (1306) que dans « Le pacte de Judas ».
Le jaune renvoie, en occident, à des activités douteuses, traîtres, malsaines.
Que le rouge et le jaune aient été les couleurs discriminantes des juifs et des prostituées fait sens.
Ces deux catégories de marginaux, d’exclus, de gens auxquels on attribuait un quartier ou une rue, pour les parquer et ne pas compromettre les habitants de la ville n’est pas anodin.
Dans les deux cas, il s’agit de désigner ceux qui ne respectent pas le dogme chrétien, et les signes qu’on leur donne se rapprochent : l’écharpe jaune ou aiguillette rouge des prostituées trouve un pendant dans la rouelle jaune et le chapeau pointu jaune des juifs.
Mais le jaune n’est pas que la couleur de la trahison, le jaune est aussi symbole de l’or. Or et prostitution ont également été confondus, comme le rappelle la ceinture dorée, comme l’illustrerait également La Fille aux yeux d’or de Balzac, Paquita Valdès, qui fut vendue par sa mère, à l’instar de nombreuses filles publiques au XIXe siècle.
Balzac ne met pas en avant ce statut prostitutionnel de son héroïne, car il écrit à une époque où, comme le précise Alain Corbin, dans des journaux comme Le Temps et Les Débats, le mot « syphilis » ne peut pas figurer.
Ainsi évoquer la prostitution au XIXe siècle, c’est bousculer un tabou et la représenter, c’est montrer l’envers du décor de cette société qui se veut policée.
Mais la prostituée, c’est aussi celle qui dans ce grand désordre remet en cause l’image même de la femme et introduit la modernité dans sa représentation.
La nouvelle de Barbey d’Aurevilly n’a pas pour titre la vengeance d’une prostituée, ni la vengeance de la duchesse de Sierra-Leone, mais « La Vengeance d’une femme ».
Une femme et une passante, comme celle que croquait Constantin Guys, « le peintre de la vie moderne », selon Baudelaire.
Or, quand Constantin Guys dessine des prostituées, celles-ci ont un port altier qui les ferait confondre avec les plus fières bourgeoises. Ce faisant, le peintre, qui fut aussi dessinateur de presse, en informant de la réalité de son siècle, envoie à la prostituée rien moins qu’un signe de reconnaissance.
par Véronique BuiPublié sur Fabula le 07 février 2008Notes :1 Dans Ecrits esthétiques, Baudelaire fait l’éloge de Constantin Guys, peintre de la modernité selon ses critères, et peintre également des prostituées. À ce propos, il précise que le peintre de la modernité est « un solitaire doué d’une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert d’hommes », qui « a un but plus élevé que celui d’un pur flâneur, un but plus général, autre que celui fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose qu’on nous permettra d’appeler la modernité ; car il ne se présente pas de meilleur mot pour exprimer l’idée en question. Il s’agit, pour lui, de dégager de la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique, de tirer l’éternel du transitoire. » Et il ajoute : « Si nous jetons un coup d’œil sur nos expositions de tableaux modernes, nous sommes frappés de la tendance générale des artistes à habiller tous les sujets de costumes anciens » (Ecrits esthétiques, Paris, 10/18, 1986, p. 372). Or, « Si un peintre patient et minutieux, mais d’une imagination médiocre, ayant à peindre une courtisane du temps présent, s’inspire (c’est le mot consacré) d’une courtisane de Titien ou de Raphaël, il est infiniment probable qu’il fera une œuvre fausse, ambiguë et obscure. L’étude d’un chef-d’œuvre de ce temps et de ce genre ne lui enseignera ni l’attitude, ni le regard, ni la grimace, ni l’aspect vital d’une de ces créatures que le dictionnaire de la mode a successivement classées sous les titres grossiers ou badins d’impures, de filles entretenues, de lorettes et de biches. » (ibid., p. 374).2 Comme l’écrit Alain Corbin, dans le premier chapitre de son essai Les Filles de noce, misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle (Paris, Flammarion, « Champs », 1982) : « Bien qu’il soit antérieur de plusieurs décennies au début de la période que nous avons entrepris d’étudier, négliger la livre de Parent-Duchâtelet serait se condamner à une totale incompréhension du débat qui se déroule durant le dernier tiers du siècle » (p. 13).3 Sabatier, Histoire de la législation sur les femmes publiques et les lieux de débauche, Paris, Gagniard, nouvelle édition, 1830, p. 3.4 Dans l’ouvrage de Sabatier, on découvre également qu’à Rome le jaune est tellement associé à l’image de la courtisane que les cheveux des prostituées étaient recouverts d’une perruque blonde. Comme il l’écrit à propos de Messaline, elle « quittait la couche de Claude, couvrait ses cheveux noirs d’une perruque blonde – attribut de la débauche – et, enveloppée d’une cape de nuit, accompagnée d’une esclave, elle pénétrait dans le réceptacle de la prostitution » (ibid., p. 52).5 Jérôme Carcopino, dans sa remarquable étude intitulée La Vie quotidienne à Rome à l’apogée de l’Empire (Paris, Hachette, 1939), décrit le théâtre à Rome, son fonctionnement, ses codes, et il précise que « les costumes drapés à la grecque ou à la romaine en situaient l’action et la condition sociale : blancs pour les vieillards, multicolores pour les jeunes gens, jaunes pour les courtisanes, pourpres pour les riches, rouges pour les pauvres, une courte tunique pour les esclaves, une chlamyde pour les soldats, un pallium roulé pour les parasites et bariolé pour les entremetteurs » ( p. 258 ; c’est nous qui soulignons).6 C’est ce que précise Sabatier en écrivant : « Charlemagne voulut améliorer l’état social et réformer les mœurs. Le premier monument français contre la débauche publique émane de lui. Par un capitulaire de 800, il prononça la peine du fouet contre les prostituées. Mesure qu’il renforça en obligeant les prostituées à parcourir pendant quarante jours la campagne avec un écriteau autour du cou tenu du cou à la ceinture » (op. cit., p. 86).7 Maxime Du Camp, Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie jusqu’en 1870, Paris, Rondeau, 1993, p. 339.8 Ibid., p.339.9 Sabatier, op. cit., p. 107.10 Honoré de Balzac, Le Succube, Œuvres diverses, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, t. 1, 1990, p. 251.11 Michel Pastoureau, Bleu, histoire d’une couleur, Paris, Seuil, Points, 2002, p. 81.12 Ibid., p.81.13 Alexandre Parent-Duchâtelet, De la Prostitution dans la ville de Paris considérée sous le rapport de l’hygiène publique, de la morale et de l’administration, Paris, Hachette, 1995, vol.1, p. 341.14 Ibid., p. 344.15 Alain Corbin, Les Filles de noce, misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, op. cit., p. 70.16 Comme le précise Sabatier dans son Histoire de la législation sur les femmes publiques et les lieux de débauche à propos de la prostitution à Rome : « Les lieux où les femmes exerçaient étaient ordinairement des quartiers retirés, dans des rues détournées, près des murs de la ville, aux environs du Cirque, des théâtres, du Stade. […] Lorsqu’il se formait un nouvel établissement de ce genre, on le faisait connaître au public, en plaçant au devant de la porte une lampe ou un pot-à-feu : c’était l’enseigne de la maison. Cet usage provenait de ce que, dans le principe, les filles auxquelles il était défendu d’exercer leur métier avant la neuvième heure du jour, qui était celle à laquelle les honnêtes femmes se renfermaient chez elles, se voyaient obligées, pour se faire remarquer pendant la nuit, de se poster près des édifices habituellement illuminés » (op. cit., p.50).17 Alain Corbin, op. cit., p. 121.18 Edmond de Goncourt, La Fille Elisa, Genève, Paris, Slatkine, Fleuron, 1996, p. 99.19 Guy de Maupassant, La Maison Tellier, dans Contes et Nouvelles, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1974, t.1, p. 256.20 Parent-Duchâtelet ajoute également que 1780 ont signé, mais mal ; 110 ont signé bien et même très bien et 248 n’ont pas fourni de renseignements (op. cit., p. 86).21 Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques, Paris, Garnier-Flammarion, 1967, p. 283.22 Ibid., p. 283.23 Ibid., p. 283.24 Ibid., p. 284.25 Ibid., p. 284.26 Ibid., p. 285.27 Emile Zola, Nana, Paris, Le Livre de poche, 1984, p. 266.28 Ibid., p. 266.29 Barbey d’Aurevilly, op. cit., p. 316.30 Algirdas Julien Greimas, La Mode en 1830, Paris, PUF, Formes sémiotiques, 2000, p. 66.31 Ibid., p. 66.32 Maxime Du Camp, Salon de 1857. Peinture-sculpture, Paris, Librairie Nouvelle, 1857, p.102.33 Guy de Maupassant, Le Signe, dans Contes et Nouvelles, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1992, t. 2 , p. 725-730.34 Charles Desmaze, Le Crime et la débauche à Paris. Le divorce, Paris, Charpentier, 1881, préface p. IV-V.35 Honoré de Balzac, Les Parisiens comme ils sont, 1830-1846, Genève, La Palatine, 1947, p.143.36 Emmanuel Pernoud, Le Bordel en peinture, L’art contre le goût, 1850-1940, Paris, Adam Biro, 2001, p. 22.37 Honoré de Balzac, Les Parisiens comme ils sont, op. cit., p.143-144.38 Alain Corbin, préface de l’édition La Prostitution à Paris au XIXe siècle par Alexandre Parent-Duchâtelet (1836), Paris, Seuil, 1981, p. 24.Pour citer cet article :Véronique Bui, "Le châle jaune des prostituées au XIXe siècle : signe d’appartenance ou signe de reconnaissance ?", Séminaire "Signe, déchiffrement, et interprétation", URL : http://www.fabula.org/colloques/document939.php
http://www.fabula.org/colloques/document939.php
 votre commentaire
votre commentaire
-
Pour apprécier les vidéos... cliquer sur le logo central de DEEZER -
colonne de gauche...en bas - le fond musical du BLOG Sera supprimé...
pour toutes les vidéos ...
 votre commentaire
votre commentaire
-
En plein cœur du Marais à Paris, dans l’un des quartiers les plus anciens et les plus prestigieux de la capitale, se niche le musée Carnavalet, consacré à l’histoire de Paris. Il occupe deux hôtels particuliers : l’Hôtel Carnavalet et l’hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau, laissant ainsi aux visiteurs plus d’une centaine de salles à explorer et des milliers d’objets, peintures, et maquettes à découvrir.
Hôtel Carnavalet
Hôtel le Peletier de Saint-Fargeau
Bien que l’aspect extérieur du musée ne reflète pas sa richesse, dans la cour intérieure on peut admirer l’architecture qui n’a quasiment pas changé depuis le XVIIe siècle. La cour intérieure est ornée d’une sculpture d’Antoine Coysevox qui représente Louis XIV en mémoire d’un festin solennel offert au roi le 30 janvier 1687.
Plus que centenaire, le musée Carnavalet a accumulé un nombre impressionnant d’œuvres en tout genre. On compte plus de 2000 peintures, 20 000 dessins, 150 000 photographies, 800 pièces de mobiliers et des milliers de vestiges archéologiques.
Le fond gallo-romain est d’ailleurs conservé dans l’orangerie, une immense pièce très agréable percée de grandes fenêtres.
L'orangerie
Il n’y pas de sens de visite défini. Un plan reste nécessaire pour éviter de se perdre tant il y a de pièces, d’autant plus que vous passez d’un hôtel à un autre en passant par le lycée Victor Hugo entre les deux !
Les collections sont rassemblées par époque (de la Préhistoire à la période gallo-romaine, le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe, le XIXe, le XXe et la Révolution française). Le choix est donné au visiteur d’aller voir ce qui lui plait.
Les Arts décoratifs sont à l’honneur grâce à des reconstitutions d’intérieurs parisiens avec le mobilier d’époque. On s’y croit tellement qu’on aimerait être projeté dans les siècles passés pour revivre ces moments de faste et de luxe.Le XXe siècle n’est pas oublié avec le magnifique don du joaillier Fouquet qui a laissé au musée sa boutique très exotique dans les décorations.
Autre pièce de renom, la salle de bal Wendel, peinte par José Maria, est un petit bijou. Ne manquent que les musiciens… Enfin, citons des noms célèbres qui ont laissé une partie de leur mobilier au musée : le bureau de Madame de Sévigné, la chambre de Proust, ou le fauteuil mortuaire de Voltaire.
Salle de Bal Wendel
Les collections du musée Carnavalet sont en lien étroit avec le monde littéraire. On y retrouve de nombreux portraits de Lamartine, Michelet ou Alphonse Daudet.
Alphonse de lamartine
Les collections révolutionnaires disposent d’objets nationalement connus comme le Serment du jeu de Paume, la Déclaration des Droits de l’Homme ou la Démolition de la Bastille.
Serment du Jeu de paume
Remontons le temps jusqu’à la Préhistoire. De nombreux vestiges archéologiques ont été retrouvés dans les sous-sols parisiens. Etonnant, des pirogues du néolithique ont été débusquées près d’un ancien village à Bercy. Elles sont exposées dans l’orangerie, près des bronzes romains et des fibules mérovingiennes.
Pirogues
L’évolution et l’urbanisation de Paris est contée par une série de tableaux depuis le Moyen-âge jusqu’à nos jours. On comprend alors comment se sont imbriqués de grands monuments comme le Louvre, les Invalides ou le Pont-Neuf avec les zones résidentielles.
Les grands personnages de l’histoire de la capitale trouvent ici leur place, qu’ils soient issus du monde politique, littéraire ou mondain.
Histoire du musée
Le nom Carnavalet est une transformation du nom d’un gentilhomme breton nommé François de Kernevenoy dont la veuve acheta l’Hôtel en 1578. Un siècle plus tard, Madame de Sévigné résida dans ces locaux jusqu’à sa mort en 1696.
La Ville de Paris achète l’hôtel Carnavalet en 1866 avec l’idée d’y installer un musée sur l’histoire de la capitale. Mais un terrible incendie à l’Hôtel de Ville détruisit de nombreuses œuvres ; il faudra attendre 10 ans pour que le musée ouvre enfin ses portes. Le fonds archéologique sera la première étape, puis les objets révolutionnaires, les peintures, et la reconstitution de décors.
L’ajout de la bibliothèque historique entraîne un manque de place dans l’hôtel, d’où le rachat du bâtiment adjacent : l’hôtel Le Peletier. Tous les éléments de mode furent déplacés au musée Galliera.
Le musée Carnavalet
Musée de l'histoire de Paris, le musée Carnavalet est installé dans deux hôtels particuliers du Marais (entrée 23 rue de Sévigné, IIIe). Il conserve des collections évoquant la vie quotidienne et intellectuelle de la capitale, de la préhistoire à nos jours.
Salle XIXème
Alors que l'on reconnait Napoléon dans le grand tableau au fond de la pièce, il faut aussi prendre le temps d'admirer les objets et peintures de cette salle qui montre bien le Paris du XIXe siècle.
Mobilierdu duc et de la duchesse de Gaète
Martin Gaudin devint duc de Gaète lorsqu'il fut nommé ministre des finances de Napoléon 1er puis régent de la Banque de France sous Louis XVIII. Il se maria en 1822 à l'âge de 70 ans! On suppose que la plupart de ce somptueux mobilier, de style Empire et Restauration, a été acquise lors de son mariage. A noter le portrait de Gaudin en uniforme de ministre à gauche et d'Eugénie Goujon, devenue la duchesse de Gaète, tout au fond de la pièce.Ces meubles ont tous appartenu à Marcel Proust (1871- 1922) à l'époque où ce dernier affectionnait beaucoup les soirées mondaines. Peu après, il se retira chez lui pour écrire, recouvrant ses murs de liège pour lui assurer un silence permanent. C'est dans ce modeste lit de laiton qu'il écrivit couché et de nuit une bonne partie d’"A la recherche du temps perdu", un chef d'œuvre littéraire.

Le quartier du Marais
Souvent très apprécié des touristes ou même des Parisiens en balade, le quartier du Marais est l'un des plus anciens de Paris. En attestent les différents tableaux d'époque exposés dans le musée.
Salon bleu Louis XV
Les boiseries, provenant de l'hôtel Brulart de Gentis, ont été remontées en 1923 au musée.
L'entrée du musée
L'entrée du musée se fait au 23 rue de Sévigné, à l'hôtel Carnavalet, mais le musée continue jusqu'au 29, englobant le lycée Victor Hugo.
Salon jaune Louis XV
Les boiseries proviennent du salon de musique de l'hôtel Stuart d'Aubigny et furent restaurées dans le style Louis XV. Les meubles sont du XVIIIe, à l'exception de la harpe du luthier Naderman des années 1780.L'hôtel Carnavalet accueille ici des œuvres d'art et du mobilier contemporain de sa construction. Au centre, on remarque une table de changeur qui servait à compter et ranger les espèces.
La qualité du contenu du musée Carnavalet est à la hauteur du bâtiment. A noter que le musée n’occupe pas moins de deux hôtels particuliers reliés par le lycée Victor Hugo.
Sur la façade du musée Carnavalet, on peut observer entre chaque fenêtre de grandes figures sculptées en bas-relief. On reconnait les quatre allégories des quatre éléments ainsi que des divinités.

Paris au XIXème siècle
Près de l'orangerie, on peut accéder aux salles XIXe qui permettent de constater la richesse culturelle et artistique de Paris à cette époque. On y trouve de nombreux paysages de la capitale, des portraits de personnages célèbres et de nombreux objets d'époque.Il faut traverser les cours intérieures des hôtels Carnavalet et Le Peletier de Saint Fargeau qui se rejoignent par le lycée Victor Hugo grâce à une galerie de liaison.

Collection archéologique
L'histoire de Paris remonte à la Préhistoire. Déjà, des hommes vivaient sur ce qui allait devenir Parisii, une tribu gauloise, qui donnera naissance au nom Paris.Madame de Sévigné a vécu à l'hôtel Carnavalet de 1677 à 1696. Pas étonnant donc d'y trouver une galerie à son nom. D'autant plus que les boiseries sont les seules de l'hôtel conçues pour elle. On l'aperçoit dans le tableau au fond de la pièce.
L'orangerie abrite les collections archéologiques du musée Carnavalet. Bronzes romains, pirogues néolithiques ou fibules gallo-romaine, voici Paris comme vous ne l'avez jamais vu. L'orangerie de l'hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau fut construite à la fin du XVIIe siècle sur l'emplacement de ce que l'on nommait le Petit Arsenal. La pièce, très lumineuse, est percée de douze fenêtres en symétrie. Le fronton extérieur représente l'allégorie de la Vérité.
Les meubles exposés dans cette reconstitution de la chambre de Marcel Proust permettent d'imaginer les décors des 3 domiciles qu'il occupa après la mort de sa mère en 1905. Les plaques de liège rappellent celles qui recouvraient les murs de la chambre du 102, boulevard Haussmann, et l'on retrouve le lit à barreaux de son enfance, le paravent chinois, la bibliothèque et le portrait de son père.

Hôtel Le Peletier de Saint FargeauL'escalier d'honneur du XVIIe siècle : sa rampe en fonte, l'une des premières réalisées dans ce matériau, fut forgée d'après un dessin de Bullet. Elle adopte la forme d'une succession de balustres, surmontés d'une frise de coquilles.
Parterres de broderie, buis taillés, massifs fleuris : les jardins de Carnavalet dénombrent plus de 2 000 espèces végétales. Vous pourrez vous reposer au calme dans ce jardin à la française, au milieu des tulipes, des monnaies du pape et des giroflées, selon la saison.
Cette statue est l'original de la Victoire qui trône au sommet de la fontaine du Palmier, place du Châtelet. Elle est exposée dans la cour du musée. La fontaine, qui tient son nom des feuilles de palmier qui ornent sa colonne, avait été construite à la gloire des victoires napoléoniennes en 1808.
SOURCES
http://acoeuretacris.centerblog.net/rub-Musees.html
 4 commentaires
4 commentaires
-


Mistinguett, de son vrai nom Jeanne Bourgeois, née à Enghien-les-Bains le 5 avril 1875 et décédée à Bougival le 5 janvier 1956, est une chanteuse et actrice française.Fille d'Antoine Bourgeois, travailleur journalier de 30 ans, et de Jeannette Debrée, couturière de 21 ans, Jeanne Florentine Bourgeois est née au 5 de la rue du Chemin-de-Fer (actuelle rue G.-Israël) à Enghien-les-Bains. La famille déménage à Soisy-sous-Montmorency où elle passe son enfance.

Après avoir pris des cours de théâtre et de chant, elle débute sa carrière en 1885 : dans le train qui l'amène à Paris pour ses leçons de violon, elle rencontre Saint-Marcel, responsable de revue au Casino de Paris qui l'engage pour le lever de rideau.
Elle cherche sa vocation, sa voix et son nom de scène (successivement Miss Helyett, Miss Tinguette, Mistinguette.
Elle entre en 1894 au Trianon-Concert où elle lance
« Max, Ah c'que t'es rigolo », mais sans grand succès.
De 1897 à 1907, elle se produit à l'Eldorado en chanteuse comique, en épileptique, en gigolette, et y découvre petit à petit comment tenir une scène. Après avoir appris à pallier son insuffisance vocale par un brin de comédie, une mimique unique et des pas de danse, elle en sort vedette consacrée. Le public commence à l'aimer.
Jusqu'en 1914, elle alterne pièces de théâtre, revues et cinéma muet, expériences qui lui seront profitables pour devenir finalement la « Mistinguett » telle qu'on la connaît et telle qu'elle le restera jusqu'à la fin de sa longue carrière.
En 1909, Max Dearly la choisit comme partenaire pour créer la valse chaloupée dans une revue du Moulin rouge. Puis dans la revue La Revue c'est La valse renversante avec Maurice Chevalier aux Folies Bergère en 1912, qui donnera lieu à une histoire d'amour longue de dix ans. Le couple est surnommé par la presse « les danseurs obsédants ».

Lorsque la première guerre mondiale éclate, Maurice Chevalier est blessé au front et fait prisonnier en Allemagne. Voulant le faire libérer, elle se porte volontaire pour jouer le rôle d'espionne. Elle offre ses services au général Gamelin et est autorisée à circuler librement en Europe :
elle récolte de nombreux renseignements du prince allemand de Hohenlohe[5] alors à Berne ou du roi Victor-Emmanuel III en Italie. Elle parvient à faire libérer son amant Maurice Chevalier en 1916 grâce à ses relations avec le roi d'Espagne Alphonse XIII.
En 1918, elle succède à Gaby Deslys au Casino de Paris, dont elle reste la vedette incontestée jusqu'en 1925. Dans les années 1920, elle enchaîne les opérettes à succès : Paris qui danse, Paris qui jazz, En douce, Ça, c'est Paris. Durant cette période, avec successivement Harry Pilcer, Earl Leslie, Jean Gabin, Lino Carenzio, Georges Guétary, elle est la Miss des grandes revues qui feront accourir le tout Paris.
À partir de 1916, elle s'entiche d'un tout jeune affichiste de 16 ans nommé Charles Gesmar. Jusqu'à la mort de celui-ci en 1928, il lui dessine nombre d'affiches et de costumes qui font sa gloire dans les années 1920. Il est son confident au point d'habiter sur son palier et de la surnommer « Maman ».

Elle est la vedette du grand bal d’ouverture du Copacabana Palace, à Rio de Janeiro, en 1923.
Devenue une gloire nationale, elle chante Ça c'est Paris composé par Jose Padilla, Mon homme[8] sur les paroles d'Albert Willemetz, qui écrit aussi pour elle de nombreuses chansons et revues pour les Folies Bergère et jusqu'aux États-Unis. Image type de la parisienne, elle fut en concurrence avec Joséphine Baker. En 1937, elle tourne son premier film parlant, Rigolboche.
Deux cent vingt sept mille entrées. - Voilà, au dernier décompte, le nombre de pages dédiées ou qui faisaient référence à Mistinguett sur le Web (août 2008). - Aussi bien dire que si l'on s'intéresse quelque peu à la chanson française de la première moitié du siècle dernier, on tombera invariablement sur cette "Reine du Music-Hall" qui sans avoir créé le genre des grandes revues, avec meneuse, danseurs et danseuses, l'a poussé jusque dans ses extrêmes limites au point où il est presque disparu avec elle.
Lorsqu'elle mourut en 1956, à 81 ans, elle fit la une de tous les journaux de Paris. - On chuchotait qu'elle avait (encore !) les plus belles jambes du monde... - Et Colette disait qu'elle n'était pas une artiste du Music-Hall mais une "propriété nationale".

Pas mal pour une meneuse de revue qui n'avait pas de voix, savait à peine danser et dont le répertoire s'est toujours limité à une centaine de chansons [*].
[*] Ce qui est un peu faux car Martin Pénet - voir ci-dessous - en rapporte, dans son Mistinguett, la Reine du Music-Hall plus de deux cent vingt sauf qu'elles ne furent pas toutes retenues et si elle a fait plus de cent cinquante enregistrements, il y a eu plusieurs doubles. En bref, le tout pourrait se résumer en quelque vingt à trente chansons toujours en mémoire mais, dans le lot de grands classiques, du genre : "Mon homme", "C'est vrai", "Ça, c'est Paris", etc.)

Elle est née Jeanne Florentine Bourgeois, au 5 de la rue du Chemin-de-Fer à Enghien-les-Bains, le 3 avril 1875, fille d'Antoine Bourgeois, journalier, 30 ans, et de Jeannette Debrée, couturière, 21 ans, et non en 1872 ou 1873 et même 1878 comme l'ont cité plusieurs dictionnaires. - Il faut retenir cette date ne serait-ce que pour se rappeler que, née en 1875, elle a eu 25 ans... en 1900 et qu'en 1900, la "Belle Époque" débutait...

Après des cours de chant - qu'elle sèche allègrement -, celle qui fut appelée à ses débuts Miss Hélyett puis Mistinguette (avec un "e") entre au Trianon-Concert en 1894 où elle lance "Max, Ah c'que t'es rigolo". - Pas un grand succès mais on la garde.


Photos de Mistinguette (avec un "e")
Collection Jean-Yves PatteElle passe à l'Eldorado, en 1897, en chanteuse comique, en épileptique, en gigolette, pour y apprendre, petit à petit, à tenir une scène. ("À force d'assiduité, écrira-t-elle plus tard, je suis devenue nature".) - Elle y restera jusqu'en 1907 - ayant entre temps enlevé le E final de son nom - où, après avoir appris à suppléer à son insuffisance vocale un brin de comédie, une mimique unique et des pas de danse, elle en sort vedette consacrée. - Elle a appris à se faire aimer de son public.

Jusqu'en 1914, elle alterne pièces de théâtre, revues et cinématographe, expériences qui lui seront profitables pour définir finalement LA Mistinguett que l'on a par la suite connue et qu'elle sera jusqu'à la fin de sa longue carrière.
En 1909, Max Dearly la choisit comme partenaire pour créer la valse chaloupée au Moulin Rouge. Puis c'est la valse renversante avec Maurice Chevalier aux Folies Bergère en 1911, qui donnera lieu à une histoire d'amour longue de 10 ans.
Un arrêt (si peu...) à cause de la guerre puis elle fait sa rentrée à nouveau, avec Chevalier (qu'elle a réussi à faire libérer du camp de prisonniers où il était), en 1917.
Elle débute au Casino de Paris en 1918, reprenant la suite de Gaby Deslys, et en restera la vedette incontestée jusqu'en 1925, pour atteindre ensuite le sommet de sa carrière au Moulin Rouge dans 3 revues ébouriffantes entre 1925 et 1928.
Durant cette période, avec, successivement Harry Pilcer (voir à Gaby Deslys), Earl Leslie, Jean Gabin, Lino Carenzio, Georges Guétary (pour ne nommer que ceux-là), elle sera la Miss des grandes revues qui feront accourir le tout Paris.
Jusqu'à la deuxième grande guerre, elle sera la seule et unique Miss avant de disparaître peu à peu dans d'innombrables galas où son public continue à l'applaudir à tout rompre.

Quand elle mourut, elle était devenue, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, "propriété nationale" (Colette).
C'est peu dire d'une interprète qui fut, pendant des années, l'incarnation de la chanson française de spectacle, en France tout comme à l'étranger. Mais comme on peut le lire partout, il faut l'avoir vue.
Filmographie
Grande activité cinématographique pour la vedette. En effet, entre 1908 et 1928, elle tourne dans pas moins de 45 films (muets bien sur), et ne reviendra au cinéma parlant qu'en 1936. C'est beaucoup mais bien peu pour capter le magnétisme de Mistinguett.
Le seul film parlant, Rigolboche, de Christian-Jaque nous la présente à 61 ans comme maman d'un enfant de 6 ou 8 ans (sic) mais nous permet de la voir et de l'entendre chanter "Oui, je suis d'Paris", "Au fond de tes yeux" et "Pour être heureux, chantez !"
Restent les bandes d'actualités où, enfin, on peut voir la Miss telle qu'elle était, s'adonnant à son art suprême, celui du Music-hall. Une des plus délicieuses est le Bal des petits lits blancs en 1931 (ou 1932) où elle chante et danse "La rumba d'amour" sur le pont d'argent à l'Opéra Garnier.

Quelques films de la période 1908-1917
- L'Empreinte ou La main rouge (1908) dans lequel Miss danse la valse chaloupée avec Max Dearly.
- Fleur de pavé (1909) scène dramatique, avec Prince-Rigadin
- Une femme tenace (1910) scène comique, avec Prince
- Les timidités deRigadin (1910) scène comique, avec Prince-Rigadin, encore
- Les fiancés de Colombine (1911) comédie, Mistinguett est Colombine
- La ruse de Miss Plumcake (1911) scène comique, avec Baron fils
- La folle de Pen'March (1912), un drame... breton
- La valse renversante (1912), une comédie pittoresque, avec Maurice Chevalier
- Les Misérables (1913) première adaptation complète du roman de Victor Hugo et premier grand film français de réputation internationale. Miss y tient le rôle d'Éponine.
- La Glu (1913) d'après le roman de Jean Richepin
- Mistinguett détective I et II (1917) quatre épisodes
La Miss ne reprendra le chemin des studios qu'en 1927 pour L'île d'amour (sorti en 1928), puis en 1936 pour Rigolboche (voir à ce nom).

Enregistrements
Elle en a fait environ 150, de 1920, en duo avec Louis Boucot, jusqu'en 1942 mais beaucoup de doubles, enregistrés à quelques semaines de distance, parfois, sur deux marques différentes.

Description
Armand Bernard (1893-1968), comédien français, Mistinguette (1873-1956), chanteuse française, et Lino Carenzio (1907-1973), comédien italien, à Genève en décembre 1946.
Mistinguett et Carenzio donnent un gala au Palais d'Hiver - actuel Palladium - le 9, tandis que Bernard joue Bichon de J. de Letraz à la Comédie.Mistinguett Détective
MISTINGUETT DETECTIVE
C'est à André Hugon que Mistinguett a du finalement ses plus grands succès cinématographiques de l'époque du cinéma muet.CHIGNON D'OR et FLEUR DE PARIS ont rempli les salles pendant plusieurs mois.La série MISTINGUETT DETECTIVE comprend deux épisodes tournés au plus fort de la bataille de verdun entre 1916 et 1917.Dans la première partie,précisément,elle déjoue les plans d'une "cinquième colonne" chargée d'organiser le ravitaillement de sous-matins allemands en Méditerranée.Dans la deuxième partie,un vol de documents dans un hôtel près de La Ciotat oblige Mistinguett à enquêter...
Voir la discographie ci-jointe
Nous en citerons sept dont un septième qu'on retrouvera dans nos pages sur Cinquante chansons du Temps des Cerises aux Feuilles mortes ("Mon homme", version 1938 - au numéro 29).
Elle décède le 5 janvier 1956 et repose désormais au cimetière d'Enghien-les-Bains.

Une plaque a été posée sur l'immeuble qu'elle avait habité au numéro 24 du boulevard des Capucines dans le 9e arrondissement de Paris.
En 2006, la ville d'Enghien-les-Bains rend un hommage à Mistinguett . Des festivités multiples sont organisées, réunissant de multiples formes d'expression artistique. Les activités du festival incluent la projection du film Mistinguett : Mon Enghien, produit pour l'occasion par Gaumont Pathé Archives et réalisé par Christian Lamet. Ce documentaire inédit constitué d'archives et de documents rares a également fait l'objet d'un DVD en série limitée.

 2 commentaires
2 commentaires
-


Georges ROUQUIER
est né le 23 juin 1909 à Lunel Viel, dans l'Hérault, d'un père Aveyronnais et d'une mère Languedocienne.
English VersionJusqu'à l'âge de cinq ans sa vie est sans histoire - simplement il se sent un peu seul. Sa mère tient une petite épicerie à Montpellier et a peu de temps à consacrer à son fils. Il en est de même pour son père, très pris par la laiterie qu'il exploite avec un de ses frères à Lunel. Le petit Georges rêve. Un de ses divertissements favoris est le cinéma qu'il a découvert parce qu'il y a une salle tout près de l'épicerie. Il n'a pas beaucoup d'argent à dépenser, aussi prend-il les places les moins chères, celles qui sont situées derrière l'écran. C'est en voyant les films à l'envers que naît en lui la passion du cinéma. 1914. La guerre éclate.
Son père est appelé sous les drapeaux. Tout s'assombrit autour du petit Georges. Sa mère est triste et pleure souvent. Partout, on entend le mot guerre mais ce mot ne signifie rien pour Georges ROUQUIER. Cependant, il pressent que cela veut dire : malheur.
En 1915, au mois de février, le père de Georges est tué à Verdun. Il a 33 ans, Georges 6. Tout bascule. Sa mère qui est couverte de dettes doit se séparer de l'épicerie et aller travailler chez les particuliers. Elle décide donc d'envoyer son fils passer quelques mois chez son oncle à Goutrens à la ferme de Farrebique. Georges y fait la connaissance de ses cousins et cousines qui l'accueillent comme un frère. Il y restera six mois. Puis, retour à Montpellier pour aller à l'école.
À l'âge de 14 ans, il veut travailler pour aider sa mère. Il est embauché comme apprenti typographe dans une imprimerie de Montpellier.
À l'âge d 16 ans, il "monte" à Paris où sa cousine Renée, qui vient de s'y installer avec son mari, le caricaturiste Albert Dubout, l'hébergera et l'aidera à trouver un emploi. Après quelques déboires, il trouvera une place de linotypiste à l'imprimerie du Droit à Choissy-le-Roi. Maintenant qu'il gagne sa vie, il peut retourner au cinéma et il fréquente assidûment ce qu'on appelait alors "Les temples du cinéma" : "LES URSULINES", le "CINÉ LATIN", et plus tard le "STUDIO 28". Il devient un cinéphile assidu et lit diverses revues de cinéma "pour être au courant de tout". Un jour, dans l'une de ces revues, il voit une interview d'Eugène Deslaw où celui-ci raconte comment il avait tourné sa "SYMPHONIE DES MACHINES" et où il précisait que ce film lui avait coûté 2500 francs. La réaction de ROUQUIER fut immédiate : "2500 francs!et il y en aurait qui ferait cu cinéma et pas moi ?" Pour économiser cette somme plus rapidement il demande à faire des heures de nuit. Et un jour, enfin, il a ses 2500 francs. Il part aussitôt dans son Midi et tourne "VENDANGES" (1929). Malgré la bonne critique de Maurice Bessy, ROUQUIER n'est pas satisfait.
C'est la naissance du cinéma parlant. Maintenant il faut beaucoup plus d'argent pour faire du cinéma. Ses rêves s'écroulent.
Mais en 1942, treize ans après "VENDANGES", le hasard donne une vraie chance à ROUQUIER lorsqu'il fait la connaissance d'Étienne Lallier, un producteur qui accepte de financer "LE TONNELIER". Le tournage doit avoir lieu dans le Midi. C'est l'occupation, la France est partagée en deux et passer la ligne de démarcation n'est pa une mince affaire. En 1943, au Congrès du Film Documentaire,"LE TONNELIER" obtiendra le Grand Prix ex-aequo avec deux autres courts-métrages.
Cependant, ROUQUIER craignant d'être requis par le STO et envoyé en Allemagne décide de se jeter à l'eau et de tenter de devenir un cinéaste à part entière en acceptant des films de commande. Ainsi tournera-t-il cette même année trois courts métrages :
"LE CHARRON", "LA PART DE L'ENFANT" et "L'ÉCONOMIE DES MÉTAUX".
En 1944, Lallier lui propose de réaliser un long métrage qui s'articulerait autour des quatre saisons. Ce sera "FARREBIQUE" qui remporte outre le Prix de la Critique Internationale à Cannes en 1946, plusieurs autres prix dont le Grand Prix du Cinéma Français, la Médaille d'Or à Venise, et le Grand Épi d'Or à Rome.
En 1948, il tournera "L'ŒUVRE SCIENTIFIQUE DE PASTEUR" avec Jean Painlevé. Ce film terminé, ROUQUIER tente de mettre sur pied un projet sur l'un des plus beaux exploits du Général Leclerc "LA PRISE DU FORT DE KOUFRA". Il n'y réussira pas.
En 1949, il tournera "LE CHAUDRONNIER" et deux ans plus tard "LE SEL DE LA TERRE", film sur la Camargue.
À la même époque, il réalise deux films chirurgicaux avec le Professeur Merle d'Aubigné.
En 1952, il tourne "UN JOUR COMME LES AUTRES" pour l'office de prévention contre les accidents du travail et "LE LYCÉE SUR LA COLLINE" pour l'Éducation Nationale.
En 1953, ce sera "MALGOVERT", le percement d'une galerie à travers la montagne entre le barrage de Tignes et de Bourg St. Maurice.
Il tournera surtout "SANG ET LUMIÈRE", un long métrage en couleur, tiré d'un roman de Joseph Peyré,

Le tournage, en 1955, de "HONEGGER", fut difficilecar le compositeur à qui est consacré ce documentaire était gravement malade. Ce film obtiendra le prix du Film d'Art à Venise en 1957.
Puis, de nouveau, un film de commande, "LA BÊTE NOIRE".
Entre 1954 et 55, il tourne "LOURDES ET SES MIRACLES", long métrage d'une heure et demi, divisé en trois parties : Témoignages - Pèlerinage et Imprévu. La caméra de ROUQUIER présente les événements et laisse au spectateur le soin d'élaborer sa propre opinion.
Cette même année, ROUQUIER tente une fois encore l'aventure de la fiction avec "S.O.S. NORONHA", film inspiré d'un fait réel : une station de radio-guidage au large de la côte Brésilienne est attaquée par des forçats pendant que Mermoz tente de relier Natal à Dakar pour y transporter le courrier postal.
En 1957 ROUQUIER prêtera sa voix au film de Chris Marker "LETTRE DE SIBERIE".
En 1958, il tourne UNE BELLE PEUR", film sur la prévention des accidents chez les enfants. et "LE BOUCLIER", son troisième court-métrage sur la prévention et la sécurité.
Au Canada, il tourne, "LE NOTAIRE AU TROIS PISTOLES", puis en 1963 "SIRE LE ROY N'A PLUS RIEN DIT".
De 1960 à 1965 ROUQUIER tournera plusieurs films pour les Ministères et organismes officiels, tant en France qu'en Afrique....
Il interprétera le rôle de Voltaire dans le film "MANDRIN" de J.P. Le Chanois et celui du médecin dans "NOUS N'IRONS PLUS AU BOIS" de G. Dumoulin.
En 1967, il incarne Mathieu, rôle principal dans "PITCHI POI", d'après une œuvre de François Billetdoux, dramatique en Eurovision, tournée dans 17 pays d'Europe.
En 1968 il est Jeff dans le film de Jean Herman avec Alain Delon, et le Procureur Général dans "Z" de Costa-Gavras. En 1972, il interprète le peintre Battestini dans "LE SECRET DES FLAMANDS". Quelques années plus tard, il se glissera dans la peau dans un autre peintre "LEONARD DE VINCI" de Pierre Lary
Durant les années 1972-73 il est producteur de la série "LES SAISONS ET LES JOURS" pour la 2e chaîne.
En 1976, il tourne LE MARÉCHAL FERRANT" qui obtiendra le César du Court Métrage du Documentaire.
1981, ROUQUIER interprète deux rôles : celui du père Pivel dans une dramatique TV, puis le maître-verrier dans "L'AMOUR NU" de Yannick Bellon.
1982-89
ROUQUIER réalise enfin "38 ANS APRÈS", son vieux rêve de donner une suite à "FARREBIQUE. Ce sera BIQUEFARRE". Ce film obtient le Grand Prix spécial du Jury au Festival de Venise en 1983.Georges ROUQUIER s'éteint le 19 décembre 1989, à l'âge de 80 ans, à Paris.
sources : http://www.lips.org/bio_Rouquier.asp
Farrebique / Biquefarre
Il n'y a que Kto, la chaîne catho, pour programmer Farrebique un après midi de semaine.Il faut être un chômeur invétéré pour le voir... mais quel bonheur!Dans l'immédiate après guerre, Georges Rouquier plante sa caméra à Farrebique, son village natal de l'Aveyron. Il en sort un film à mi-chemin du documentaire ethno-sociologique et de la fable naturaliste. Farrebique est une longue ode au monde paysan, alors immémorial. Les travaux des champs, le puis, la table des veillées, les bêtes, les mariages et les naissances, les enterrements... la vie s'écoule au rythme des saisons sur un pas de bourrée en sabots, entre copains quand le vin chauffe la tète.L'électricité arrive enfin à la ferme, pour la plus grande joie des jeunes et la défiance des anciens qui ont encore les principes de la société paysanne, autarcique et démonetarisée d'Avant : C'est cher! craignent-ils de ne pas trouver l'argent ? Les paysans comptent leurs sous et ne s'endettent pas.
Tourné en décors réels, avec des acteurs du cru, la plupart de sa propre famille, Farrebique est un O. P-rojeté- N. I. dans la production cinématographique de 1946. Il devance la nouvelle vague de quinze années et les paysans acteurs de Rouquier ont visiblement influencé le jeu (?) de Jean-Pierre Léaud (ok, ça se veut une vacherie!).
Entre Jour de fête de Tati et L'Atalante de Jean Vigo, Rouquier montre les choses qu'il connaît, avec une simplicité pourtant parfois lyrique : J’aime le documentaire, parce qu’il est l’expression cinématographique de la vérité. Farrebique est un "film vrai" parce qu’il a été tourné dans un vrai village du Rouergue avec de vrais paysans pour interprètes. Je veux faire vrai et simple explique t-il.
Certains critiques ne se trompent pas: "Voici un film qui vivra longtemps dans la mémoire de ceux qui auront la chance, un jour, de tomber sous son charme" (The New York Times, 24 février 1948.);
"Je suis de ceux qui sont sortis de la projection de Farrebique complètement bouleversés. Rares en effet sont les films où l'on sent à ce point la présence du cœur. Mais plus encore peut-être, ce qui m'émeut profondément dans le film de Rouquier, en même temps que cet amour de la nature d'une force lyrique extraordinaire, c'est sa pureté." (Marcel Carné, 4 octobre 1946);
"Je tiens Farrebique pour un grand événement. Un des très rares films français qui, ait pressenti la révolution réaliste dont le cinéma avait besoin (…)Un critique cinématographique, sans doute trop distingué, se plaint dans son papier d'avoir vu les vaches bouser, la pluie tomber, les moutons bêler, les paysans patoiser, de quoi, dit-il, le dégoûter de la campagne. De quoi vous dégoûter des critiques de cinéma." (André Bazin, critique).
 En 1983, Rouquier retourne à Farrebique et plante sa caméra aux mêmes endroits. Pas tout à fait, la vieille ferme est abandonnée pour une maison moderne avec du formica. Le puis, le four à pain sont en ruine. La motorisation à gagné la campagne et les champs se sont vidés des animaux. Raoul vend sa ferme pour aller travailler en ville. Il refuse de faire des animaux en batterie, de remplir des papiers, de doser les aliments médicamenteux et les poisons insecticides.
En 1983, Rouquier retourne à Farrebique et plante sa caméra aux mêmes endroits. Pas tout à fait, la vieille ferme est abandonnée pour une maison moderne avec du formica. Le puis, le four à pain sont en ruine. La motorisation à gagné la campagne et les champs se sont vidés des animaux. Raoul vend sa ferme pour aller travailler en ville. Il refuse de faire des animaux en batterie, de remplir des papiers, de doser les aliments médicamenteux et les poisons insecticides.L'industrialisation a bouleversé un mode de vie. L'endettement est entré dans les moeurs: Il faut s'agrandir, encore s'endetter, rabbache le fils au père incrédule. Construire des bâtiment modernes et s'équiper d'une machinerie infernale. Faut-il vendre Biquefarre?
L'argument est ténu mais ce n'est pas l'important. La narration de Rouquier est précise, il dresse un tableau en forme de réquisitoire sur le renversement des valeurs. Il n'y a rien à ajouter au montage, en parallèle, des scènes d'allaitement des veaux sous la mère, tendrement léchés, et en batterie, la tète dans un sceau, cherchant le contact, leurs cous hors des grilles des boxes. Il montre l'incarcération, le défilé des vaches et la traite à la chaîne. La force du documentariste tient dans son effacement, reste un long silence accusateur. Il croque le portrait d'une campagne désormais sans animaux, celui d'un paysan ouvrier, simple rouage d'une machine qui le dépasse.

Le réalisateur est décédé à 80 ans, en 1989. Il existe dans l'écriture des sécheresses fertiles. L'écriture de Rouquier a la concision, la sérénité et la rigueur austère d'un classique. M. Morandi; Il Giorno (Venise), 1983.
Farrebique / Biquefarre, complètement ignoré en France, est régulièrement étudié dans les universités et les écoles de cinéma américaines. Il est cité par Spielberg et Coppola comme un film essentiel dans l'Histoire du 7e art.
Farrebique ou les quatre saisons; 1947; Grand Prix de la Critique internationale à Cannes (1946), Grand Prix du Cinéma français (1946 ), Médaille d'or à Venise (1948), Grand Epi d'or à Rome (1953).
Biquefarre; 1983; Grand Prix Spécial du Jury au Festival de Venise 1983; Sélection à Cannes 1983SOURCES
SUPERBE BLOG -

Les lettrages proviennent de l'Agence Eureka votre commentaire
votre commentaire
Dona Rodrigue