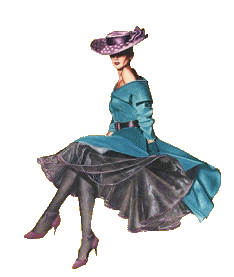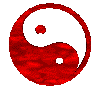-
Par Dona Rodrigue le 16 Novembre 2011 à 10:58
La Seine à Paris au XIXe siècle
(D'après A travers le monde, paru en 1895)
La Seine, nous apprend la géographie, est un fleuve de France qui en traverse la capitale Paris après avoir reçu son affluent la Marne. En Parisien qui se respecte, nous avions atteint un certain âge sans éprouver le besoin de nous munir d'autres renseignements que ces données classiques.
Mais que faire en été à moins qu'on n'excursionne ? La campagne ? non, pour rien au monde ; mais le souvenir d'anciens voyages poussés assez loin vers le nord de la France, en des endroits nommés, pensons-nous, Joinville, réveilla en nous des velléités de canotage, et voilà comment, un beau matin de septembre, nous nous lançâmes dans un yacht à la découverte de terres inconnues.
Promenade en barque sur la Seine.
Ferdinand Heilbuth (1826-1889)
Pour le premier jour nous voulions remonter le fleuve, nous lancer sur ses flots bleus, afin de pouvoir nous donner l'illusion d'un vrai voyage.
Notre expédition partit sous les auspices les plus favorables, saluée du bourdonnement joyeux de toute une bande de gens qui voguaient vers l'île de Robinson. Mais déjà le sentiment austère de notre mission s'emparait de nous : l'horizon, à notre nord, est barré par la haute structure du Point-du-Jour, ses arches innombrables hardiment profilées sur le ciel ; puis au-dessous de l'encadrement sombre d'une arche nous découvrons Paris. C'est là le véritable objet de notre voyage. Notre cœur palpite et nous commençons à croire qu'il faut sortir de Paris pour apprécier tout le charme d'y rentrer.
Salués par le geste auguste de la statue de la Liberté qui garde si superbement le cap extrême de l'île des Cygnes, nous arrivons bientôt après à la véritable entrée de Paris, à ce splendide péristyle qui s'étend depuis les bâtiments de la dernière exposition jusqu'au Trocadéro en passant par le phare qui brille tout là-haut à 300 mètres au-dessus de la Seine.
Le panorama ensuite se déroule : nous voyons des ponts, des ponts, une longue file de péniches dévidant un grave monôme derrière un petit remorqueur, puis plus loin une profondeur imposante de façades sévères – le Louvre – rejoignant au fond une véritable toile de décor moyen âge tout hérissée de flèches, de clochetons, de dômes : la Cité vons notre course en longeant la berge à droite. Notre décor du fond grandit.
Près du pont des Arts, à quelques mètres de nous, deux blanchisseurs amateurs frottent énergiquement de douteuses chemises et de problématiques chaussettes. Étonnez-vous donc de la saveur de l'eau de Seine ! Au débouché du pont des Arts nous manquons d'être pris entre un lourd bateau omnibus et une guêpe à corsage blanc tout empanaché de fumée. Un coup de barre nous dérobe à ces deux intrus et, bientôt après, ayant contourné l'abside de Notre-Dame, nous nous engageons dans des eaux déjà un peu moins tourmentées. Dans le lointain, d'ailleurs, point déjà la station terminus de notre voyage : les régiments de tonneaux de Bercy.
Quelques brasses encore et nous abordons dans notre port d'attache où nous mettons pied à terre avec toute la joie de vieux loups de mer qui rentrent d'une traversée au long cours.
Marché aux fleurs le long de la Seine
Georges Stein (1818-1890)
L'eau a ses charmes, mais le vélo a bien aussi les siens, et nous voulions que le nôtre fût de la fête. Il nous attend au port. Nous nous dirigeons vers lui, et bientôt nous filons avec rapidité. Qu'il fait bon traverser un air plus vif, plus fouetté par la brume humide de l'eau ! Aussi bien nous en avons vu, des bateaux, et assez pour le restant de notre vie !
Donc, plus de bateaux ; c'est à vélo que nous voulons visiter maintenant les bords de la Seine et tout ce qui les décore ; après quoi, pedibus cum jambis, nous nous mêlerons au monde hétérogène qui grouille sur ses berges et leur donne leur vie propre. Appuyant sur la pédale, nous parvenons bien vite au dédoublement des deux bras de la Seine ; la Morgue est là, mais nous préférons obliquer à droite, filant à côte des bateaux de pommes, et passer rapidement en revue ce bel édifice tout flambant neuf, blanc et or, avec des lions en bronze a toutes ses portes, qu'on nous dit être l'Hôtel de Ville de Paris.
Nous débouchons sur la place du Parvis-Notre-Dame. Nous filons encore un peu, nous nous arrêtons net, nous nous retournons, et alors... nous admirons : Notre-Dame est devant nous !
Notre bicyclette appuyée contre le parapet, nous nous laissons nous-mêmes envahir par l'émotion qu'éveille au plus profond de notre être ce spectacle nouveau pour nous. Notre tribut d'admiration payé de bon cœur, nous ne pouvons plus jeter qu'un coup d'œil distrait sur les cubes de maçonnerie de la Préfecture. Un virage à droite nous transporte le long de la Conciergerie. Un autre virage à gauche nous fait apercevoir, dans un petit coin bleu, perdue dans un fouillis de maisons, la flèche toute dorée de la Sainte-Chapelle. Puis, en un emballage, nous arrivons à la statue du bon roi Henri.
Voici le pont des Arts, si mouvementé et d'une animation qui emprunte un cachet tout particulier au passage des seuls piétons ; c'est aussi un endroit aimé des flâneurs, des ambitieux qui contemplent là-bas l'Institut, des gens qui viennent se jeter à l'eau, et de ceux qui viennent y admirer le décor de la Cité. Filant tout le long du Louvre, nous traversons à fond de train la place de la Concorde et débouchons bientôt au pied de la tour Eiffel. Reportés sur la rive droite par le pont de Grenelle, nous faisons au Point-du-Jour une arrivée sensationnelle.
Nous mettons pied à terre à cet endroit : le rôle de notre bicyclette s'arrête là, et à pied maintenant. Nous nous mêlons aux groupes, déjà nombreux à cette heure, qui circulent sur la berge.
Le débarcadère du bateau amène incessamment du monde nouveau. la foule grossit, va, vient, rit, chante et s'entasse – groupant pour un Watteau moderne, un autre Départ pour Cythère – Robinson.
Hélas ! que ne puis-je vous suivre vers ces rivages heureux ! Mais j'ai conscience de mon rôle d'explorateur, je le remplirai jusqu'au bout.
La vie générale des bords de la Seine n'est inconnue d'aucun des nombreux badauds que possède notre capitale.
Combien passent des heures à suivre les cascades de sable dégringolant de la banne soudain déclenchée des grues qui vont plonger leurs bras gigantesques au sein des lourds chalands ! Trié, égrené, criblé, mis par petits tas, le sable est ensuite chargé à grandes envolées de pelle dans le tombereau massif attelé d'un cheval plus massif encore. Mais, pour massive qu'elle est, la vaillante bête va tout à l'heure, en quelques coups de collier, faire démarrer l'énorme charge, puis, après un peu de souffle en haut, s'acheminera vers la nouvelle maison en train de s'édifier là-bas à l'autre bout de Paris. Il rencontrera en route des amis pareils à lui, traînant les gravats de cette même construction, qui vont aller se décharger là-bas, eux aussi, dans d'autres chalands qui les emporteront Dieu sait où : c'est ce qu'on appelle poétiquement un cycle.
Chevaux s'abreuvant dans la Seine derrière Notre Dame
Jules Jacques Veyrassat (1808-1893)
On connaît aussi les files de chalands à perte de vue, les débardeurs passant carrément, à leur aise, sur l'étroite passerelle de 20 centimètres, un panier de 50 kilogrammes de charbon en équilibre sur l'épaule. Mais ce que l'on connaît moins, c'est la vie des habitants de la berge. Le premier type, c'est incontestablement le pêcheur à la ligne, s'hypnotisant avec une rare patience devant son morceau de bouchon. Ce qui abonde aussi, ce sont les amateurs de baignades libres, chevaux, chiens et enfants.
Les chevaux se baignent un peu partout ; ceux qui possèdent des charretiers révolutionnaires s'en vont en pleine Seine au risque de perdre pied à chaque instant et de boire plus que ne peut supporter même un estomac de cheval. Les autres, les pacifiques, les soumis, vont doucement se mouiller le dessous des sabots dans les abreuvoirs réglementaires. Les chiens n'ont pas, en général, pour la baignade, la même docilité que les chevaux.
On doit pour les convaincre employer des moyens plus violents ; d'ailleurs, à peine à l'eau, ils s'empressent de regagner le rivage, et, sans manifester de rancune, vont malicieusement s'ébrouer contre l'auteur de leur plongeon. Quant aux enfants, pour les voir il faut les surprendre, car ils bravent effrontément la pudeur et les arrêtés du préfet.
Bouquinistes le long de la Seine, vue de Notre Dame
Édouard Léon Cortès (1882-1969)
Nous passons à côté d'un tas de vieilles loques qui s'étalent informes dans un éparpillement de fumier à moitié desséché. Notre ami, d'ailleurs « select » mais défiant, s'approche avec précaution et tâte cela du bout de sa canne : le tas s'agite, grogne, se soulève et nous révèle une face humaine flétrie de misère, bouffie de fatigue, qui nous regarde nous éloigner avec ahurissement.
Les approches du boul' Mich' et du quartier Latin nous sont annoncés par une bande joyeuse qui barre toute la largeur de la berge. En passant sous le pont, belle occasion pour réveiller l'écho par des rires à pleines dents !
Mais en cette vie, tout n'est pas que gaieté. Deux minutes plus loin, notre attention est attirée par des groupes qui se pressent sur la berge ; des barques sillonnent le fleuve, des mariniers fouillent le lit avec de longues gaffes : un homme vient d'enjamber le parapet, et s'est précipité là. Des minutes longues, interminables, se passent, les mariniers des trois barques jurent à corps perdu, car les effets trouvés sur la berge n'accusent pas une victime bien appréciable ni ne promettent une pêche bien fructueuse. Enfin l'un s'écrie : « Ah ! je le tiens ! » Il tire sur sa gaffe, se met à genoux, et saisit par le pantalon, dernier costume du noyé, le corps qui flotte maintenant à la surface.
C'est bien un miséreux : pourquoi le mettre dans la barque ? On l'attache sous les bras, on l'amarre à la barque et on le traîne à la remorque, épave inerte, la tête submergée. Arrivé à terre, hissé tant bien que mal, il est étalé sur le sol et reste là. Vit-il ? Est-il mort ? Cela n'a aucune importance. Les gamins, l'air effaré, se bousculent pour voir ; d'autres plus importants expliquent aux nouveaux venus ; un gardien de la paix contemple mélancoliquement le corps. On se décide enfin à recouvrir cette pauvre loque humaine des autres loques qui la vêtaient. Tout cela est entassé tant bien que mal. Le gardien fait « circuler », puis on attend le commissaire qu'on est allé chercher – comme dans la chanson.
Heureusement sur les berges de la Seine qu'à côté des gens qui meurent il y en a aussi qui vivent et qui même y gagnent leur vie. De toutes les professions qui s'y exercent, il en est d'aristocratiques, il en est de prolétaires. Les premières sont représentées par les bouquinistes, établis tout là-haut sur le parapet, au grand air et à la lumière. Un peu bohème, un peu littéraire, un peu inexpert, le marchand de bouquins n'a pas son pareil pour vendre vingt francs le bouquin qui vaut vingt sous, et à céder pour vingt sous le Bollandiste hors de prix.
Sur la berge même, nous trouvons d'autres négociants en gros, les marchands de pommes, dont le rendez-vous général est le quai de l'Hôtel-de-Ville. Puis nous passons à des types particuliers, mais formant encore de quasi-corporations, les cardeurs de matelas en tête. Leur installation en plein air a des allures de petite usine. Du personnel, des fûts de marchandises vides, des machines, rien n'y manque. La division du travail y est parfaitement observée. Tandis que les uns peignent la laine, d'autres tressent le crin en longues nattes qui tout à l'heure détirées, effilochées, mises en écheveaux, iront prendre place dans le vaste sac de toile à rayures voyantes que l'artiste en couture agrémente de jolis pompons de laine blanche.
Baigneur de chiens
Moins nombreux sont les batteurs de tapis, qui, quoique non groupés en association, opèrent par groupes de deux.
Les tondeurs de chiens en général sont isolés, ce ne sont que quelques rares qui ont collaborateur et pignon sur rue. Ils occupent d'ailleurs un échelon plus élevé que le laveur de chiens, qui, lui, est un pauvre trimardeur, qui s'en va, flânant au soleil sur les quais, essayant de « faire » quelque bon bourgeois dont il flatte la vanité de propriétaire par quelques compliments bien sentis sur la beauté de sa bête, – un animal de race, – il s'y connaît !
Plus bas, toujours plus bas, le cycle se rétrécit. Voici le barbier ambulant, le « figaro » parisien. Ici on rase pour un sou ; l'eau est là toute prête, monsieur, et le patient peut aller y rafraîchir sa face ensavonnée. Le commerce, d'ailleurs, est actif et la concurrence acharnée. A la boutique en face, l'administration fournit le linge, la lessive est là qui sèche au grand air. Aussi la clientèle afflue et attend patiemment que s'écoule la traditionnelle « petite minute » du coiffeur. Plus bas encore ! Voici la manufacture libre de tabac. Après toute une semaine de chasse patiente mais fructueuse à la terrasse des cafés, le ramasseur de bouts de mégots vient s'installer à son comptoir, étale sa marchandise à l'état brut et ne tarde pas à être entouré d'amateurs qui suivent l'opération avec intérêt.
La matière première est triée, déchiquetée en filaments. Les amateurs attendent de plus en plus nombreux. La fabrication prend tournure et la marchandise soigneusement étalée a un air des plus appétissants. Elle n'attend plus que la vente, qui est si active qu'au bout de quelques minutes l'heureux fabricant n'a plus qu'à plier bagage, tandis que tout autour flamboient les brûle....-bouche prolétaires ou les cigarettes des raffinés.
Nous sommes arrivés tout à fait au bas de nos petits métiers et n'allons plus trouver maintenant au fil de l'eau que les chiffonniers d'espèces variables, depuis le vieux professionnel entassant philosophiquement dans sa hotte tout le résidu de la vie qui gronde en roulant sur le pont au-dessus de sa tête.
tondeurs de chiens
Ses moments de joie sont ceux où il trouve dans son capharnaüm quelque numéro d'un journal quelconque peu défraîchi. Il garde cette surprise pour sa femme, la pauvre vieille qui opère pour son compte un peu plus loin et s'est fait une spécialité de la ferraille, ou pour quelque autre compagnon de misère, tel que le fruitier d'occasion qui là-bas sur la berge très soigneusement trie des tas de légumes douteux et avariés ramassés au petit jour sur le carreau des Halles.
La vie de tout ce peuple de miséreux décroît à mesure que nous nous éloignons du vieux Paris. Au delà du pont des Saints-Pères elle disparaît, la berge elle-même n'est plus qu'intermittente et c'est par le quai que nous devons reprendre notre marche un peu plus pressée. Le jour tombe en effet, l'ombre gagne déjà la Seine et le pied de la Tour qui élance sa flèche dans une auréole de lumière mourante. Quelques minutes après on ne distingue plus qu'avec peine les bateaux passant sur les derniers reflets que renvoie le miroir de l'eau. Partout ici et au loin s'allument les lumières.
C'est la nuit.
(D'après A travers le monde, paru en 1895) 1 commentaire
1 commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Dona Rodrigue